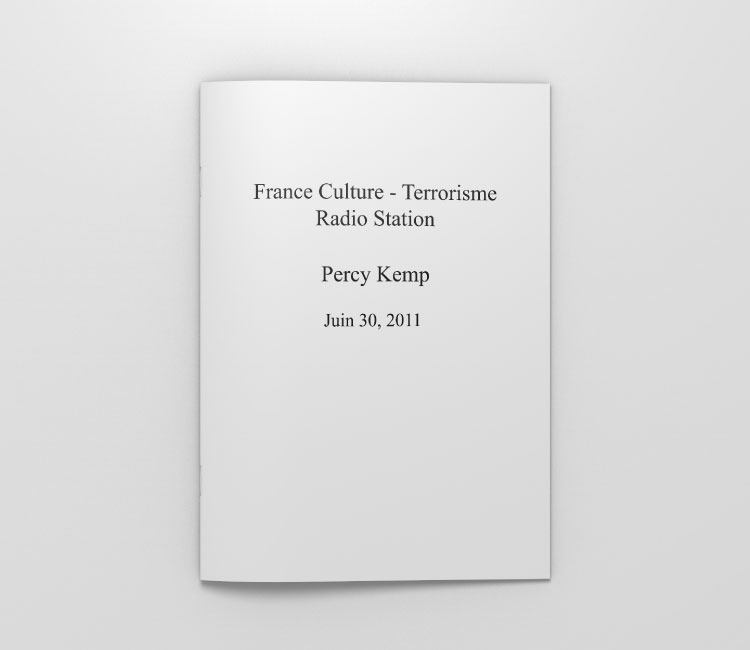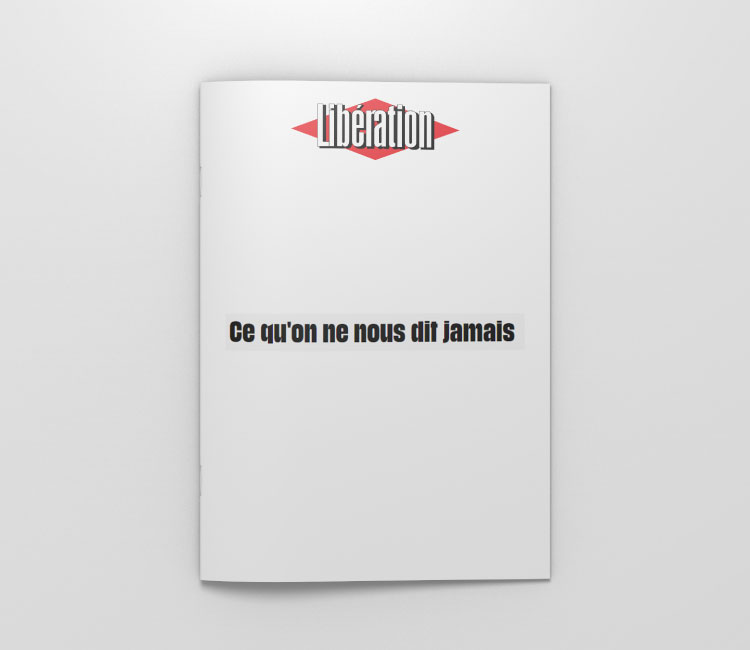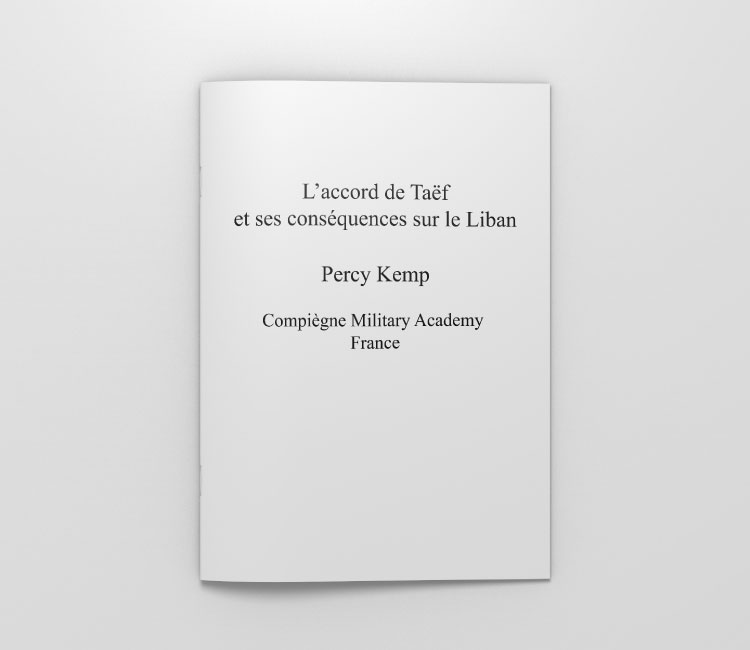I
D’un terrorisme à l’autre
ESPRIT — Aa moment de la guerre du Liban, vous avez collaboré au numéro d’Esprit intitulé « Le Proche-Orient dans la guerre », où vous développez l’hypothèse d’un terrorisme du troisième type dans le contexte da Proche-Orient. Il semble bien que le terrorisme connaisse des métamorphoses importantes. Quelle sont pour vous les plus décisives ?
PERCY KEMP — Paraphrasant Clausewitz, on pourrait dire : « Comme la guerre, le terrorisme est la poursuite de la politique par d’autres moyens. » Le terrorisme contemporain est apparu à partir des années 1970 quand l’Union soviétique a tenté de se servir de mouvements gauchistes et nationalistes dans le cadre de sa propre stratégie pour contrer les États-Unis. Dans les années 1980, avec le déclin de l’URSS et la montée de l’Islam politique, ont émergé des groupes terroristes qui étaient appuyés par des États régionaux. Mais, contrairement aux précédents qui avaient conservé une certaine autonomie par rapport à leurs sponsors — qu’ils soient américains ou soviétiques —, ces groupes n’avaient pratiquement pas de marge de manoeuvre par rapport aux États dont ils servaient les intérêts. Je pense particulièrement aux mouvements islamistes libanais, le jihad islamique ou le Hezbollah.
Puis, dans les années 1990, une série de facteurs — la décomposition de l’Union soviétique, la guerre du Golfe et la prise de pouvoir à Kaboul par les talibans — a bouleversé cette donne. Ces facteurs ont introduit un nouveau rapport de force entre les groupes terroristes et leurs sponsors étatiques. La montée en puissance d’Oussama Ben Laden et d’Al-Qaida suggère que, pour la première fois depuis que l’OLP a tenté la même chose sur le territoire libanais dans les années 1970, une organisation étrangère a réussi à mettre sous sa coupe un État souverain et à s’en servir pour ses intérêts transnationaux. Le type d’organisation terroriste qu’on a vu émerger dans les années 1990 diffère des terrorismes précédents en ce sens que le rapport de force entre l’État et le groupe terroriste a changé en faveur du groupe terroriste. Cette configuration a donné naissance au 11 septembre et à la croisade antiterroriste qui a suivi. De même, au Proche-Orient, il y a eu autonomisation des groupes terroristes par rapport à l’Autorité palestinienne. Cette configuration a donné naissance, et aux opérations suicide devenues monnaie courante en Israël, et à la croisade antipalestinienne d’Ariel Sharon et de George W. Bush.
Quelle importance accordez-vous au phénomène du réseau qui est indissociable de l’action d’Al-Qaida ? S’il renvoie aux nouveaux outils technologiques, aux logiques de diaspora, il participe aussi du mouvement de déterritorialisation que vous évoquez.
Il est vrai qu’on assiste à un phénomène d’atopie. Or, cette atopie du terrorisme répond à une atopie du pouvoir, à commencer par celle du pouvoir économique (multinationales). Il était donc logique que le contre-pouvoir devienne lui aussi atopique. Ce n’est pas le terrorisme qui a inventé l’atopie. Il s’adapte. Le terrorisme fait cela comme d’autres contre-pouvoirs le font : entre autres, les mafias, les mouvements anarchistes, le mouvement antimondialisation. Je ne pense pas qu’il y ait la une spécificité islamiste. La spécificité islamiste est plutôt dans le rapport très particulier au corps, qui est poussé à l’extrême dans le cas des kamikazes puisque le corps sert de pièce centrale dans le dispositif. L’originalité du terrorisme suicidaire islamiste est de créer un agencement original entre, d’un côté, des techniques low-tech et, de l’autre, un logiciel humain hypersophistiqué, plus encore que n’importe quel logiciel artificiel. Il met en rapport les deux pour créer une formidable machine de guerre : un tacot à 500 dollars, des explosifs à 1 000 dollars, quelques branchements électriques, et la pièce la plus importante, ce logiciel de chair, d’os et de sang qu’est le kamikaze. C’est ce rapport qui est le plus intéressant. Ce qu’il y a de plus high-tech dans le terrorisme islamiste, c’est l’homme.
De même que l’on insiste sur le phénomène du réseau ou sur les ressorts religieux ou idéologiques, il faut également mettre en avant le rôle des nouvelles armes, qu’elles soient biologiques, chimiques, nucléaires. Pourtant, on a l’impression que le meilleur outil reste pour le kamikaze son propre corps.
Je dirais que les menaces chimiques et biologiques sont plus probables que les menaces nucléaires. Cela dit, les capacités biologiques et chimiques ont été exagérées, comme le montre l’absence de preuves tangibles découvertes par les Américains dans les camps en Afghanistan. Il faut néanmoins noter que le background scientifique de nombreux militants islamistes suggère qu’ils ont les moyens de concevoir des armes de ce type. Ces militants n’ont pas le même profil qu’un militant de l’IRA ou de l’ETA. En général, les islamistes, quand ils sont éduqués, se dirigent plus vers les sciences exactes. Il y a beaucoup d’ingénieurs, d’informaticiens ou de chimistes parmi eux, bien plus que dans les mouvements antimondialisation, anarchistes ou nationalistes.
En ce qui concerne le nucléaire, je ne pense pas qu’il y ait une vraie menace islamiste. Mais cela pourrait changer si les États-Unis réussissent à voler au Pakistan sa « bombe islamique ». Cela pourrait encourager des membres de l’establishment scientifique pakistanais à passer du côté d’Al-Qaida.
La « bombe du pauvre », la bombe dite « sale » faite à partir de déchets radioactifs d’origine militaire ou médicale, est plus facile à réaliser techniquement. Pourtant, une bombe de ce type ne peut avoir de vrai impact destructeur que si elle éclate à une certaine altitude au-dessus d’un centre urbain, et dans des conditions climatiques favorables (la pluie étoufferait l’impact, alors que le vent le multiplie rait). Mais, pour ce faire, une organisation complexe est nécessaire puisqu’il faut un vecteur de lancement et une bombe a gravitation. Si des terroristes réussissaient à faire passer une bombe sale dans un container pour la faire exploser dans le port de New York, l’impact médiatique et psychologique serait très fort mais l’impact meurtrier, plus faible.
Il y a aussi un danger de cyberterrorisme, difficile à contrer parce que les percées technologiques vont paradoxalement plus vite que les cahiers des charges des autorités étatiques qui cherchent à s’en défendre. Outre le fait que les contre-mesures auront toujours un temps de retard sur la technologie, un autre danger réside dans la concurrence effrénée entre les grandes sociétés qui produisent les logiciels, ce qui les pousse à sous-traiter dans les pays du tiers monde (Égypte, Malaisie). Il y a la une forte possibilité de pénétration, puisqu’un programmateur basé à Kuala Lumpur peut faire un backdoor dans un système pour pouvoir s’y infiltrer par la suite. On est encore peu conscient de ce danger car on a jusqu’à maintenant eu affaire à des cybermanifestations et non à du cyberterrorisme.
II
Le 11 septembre ou l’entrée dans XXIe siècle
Mais ne faut-il pas, au-delà des cléments mis en avant (nouvelles armes, réseau, ressort religieux), s’interroger sur un contexte historique avant tout marqué par la fin de la guerre froide et une prépondérance américaine qui ne va pas sans poser des problèmes spécifiques ?
L’installation des talibans en Afghanistan et l’arrivée d’Oussama Ben Laden au coeur de l’appareil d’État taliban relèvent de l’histoire du XXe siècle et renvoient à l’époque où il y avait encore une guerre froide, une lutte entre un bloc occidental et un bloc de l’Est, quand les Américains aidaient activement les mouvements islamistes, entre autres en Afghanistan, pour contrer l’URSS. De manière contrastée, ce à quoi l’on assiste depuis le 11 septembre appartient plus au XXIe siècle. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un lien entre ces deux phases, mais je pense que la première est d’une certaine manière « préhistorique ». Ce qui a fait basculer les choses, c’est la volonté de Ben Laden de frapper les États-Unis chez eux alors que, jusqu’ici, les opposants islamistes aux États-Unis avaient concentré leurs efforts pour frapper les Américains dans les zones musulmanes de façon à les affaiblir ou à les faire changer d’avis sur leur présence militaire. Ce fut le cas en 1983, quand le jihad islamique avait réussi à provoquer, grâce à des opérations suicide, le retrait des troupes américaines et françaises du Liban. Aujourd’hui, Ben Laden a choisi de frapper l’Amérique chez elle.
Je pense d’ailleurs que cette décision est d’un ressort moins stratégique que personnel. La guerre entre les Américains et Ben Laden relève, selon moi, d’une querelle de famille à laquelle le monde est globalement étranger mais dont il subit les conséquences. On peut en chercher l’origine dans les liens créés entre Ben Laden d’un côté, les services de renseignements saoudiens et américains de l’autre. Ben Laden a été instrumentalisé par les Américains pour servir leurs intérêts stratégiques en Asie centrale et au Moyen-Orient, mais il y a eu à un moment donné lâchage et trahison, et Ben Laden en a gardé une haine farouche contre les États-Unis. Cette haine ne s’explique pas uniquement par des raisons idéologiques ou culturelles. Si c’était le cas, elle aurait dû se porter plus sur Israël que sur les États-Unis. Il faut saisir ce que représente cette trahison pour Ben Laden. Un film datant des années 1990, État de siège, met en scène des islamistes irakiens traités par la CIA pour renverser Saddam Hussein avant d’être ensuite livrés par le gouvernement américain au régime irakien. Cette trahison conduit ces islamistes à perpétrer une vague d’attentats contre les Américains sur leur sol. La décision de Ben Laden de frapper Manhattan et le Pentagone relève d’une affaire de famille : je ne m’explique pas autrement cette haine farouche.
Le fait d’avoir frappé change la donne. Ce qu’on prend aujourd’hui pour de l’arrogance américaine, suite au 11 septembre, relève beaucoup plus à mon avis de la peur panique. Et ce qu’on prend pour de l’omnipotence américaine n’est que le pendant d’un sentiment de culpabilité, du fait d’avoir manqué à son devoir de prévention et de protection du territoire américain. Je pense que la décision de Ben Laden de frapper l’Amérique a bouleversé la notion de topos. Jusque-là, les Américains étaient prêts à accepter que subsistent, dans un monde qu’ils dominent, des lieux qui échappent à leur contrôle dans la mesure où la nuisance qui en émanerait serait tolérable. Suite à l’attaque du 11 septembre, les Américains se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient plus tolérer que subsistent de tels topos. Le 11 septembre a contraint les États-Unis à intervenir pour déterritorialiser complètement les groupes terroristes. Il n’y a désormais plus de zone franche concevable. Finis, ces lieux interlopes où des choses étaient possibles. Aujourd’hui, le mot d’ordre est le degré de tolérance zéro. D’où l’insistance de Bush à affirmer qu’il ne peut plus y avoir de havre de terrorisme. Ce n’est pas l’arrogance ou l’omnipotence américaine qui est à l’origine de cela, mais la peur viscérale de l’administration américaine et le sentiment qu’elle a d’avoir manqué à ses devoirs. En atteste d’ailleurs l’offensive des démocrates qui accusent Bush d’avoir disposé de renseignements et de ne pas avoir fait le nécessaire. L’humiliation ressentie n’est pas à négliger.
Mais il faudrait préciser les liens que l’islam entretient avec ces pratiques terroristes inédites.
Ce qui est nouveau chez les islamistes par rapport à ce qu’on a connu jusque-là, c’est la fusion des trois modes opératoires auxquels on s’était habitué et que des chercheurs tels que Gilles Kepel et Olivier Roy ont identifiés, à savoir la prédication (tabligh) prônée par les islamistes mainstream des Frères musulmans, l’action violente (haraka) prônée par les groupuscules, et l’excommunication et l’exil (takfir wa hijra) prônés par de doux illuminés. Jusque-là, nous avions été confrontés à des islamistes qui faisaient le choix de la prédication en vue de changer la société par le bas, à d’autres islamistes qui voulaient changer le haut de la société par la violence et l’assassinat politique cible, ou à des islamistes adeptes de l’excommunication et l’exil, qui faisaient le choix de se retirer du monde.
Or, ce qui est nouveau, c’est que les actions auxquelles on assiste aujourd’hui opèrent une fusion de ces trois attitudes : en s’annihilant, le kamikaze islamiste est dans l’action puisqu’il pèse sur l’establishment israélien ou américain par le haut, il est dans la prédication puisque son exemple est répercuté par les médias et sert d’exemple a d’autres jeunes, et il est aussi dans l’excommunication et dans l’exil puisqu’il se retire littéralement et physiquement du monde en s’annihilant lui-même. Ce qui est aussi nouveau, et qui résulte de cette fusion réussie de ces trois modes opératoires, c’est que c’est un véritable phénomène de masse. Ce n’est plus le fait d’une élite et d’un petit nombre, comme c’était le cas chez les révolutionnaires russes du XIXe siècle ou chez les pilotes kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale. C’est un phénomène « populaire » et « démocratique » qui, pour être solitaire dans son exécution diachronique, ne rappelle pas mois, synchroniquement, le suicide en masse des baleines qui viennent d’elles-mêmes s’échouer sur le rivage.
Mais, si la dimension culturelle musulmane est importante pour décrire ce phénomène, elle n’est pas suffisante pour le comprendre. Il faut en effet admettre que le terrorisme islamiste n’est qu’une facette d’un malaise de civilisation plus large et qui comprend des phénomènes aussi divers que le taux de suicides, la délinquance dans les banlieues, le vandalisme, le mouvement anarchiste renaissant, les mouvements ethniques, ou les tueurs fous qui ne sont plus une spécificité américaine, comme en témoigne la tuerie récente de Nanterre. Pour comprendre ce qui se passe, pour bien apprécier la véritable nature de toutes ces réponses topiques à un pouvoir qui ne l’est pas moins, on ne peut pas se limiter à l’islam.
III
L’empire américain et le schisme mondiale
Le contexte historique renvoie donc selon vous à un monde où la prépondérance américaine favorise le trouble et la tourmente…
Il faut dépasser la violence islamiste, dépasser la culture musulmane pour s’attacher à la violence tout court, au mal d’être, à la révolte. Depuis la fin de la guerre froide et le triomphe de l’économie de marché, un great divide, un schisme s’est produit avec un effet de miroir. On assiste à la mise en place d’un État à l’échelle mondiale avec Washington comme nouvelle Rome — même si l’on ne voit malheureusement pas où est la Grèce de cette Rome. De part et d’autre, que l’on soit pour ou contre le système, le mode opératoire est le même. Le salut est de plus en plus individuel. Il n’est plus collectif.
Il ne dépend plus des syndicats, des partis politiques ou de la prise du pouvoir. On vit du côté des bénéficiaires du système dans une civilisation de pain et de jeux, de loto et de télé. Il faudrait relire les Jeux de l’esprit, ce très beau roman de Pierre Boulle. De l’autre côté, ceux qui sont exclus du système suivent ce même mode opératoire où le salut est aussi individuel, sauf que ce n’est plus le pain et les jeux qui les séduisent, mais le martyre et le Paradis. Dans les deux cas, le salut est individuel.
Ce qui différencie les islamistes des autres exclus, c’est qu’ils ont, eux, complètement désespéré de changer le système, alors que les antimondialistes et les nationalistes n’ont pas encore désespéré. Chez les islamistes, il y a un désespoir tel qu’ils en arrivent à s’exclure physiquement du monde pour retrouver au plus vite un monde meilleur.
Il y a un lien évident entre ce qui se passe à Bradford en Angleterre, dans les banlieues parisiennes, à Karachi ou aux États-Unis. Il y a partout un mal d’être évident né de l’instauration graduelle d’un État mondial de type néovictorien. On assiste à l’établissement d’un État bourgeois sur toute la planète, avec instauration d’un appareil répressif de plus en plus sophistiqué qui génère plus d’exclus. Et ces exclus réagissent chacun à sa manière : la réaction peut être très idéologisée, de type islamiste ou antimondialiste, mais elle peut aussi être très personnalisée, de type vol ou délinquance. Un siècle après le décès de la reine Victoria, nous nous retrouvons à nouveau plongés dans le monde décrit par Michel Foucault dans Surveiller et punir.
Les conflits entre la CIA et le FBI font la une des journaux, les erreurs commises sont connues de tous, mais faut-il en rester à cette version négative ? N’y a-t-il pas une reprise en main et des transformations qui affectent la pratique du renseignement et des services secrets américains trop longtemps convaincus que la technique résolvait tous les problèmes ?
Longtemps, le monde du renseignement a fonctionné sur un mode géopolitique allant parfois jusqu’à la paranoïa. Dans n’importe quel phénomène violent, on voyait la main de l’ennemi séculaire — la main de Moscou, du « Centre », des services de renseignements soviétiques. Depuis la fin de la guerre froide, on est passé à un autre excès. On dépolitise à l’extrême le traitement des questions terroristes. Ce traitement est devenu culturaliste et psychologique l’essentialité de l’islam). La manière de gérer le problème terroriste et celle de gérer la criminalité sont quasi identiques. Cette évacuation du politique est un bouleversement très important en ce sens que les officiers de renseignements deviennent petit à petit des policiers. Ainsi, en pratiquant le track find, pister les réseaux bancaires mafieux ou les réseaux terroristes s’équivaut. Il n’y a plus de dimension politique ou géopolitique à ce traitement. Pourquoi ? Parce qu’on s’est convaincu que c’est la fin de l’Histoire. Parce qu’on ne raisonne plus sur un mode dialectique. Parce qu’on est passé de la notion d’ennemi (politique) à celle de rival (surtout économique), tant en politique étrangère qu’en politique interne où les notions de gauche et de droite n’ont plus de sens, sauf aux bouts extrêmes de l’éventail. Parce qu’on ne croit plus vraiment à une victoire de l’Autre sur soi, et chez soi.
Dans ce contexte, je pense qu’à la suite du premier tour des dernières élections présidentielles, les Français se sont surtout offert un beau psychodrame pour rien. Du temps où le bloc soviétique était confronté au bloc occidental, il y avait une peur réelle de part et d’autre que l’ennemi n’arrive chez soi. On imaginait des scénarios où les chars soviétiques déferleraient sur la France, et une peur similaire régnait au Kremlin. Avec le terrorisme, cette même peur de l’Autre n’existe plus, notamment chez le principal acteur dans cette guerre, les États-Unis. Les Américains ne peuvent pas croire à une victoire des islamistes chez eux. Ils n’ont même pas une communauté musulmane assez importante pour leur faire penser que, petit à petit, ces gens arriveront au pouvoir. Quand on se bat contre un ennemi dont on sait qu’il ne peut pas prendre l’avantage sur vous, le traitement de cet ennemi est dépolitisé, ce qui explique la criminalisation du terrorisme islamiste par les Américains, et le traitement de cette menace sur un mode plus policier que de renseignement.
On a beaucoup dit que l’Europe maîtrisait une partie du renseignement relatif au terrorisme. Quelle est la nature du décalage entre l’un et l’autre côté de l’Atlantique ?
Les traitements européen et américain du phénomène devraient être différenciés, non pas en termes d’efficacité, mais d’approche. Pour les dirigeants européens, plus proches géographiquement et culturellement des musulmans et qui ont à gouverner des sociétés à forte présence musulmane, le problème se pose différemment que pour les Américains, géographiquement éloignés de l’islam et qui n’ont pas à gérer de véritable problème démographique. Pour l’Européen, la proximité géographique de l’Autre et ses avancées démographiques entraînent un traitement plus interactif, les questions appelant des réponses. Les services y sont plus à l’écoute de ce que l’Autre fait. Chez les Américains, la distance a encouragé un mode plus « simplex » que « duplex », un mode de surveillance et d’action plus que de gestion et d’interaction. Ce n’est donc pas la question du plus ou moins d’efficacité qui fait la différence.
L’efficacité est d’ailleurs toujours réduite, dans la mesure où le vivier est considérable et où la menace vient toujours de sources jusqu’alors inconnues : on connaît bien ceux qui ont déjà agi contre nous, mais guère ceux qui n’ont pas encore agi. Ce qui n’est pas étalonné comme danger sur notre écran radar n’existe pas pour nous. L’adolescent de Jenine qui se fera demain pulvériser à Tel Aviv n’est pas encore connu des services israéliens. Le vivier est important et la potentialité, d’autant plus accrue. Aussi efficaces que soient les services de renseignement, il leur est impossible d’arrêter tous les acteurs potentiels.
De manière très concrète, quels sont les changements substantiels qu’il faut mettre en avant ?
La première conséquence du 11 septembre a été une augmentation considérable des budgets de la défense, et des budgets de sécurité de renseignement. Autre conséquence : une plus grande coopération entre les services américains, européens et russes. De nombreuses réserves émises par les Européens à l’encontre des Américains ont été levées après le 11 septembre. Les Russes ont d’ailleurs énormément profité de cette affaire. On observe une coopération internationale plus étroite, qui rejoint la coopération déjà existante dans la lutte contre la criminalité organisée. On prolonge celle-ci vers le terrorisme. Une troisième conséquence est l’introduction d’un nouvel outillage juridique qui permet de mieux contrôler la logistique des mouvements, notamment leur logistique financière. Tout ce qui permet à ce monde atopique de se mouvoir doit aujourd’hui être contrecarré. Mais si on légifère pour empêcher les choses de survenir comme elles se sont faites, rien ne dit que ces mesures répressives empêcheront les choses d’avoir lieu comme elles pourraient se faire. L’imagination de l’être humain, sa capacité de souffrance et sa pulsion de mort auront toujours une longueur d’avance sur les contre-mesures, d’autant que le système capitaliste libéral ne peut pas légiférer à outrance, ni pour longtemps, sans risquer de miner les fondements mêmes de son existence. Trop d’État ne fait pas l’affaire du libéralisme
IV
La nouvelle équation internationale
En quoi le nouveau rapport de force, qui passe par la croisade antiterroriste, est-il venu troubler l’organisation du système politique mondial ?
Le résultat immédiat du 11 septembre et de la croisade antiterroriste lancée depuis a été de convaincre les nations d’accepter que les États-Unis sont effectivement le leader du monde. Il est vrai que certains continuent à refuser cela, pour des raisons stratégiques — c’est le cas de l’Iran, qui est exclu du système - ou pour des raisons tactiques — c’est le cas de la Chine, qui veut monnayer son appui à Washington. Mais ceux qu’on dit faire partie du « concert des nations » acceptent désormais le leadership américain. Une deuxième conséquence du 11 septembre, c’est que le centre de la planète se déplace de plus en plus vers la périphérie. Je pense ici aux trois pôles que sont Washington, Moscou et Pékin. Entre ces trois miradors, le Vieux Monde, fait de l’Europe et de la Méditerranée, est de plus en plus marginalisé et vidé de sa substance.
Mais l’Europe n’aurait-elle pas pu jouer un rôle spécifique au lieu de se plaindre de la puissance américaine ? Si l’on parle avec Colin Powell d’un « front multiple et de longue durée » contre le terrorisme, l’Europe n’aurait-elle pas pu agir d’une manière autonome et originale, se préoccuper par exemple d’être le régulateur d’une mondialisation par trop saurage ? Quant aux États-Unis, ils auraient pu imaginer un nouveau plan Marshall.
A la fin de la guerre froide, deux possibilités s’offraient à nous : faire ou laisser faire. Faire, c’était renforcer les acquis de la social-démocratie à l’européenne, privilégier la cohésion sociale au détriment de l’économie. Faire, sur le plan externe, c’était essayer de réduire les écarts Nord-Sud, et privilégier la lutte contre la misère sur les avantages économiques et commerciaux. Laisser faire, par contre, c’était prôner que la victoire sur le communisme démontrait la suprématie du libéralisme et en tirer les conséquences, à savoir que chaque individu est responsable de lui-même et doit saisir ses propres chances. Laisser faire, sur le plan externe, c’était privilégier l’expansion économique au détriment de l’aide au tiers monde, comme si l’hémisphère sud, pour lequel l’Est et l’Ouest s’étaient battus pendant près d’un demi-siècle, devenait le pré carré du vainqueur, et notamment de ses entreprises. John Le Carré, dans un article récent, se demandait ce que nous avions fait de notre victoire de la guerre froide. Et il répondait : « Rien, absolument rien sur le plan de la lutte contre la misère et le sous-développement. »
Les États-Unis, les vainqueurs, n’ont pas été moteur comme en Europe occidentale en 1945. Ils n’ont rien fait. Pourquoi ? Peut-être parce qu’il y a une relation intime entre démocratie et impérialisme. Il se peut bien que la démocratie ne soit pas vraiment viable, et qu’elle ne puisse subvenir aux besoins matériels et psychologiques de ses membres que dans la mesure où ils constituent un nombre relativement restreint, différencié du plus grand nombre qui n’aurait, lui, ni ce statut de citoyen, ni les droits qui vont avec. Cet Autre, ce non-citoyen, n’a pas droit au même traitement. La démocratie athénienne n’a pas survécu à l’impérialisme athénien, et l’on peut se demander si la démocratie américaine survivra à l’impérialisme américain.
Les États-Unis ont décidé d’ériger autour d’eux, et plus généralement autour de « la chrétienté », un mur d’Hadrien par-delà lequel les principes démocratiques qui s’appliquent intra muros n’ont pas cours. Cela explique que, du Proche-Orient à l’Asie du Sud-Est en passant par l’Asie centrale, Washington privilégie la mise en place de régimes militarisés, répressifs et non représentatifs, chargés justement de contrôler cet Autre et de l’empêcher de nuire, tout comme les roitelets vassaux de Rome le faisaient jadis sur les marches de l’Empire.
Face à une Russie qui se réveille et joue judicieusement, et face à l’omnipotence américaine, il aurait fallu que l’Europe se trouve un créneau original lui permettant de se démarquer. Celui de l’aide au développement aurait été idéal, étant donné la composition démographique de l’Europe et sa situation géographique. Mais pour cela, il faut une volonté de leadership et du courage, ce qu’on ne voit malheureusement pas en Europe aujourd’hui. L’Europe se retrouve donc en porte à faux. Elle partage les inquiétudes des Américains mais ne veut pas reconnaître leur prééminence. Et surtout, elle ne veut pas perdre sa spécificité culturelle. Elle tergiverse donc, elle hésite, et l’État mondial se constitue en partie sans elle. Pourquoi ? Parce que, pour mettre en place cet État mondial, les Américains n’ont pas tant besoin de leurs alliés européens que des organisations internationales qui légifèrent, régularisent, contrôlent (FMI, BM, OMC, ONU, etc.).
Aujourd’hui, pour l’Europe, le choix est simple : soit s’aligner sur les États-Unis, soit provoquer un schisme en fondant un Empire romain d’Orient face à l’Empire romain d’Occident dont le centre se trouve être outre-Atlantique. S’aligner complètement sur les États-Unis, c’est bien sûr reconnaître la prééminence de la nouvelle Rome et reconnaitre aussi que les exclus, les persécutés et les défavorisés qui avaient fui le Vieux Monde pour le Nouveau à partir du XVIIe siècle ont finalement gagné. C’est reconnaître que, plus de deux siècles après la victoire des colons américains sur George III d’Angleterre, ces mêmes colons viennent de remporter une victoire sur toute l’Europe. C’est reconnaître que l’Europe est désormais une province qui applique des décisions prises ailleurs. En contrepartie, refuser l’alignement sur Washington, c’est accepter de s’ouvrir, non pas tant à l’Est qu’au Sud, pour inclure dans l’Europe l’autre partie du monde gui se trouve désormais marginalisée, à savoir tout le pourtour méditerranéen. C’est accueillir en Europe la Turquie musulmane, Israël, et même les Arabes (et leur pétrole). C’est faire un Empire romain d’Orient face à l’Empire romain d’Occident que sont les États-Unis. C’est jouer Byzance contre Rome. Mais bien sûr, ce serait risquer la dilution du fonds judéo-chrétien qui reste central à l’Union européenne. Et cela, on ne le veut pas, quoique la démographie nous démontre que c’est à terme inévitable.
L’impérialisme américain est-il à la hauteur de sa tâche ? L’Empire est-il capable de conduire une politique impériale
Je doute fort qu’il y ait une volonté impérialiste américaine comme il y eut jadis une volonté impériale britannique, russe, française ou allemande. L’impérialisme américain est une donnée objective plus que subjective. Il est dans les faits plus que dans l’intention. Dans la mesure où il relève plus du potentiel que de l’intention, on peut bien sûr mettre en doute la capacité des États-Unis à remplir le rôle qui leur semble naturellement dévolu. Le réflexe isolationniste est toujours très fort outre-Atlantique, et il a fallu qu’Al-Qaida s’attaque aux Américains chez eux pour qu’il recule. Mais on peut s’inquiéter à mon avis de la capacité des États-Unis à mener à son terme le processus en marche de « romanisation » du monde.
Le problème de l’administration américaine, c’est qu’elle n’arrive pas encore à transformer ce mouvement objectif en un mouvement subjectif qui emporte l’adhésion. Jacques Delors, à propos de la lenteur de la construction européenne, disait un jour qu’on ne pouvait pas demander aux gens de tomber amoureux d’un marché commun. Et de même qu’on ne tombe pas amoureux d’un marché commun, on ne tombe pas amoureux de valeurs de consommation. On les adopte, simplement (quand on en a les moyens).
Quelles sont pour vous les principales failles de cette nouvelle équation ?
et le système économique libéral qui, pour continuer à fonctionner, ne peut supporter plus qu’une certaine dose d’ingérence étatique. A trop légiférer, à trop mettre en place des mesures restrictives sur les mouvements de capitaux et de personnes, on finira par empêcher les personnes bona fide de fonctionner et de prospérer. Et des tensions internes en résulteront nécessairement.
Une deuxième faille structurelle réside dans la nature du système de défense de « la chrétienté » mis en place par les États-Unis. Ce système allie en effet l’action intra muros à l’action hors les murs. Un succès hors les murs, grâce à la mise en place de régimes militarisés inféodes à Washington (Pakistan, Palestine, Afghanistan, Indonésie, Ouzbékistan), réduirait bien sûr les risques d’émergence d’un État tentaculaire intra muros mais augmenterait d’autant les tensions Nord/Sud. Inversement, si ces tensions Nord/Sud devaient s’exacerber et mettre à mal la première ligne de défense érigée par les États-Unis. Washington se verrait obligé de porter son effort intra muros (outillage juridique et instruments policiers), ce qui augmenterait d’autant les risques de tensions internes à « la chrétienté »
Et les failles conjoncturelles, notamment au Moyen-Orient ?
On pourrait parler de l’attitude très mitigée de l’Arabie Saoudite. Les Américains n’ont pas encore touché à l’Arabie Saoudite. Ils ont fait pression sur de nombreux pays pour limiter les donations aux mouvements islamistes, pour mieux surveiller le système bancaire islamiste, pour mieux contrôler les islamistes, même pacifiques, mais ils ont jusqu’ici épargné les Saoudiens. Pourquoi ? D’un côté, ils ont peur de trop fragiliser le régime mais de l’autre, ils veulent avoir prise sur ce régime pour l’amener à de meilleures dispositions sur d’autres questions, comme l’Irak et la Palestine. Le système de financement des islamistes en Arabie Saoudite n’a pas encore été touché. Il y a là une faille qui rappelle celle qui avait donné naissance à Ben Laden et à Al-Qaida.
Autre faille au Moyen-Orient, cette volonté américaine de continuer d’exclure l’Iran et la Syrie. À supposer que, pour une raison militaire ou politique, les choses aillent mal en Afghanistan pour les Américains, les Iraniens, qui, jusque-là, font le dos rond en attendant que la tempête passe, pourraient être encouragés de passer à l’offensive.
Il y a aussi dans cette nouvelle équation beaucoup de dangers inhérents. Je pense à la fragilité des régimes arabes. Jusqu’à présent, de nombreux régimes arabes exportaient leurs éléments turbulents vers la Bosnie, vers l’Afghanistan. Aujourd’hui, les militants arabes islamistes ne peuvent plus agir que chez eux. Cela fragilise encore plus des régimes déjà en manque de légitimité.
On observe enfin un autre phénomène, dont les Américains minimisent l’importance. Ils sont en effet en train d’entrer dans un jeu à trois dans le cadre duquel ils se mettent à mal avec des islamistes qui ne leur étaient pas hostiles au départ. La croisade antiterroriste pousse les Américains à appuyer des régimes répressifs et à déclarer hors la loi des mouvements islamistes qui, au départ, n’avaient pour ennemi que le régime local. En s’alliant à ces régimes et en les appuyant financièrement et militairement, les Américains sont en train de se faire des ennemis d’islamistes qui prônaient jusqu’ici l’arrivée pacifique au pouvoir, et qui ne le peuvent désormais plus. Cela rappelle un peu la manière dont les Américains avaient appuyé des dictateurs sud-américains pour contrer le communisme, allant jusqu’à encourager le renversement de régimes démocratiquement élus comme au Chili. Tom Friedmann écrivait dans le New York Times peu de temps après le 11 septembre qu’Al-Qaida et les islamistes étant liés à la mafia, notamment à la mafia russe, il fallait que Washington pèse sur Moscou pour que la mafia russe aide les États-Unis dans leur guerre contre les islamistes. C’est la même logique que celle de la guerre froide. On s’allie au diable pour éliminer l’ennemi. La fin justifie les moyens. On répète l’erreur déjà commise en Afghanistan.
On répète les mêmes erreurs car on dépolitise l’analyse. Que penser de l’attitude des monarchies et de l’Arabie Saoudite ? Quant à la Syrie, n’est-elle pas en train de redevenir un facteur de durcissement au Proche-Orient ?
Dans le Golfe — région stratégique —, le salut des monarchies arabes passe par un alignement total sur les Américains. Leur survie dépend de la présence militaire et du soutien américains. Ces régimes sont pris en tenaille entre une population qui exige que l’islam soit respecté et les demandes du grand frère américain. Mais quand vient le moment de la décision, aucun de ces dirigeants ne prend position contre les États-Unis. Ils font partie du système américain.
En ce qui concerne le Proche-Orient, on joue là sur un autre registre, bien moins vital pour les Américains, et même pour le monde entier. En effet, il y a un décalage considérable entre, d’un côté, le poids culturel et psychologique de la Méditerranée orientale dans notre ethos, et de l’autre, son poids géostratégique. Le « berceau de la civilisation », le « lieu de naissance du monothéisme », est paradoxalement un cul de sac géostratégique : là, pas de grands flux énergétiques, pas de flux financiers ou militaires. Pour cette raison, le seuil de tolérance de la communauté internationale à l’égard de la violence dans cette région est bas. Les États-Unis sont prêts à y tolérer un niveau de violence assez élevé, si tant est qu’il n’y a pas utilisation d’armes chimiques, bactériologiques, nucléaires, ni de terrorisme international. Cela excepté, on pourrait se battre des dizaines d’années encore dans la région sans que cela change grand-chose au monde. On confond trop souvent l’importance culturelle de cette région et son importance stratégique. Il a jadis suffi que les Iraniens jettent quelques mines dans le Golfe persique pour que les Américains et les Anglais s’empressent de repavillonner les tankers koweïtiens. Il a aussi suffi que Saddam Hussein mette le pied au Koweït pour que toute la planète lui tombe dessus. Mais au Proche-Orient, contrairement au Golfe, on se bat depuis des dizaines d’années et tant que c’est un low intensity conflict, le seuil de tolérance y demeurera très bas
Au-delà des failles de cette équation politique internationale, peut-on parler de points de rupture ?
On peut évoquer un échec américain en Afghanistan qui montrerait que le roi est nu et encouragerait les oppositions. Une attitude américaine trop favorable à Israël dans le conflit qui l’oppose aux musulmans pourrait de même encourager des États de la région (Syrie, Iran) à prendre les États-Unis pour cible. Une extension de la croisade à l’Irak constituerait aussi un tournant puisqu’elle contribuerait à fragiliser un peu plus les régimes arabes. Et si d’aventure, dans un sursaut similaire à celui qui avait suivi la défaite de 1948 face à Israël, des officiers islamistes réussissaient à prendre le pouvoir dans un pays arabe, toute la configuration née de l’après-11 septembre pourrait être remise en cause. Car c’est une configuration encore fragile, qui commence juste à se mettre en place. On parle depuis le début des années 1990 d’un « nouvel ordre mondial », mais le fait est que ce « nouvel ordre mondial » ne se met en place que depuis le 11 septembre.
On est quand même frappé par l’absence de réaction de la « rue » arabe aux événements, et au défi américain.
Si la « rue » arabe ne réagit plus aussi spontanément ni de manière aussi verbale et émotionnelle que par le passé, c’est surtout do à l’absence dans les pays arabes de partis et d’organisations de masse qui soient indépendants des pouvoirs établis. Ces derniers ont en effet à coeur de ne pas provoquer les États-Unis indûment. Ils mettent donc le couvercle sur la marmite. À cause de cela, et à cause aussi de la propagation objective des valeurs de la société occidentale de consommation, le salut n’est plus tant perçu chez les Arabes comme collectif qu’individuel. On ne manifeste plus sa colère : on essaie de faire de l’argent, ou alors on recherche le martyre.
Vous n’avez guère évoqué le rôle des instruments de communication de masse dans la maîtrise des images. Est-ce un hasard ?
Peut-être parce qu’il faudrait parler plus d’instruments de diffusion que d’instruments de communication. Dans les médias de masse, l’événement, c’est l’image même qui finit par se substituer à la réalité qui l’avait suscitée. En faisant le choix de fonctionner sur un mode planétaire, et sur celui du temps réel, les médias de masse privilégient nécessairement le concept sur l’objet, le contenant sur le contenu, et l’intelligibilité sur l’intelligence. Les journaux télévisés des médias de masse, c’est le règne de la société de spectacle. Or, le spectacle se suffit à lui-même et ne doit rien aux événements dont il s’inspire — souvent très librement.
Certes, la communication, c’est-à-dire les signes entendus comme médiums plus ou moins fidèles entre la réalité et l’être humain, existe toujours, mais il faudrait la chercher ailleurs que dans les médias de masse : peut-être du côté des instruments de communication des contre-pouvoirs qui fonctionnent, eux, sur un mode localisé et différé. À la diffusion en temps réel de CNN ou d’Al-Jazira répond, du côté des contre-pouvoirs, la communication en différé des communiqués, tracts, livres, cassettes vidéo et audio des organisations islamistes. Et à la diffusion à vocation planétaire de CNN ou d’Al-Jazira, répond la communication locale des réunions de cellule, des séminaires, des messes basses et des prêches dans les mosquées.
La distinction n’est pas que quantitative. Elle est aussi qualitative. Ce que la communication des contre-pouvoirs produit, et que la diffusion des médias de masse ne peut faire, c’est favoriser le maintien d’un capital social local. Et c’est peut-être cela qui, à terme, finira par faire la différence.
Propos recueillis par Olivier Mongin