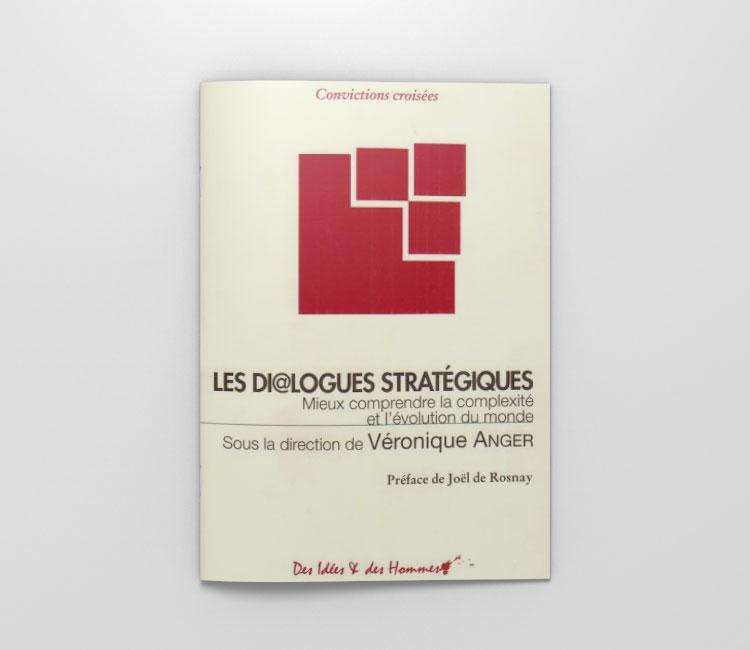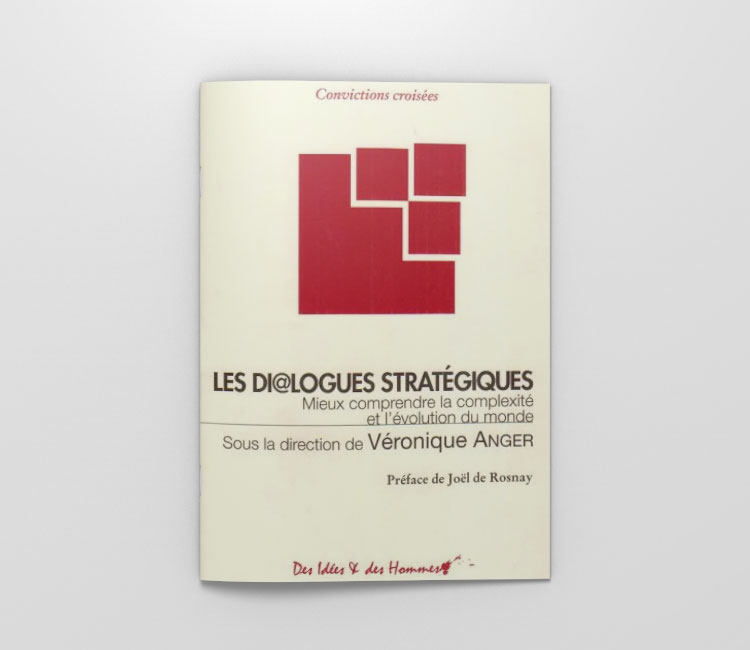ESPRIT — Nombreux sont ceux qui considèrent le 11 septembre 2001 comme l’événement qui a marqué un changement de paradigme dans l’ordre mondial, lié à la nouvelle doctrine stratégique américaine. Nos capacités d’analyse et d’interprétation du monde sont-elles à revoie ? On parle notamment de « l’entrée dans un monde chaotique ». Pouvez-vous en préciser l’idée ?
Percy KEMP — Dans la mesure où il aura permis de découpler une machine de guerre américaine jusqu’alors bridée, le 11 septembre nous aura fait ressentir un choc plus ancien datant de la chute du mur de Berlin. Or, s’il est vrai que l’effondrement du bloc soviétique nous a réconciliés avec l’Est (comme l’atteste l’élargissement de l’Otan et de l’Union européenne), il est aussi vrai qu’il nous a, d’une certaine manière, fait perdre le nord. La guerre froide était, somme toute, plutôt rassurante, sur un plan épistémologique. Depuis la disparition du vecteur Est-Ouest qui gérait notre vie politique, économique et sociale, nous avons l’impression que le monde est mal barré : au sens propre, comme au sens figuré. Nous nous sommes donc essayés à un nombre de paradigmes de substitution, que nous avons sollicités afin de cerner le sens de l’histoire et de saisir la logique des relations sociales et internationales. Nous avons ainsi évoqué la fin pure et simple de l’histoire, un monde monopolaire régi par un géant débonnaire, un choc des civilisations, une deuxième guerre de Troie, une opposition entre un fonds gréco-romain et un autre asiatique, une lutte entre la démocratie et la barbarie, un affrontement entre une aire judéo-chrétienne et une autre musulmane, voire une nouvelle lutte de classes. Or, force est de constater qu’aucun de ces paradigmes ne nous a permis de mieux appréhender la nouvelle dialectique historique. Aucun d’entre eux, pris séparément, ne permet d’expliquer des phénomènes aussi variés que le terrorisme islamiste, les sectes suicidaires, la montée des particularismes ethniques, l’accroissement des tensions sociales, les réflexes corporatistes, la réaction écologiste, la jacquerie altermondialiste, le retour de l’anarchisme, le grand banditisme, la petite délinquance, le vandalisme, la pyromanie ou les tueurs fous. Certes, l’un ou l’autre de ces paradigmes peut nous aider à comprendre tel ou tel de ces phénomènes. Mais il n’en est pas un, finalement, qui nous permette de les comprendre tous, et surtout de les mettre en relation. D’où notre impression de chaos : chaos où, soit dit en passant, tout est « un » dans un équilibre stable, contrairement au cosmos où tout est fragmenté, même si tous ces fragments vivent plus ou moins en harmonie dans un équilibre en permanence instable.
Pourquoi ces paradigmes auraient-ils failli ?
Peut-être parce qu’ils relèvent surtout du langage. L’essentiel du discours que nous produisons depuis la fin de la guerre froide est un travail du langage sur le langage, bien plus qu’un travail d’observation et de déduction. Les paradigmes que j’évoquais à l’instant relèvent en fait du pur domaine des idées. C’est quoi, au juste, le choc des civilisations pour une famille marchande de Dubaï ? ou, pour un sans-papiers, la lutte des classes ? ou l’affrontement entre la démocratie et la barbarie pour une tribu nomade ? Ces paradigmes sont essentiellement directifs, en ce sens qu’ils reflètent moins les faits que l’intention et la volonté. Et cela, à un moment où aucune puissance, aucune classe, aucun groupe, ne semble en mesure d’imposer sa vision à tous. Si un pouvoir donné était en mesure d’agir efficacement et de convaincre universellement, l’un ou l’autre des paradigmes dans lequel il se reconnaîtrait s’imposerait par la force des choses : j’ai gagné, donc j’ai raison. Mais ce n’est pas encore le cas.
C’est avec les néoconservateurs que l’on s’est le plus rapproché de cette relation entre pouvoir et savoir, le moment fort en étant bien sûr la chute de Bagdad. Au moment où la capitale irakienne tombait aux mains des Américains, nous avons été sur le point de succomber à la tentation de « l’hégémonie globale bienveillante » chère aux néoconservateurs, et qui n’est rien d’autre qu’une version moderne du despotisme éclairé. Mais les thèses des néoconservateurs sont à présent battues en brèche par la réalité, et donc mises en cause. Il y a une faiblesse (relative, certes) des néoconservateurs qui empêche leur savoir de convaincre et de nous amener à penser le monde en fonction de leur vision. Du fait de ce lien voulu entre la réflexion et l’action, les paradigmes s’étiolent en wishful thinking, en voeux pieux, en désirs qui ne correspondent pas à la réalité puisqu’ils n’arrivent pas à l’infléchir assez dans leur sens.
Ce ne sont pas la des outils épistémologiques permettant de voir le monde dans un prisme nouveau. Pour reprendre une expression de Michel Foucault, ces paradigmes seraient dans le vrai, sans pour autant dire vrai. Le paradigme de la lutte de classes est dans le vrai du discours syndicaliste. Mais dit-il vrai ? Le paradigme de la lutte entre la démocratie et la barbarie est dans le vrai du discours néoconservateur américain. Mais dit-il pour autant vrai ? J’en doute. Ce sont en réalité des paradigmes plus intelligibles qu’intelligents, qui incitent plus à l’action qu’à la réflexion.
Un tel outil épistémologique, qui dirait vrai sans nécessairement chercher à être dans le vrai. est-il possible aujourd’hui ?
Je le pense. Mais pour ce faire, un tel outil devrait s’appuyer sur les faits, et non sur les idées qui cherchent à façonner les faits ou à les créer. Dans le Grand Cahier, d’Agota Kristof, deux jeunes frères couchent leurs observations sur papier. Ces garçons ont en fait une règle très simple : la composition doit être vraie. Je voudrais, si vous le permettez, vous en citer un passage :
Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons. ce que nous faisons. Par exemple, il est interdit d’écrire : « Grand-Mère ressemble à une sorcière »; mais il est permis d’écrire : « Les gens appellent Grand-Mère la Sorcière. » Il est interdit d’écrire : « La Petite Ville est belle », car la Petite Ville peut être belle pour nous et laide pour quelqu’un d’autre [...] Nous écrirons : « Nous mangeons beaucoup de noix », et non : « Nous aimons les noix », car le mot « aimer » n’est pas sûr [...l Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues ; il vaut mieux éviter leur emploi et s’en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c’est-à-dire à la description fidèle des faits.
Franchement, nos maîtres politiques, de même que nos stratèges, feraient bien de s’en inspirer.
Quel type de paradigme et d’outil épistémologique l’observation des faits vous inspire-t-elle ?
Dans la mesure où c’est surtout la violence ambiante qui nous donne cette sensation de chaos, je serais assez tenté par un paradigme qui se construirait autour de la violence même, et plus particulièrement autour du monopole de la violence légitime. Il me semble en effet que, depuis la fin de l’équilibre de la terreur entre les deux blocs d’hier, tout tourne autour du monopole de la violence légitime et des défis qui lui sont lancés. Os, la violence légitime ne s’exerce pos partout de la même manière, et les défis qui lui sont lancés par les uns comme par les autres ne prennent pas toujours la même forme. En schématisant, on pourrait dire que la violence légitime s’exerce d’une manière précise au sein d’une certaine aire que j’appellerai « l’intérieur », et d’une tout autre manière au sein d’une autre aire que j’appellerai « l’extérieur ». De même, les défis qui lui sont lancés sont différents selon qu’ils émanent de « l’intérieur » ou de « l’extérieur ».
Intérieur/extérieur, rival/ennemi : ce qui a changé
Ce que j’appelle « l’intérieur » serait le mieux défini comme étant l’aire où la notion de rivalité (rivalité personnelle, politique, économique ou culturelle) primerait sur celle d’inimitié. Cet intérieur recouvrirait, grosso modo, les pays de l’OCDE, Israël, la Russie postsoviétique, mais aussi la Chine, notamment depuis l’ouverture économique du pays. Ce serait l’aire au sein de laquelle l’Autre peut être perçu comme un rival, comme un concurrent, comme un adversaire, mais c’est aussi l’aire au sein de laquelle son existence serait reconnue. Il s’agira donc de négocier et de composer avec lui afin de le faire plier et de l’amener à notre raison, mais il ne s’agira jamais ni de l’écraser, ni de l’annihiler. Il en va ainsi de la rivalité culturelle et linguistique entre les Français et les Anglo-Américains (francophonie, Commonwealth, US Aid), de la rivalité commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne (OMC, bananes, acier, OGM, Boeing et Airbus) ou de la rivalité géopolitique entre les puissances « continentales » (Allemagne, Russie, Chine) et les puissances « navales » (États-Unis, Royaume-Uni, Japon). Or, quel que soit l’enjeu d’une partie engagée, au sein de cette aire, entre rivaux géopolitiques ou concurrents économiques, on n’ira jamais jusqu’à exiger la mise à mort du rival ou du concurrent qui sera, au pire, perçu comme un ennemi politique, mais jamais comme un ennemi personnel. Je vous renvoie ici aux notions d’hostis et d’inimicus développées par Carl Schmitt.
L’intérieur est en fait l’aire où des règles établies s’appliquent et sont respectées. C’est l’aire où, pour reprendre l’expression de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, on peut atteindre la limite sans nécessairement dépasser le seuil vers un nouvel agencement, en l’occurrence vers un agencement guerrier. C’est l’aire où les relations qui se nouent le sont sous le mode de l’alliance, de la complicité, de la concurrence ou de la rivalité, mais toujours dans la reconnaissance de l’existence de l’Autre et de son altérité, et dans le respect du seuil minimal de préservation de ses intérêts légitimes, en deçà duquel il ne pourrait plus continuer d’exister de manière autonome. Récemment, à propos de la crise irakienne, on a vu fuser aux États-Unis le mot d’ordre de « punir la France ». Punir : une notion qui exclut l’éradication. Dans le même temps, les États-Unis parlaient d’ignorer l’Allemagne et de pardonner à la Russie. Là aussi, il n’est nullement question d’annihiler cet Autre qui s’oppose à nous. Il s’agit simplement de l’affaiblir afin de négocier avec lui à partir d’une position de force. De même, pour le plus faible, il ne s’agit pas d’exterminer le plus fort, mais de lui faire entendre raison et de l’amener à accepter le partage du gâteau et des responsabilités.
Un mode différent de fonctionnement s’appliquerait donc à « l’extérieur »
Contrairement à « l’intérieur », « l’extérieur » serait le mieux défini comme étant l’aire où la notion d’ennemi personnel primerait. Oussama Ben Laden et Saddam Hussein ne sont pas les rivaux du président américain. Ils ne sont pas plus ses ennemis politiques. Ce sont ses ennemis personnels. Alors qu’à l’intérieur, Jacques Chirac, qui s’est trouvé un moment être l’ennemi politique de George W. Bush, ne sera jamais son ennemi personnel
L’extérieur est donc l’aire où les règles établies du jeu ne s’appliquent pas vraiment, où certains acteurs ne s’y reconnaissent pas, et on ils cherchent par tous les moyens possibles à les changer, provoquant de ce fait de la part de l’intérieur, garant de ces mêmes règles, une réaction violente allant jusqu’à nier le droit de l’Autre à l’existence.
Cette aire comprend toutes les nations qui ne jouent pas le jeu, ou alors qui le jouent mal (Cuba, l’Irak, l’Iran, la Libye, la Syrie, la Corée du Nord, les paradis fiscaux), tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de l’intérieur (comme les intégristes musulmans), ainsi que toutes les populations n’ayant pas accès à ces mêmes valeurs, et notamment aux valeurs de consommation qui relèvent du pur pouvoir d’achat. C’est l’aire où, pour reprendre encore une fois l’expression de Deleuze et Guattari, la limite est aisément atteinte et le seuil tout aussi facilement dépassé vers un agencement mortel. C’est l’aire où les relations qui se nouent le sont sous le mode du refus de reconnaissance de l’Autre, du conflit guerrier, de la mise en quarantaine, de l’exclusion, de la domination, de la subjugation et de l’extermination. Là, il ne s’agit plus de négocier avec l’Autre, de composer avec lui, de l’affaiblir ni de le faire plier afin de l’amener à notre raison, mais bien de l’éradiquer. Il en va ainsi des relations entre George W. Bush et Saddam Hussein, comme il en va des relations entre Vladimir Poutine et les indépendantistes tchétchènes, entre Ariel Sharon et Yasser Arafat, entre Tracfin et les mafias, entre la DEA américaine et les cartels colombiens, entre les services occidentaux de renseignement et les terroristes. Géographiquement, cette aire dite de l’extérieur recouvrirait tout ce qui est hors OCDE et hors pays industrialisés, c’est-a-dire deux bons tiers de l’humanité.
S’agit-il uniquement d’une cassure géographique entre un intérieur recouvrant l’hémisphère nord et un extérieur l’hémisphère sud ?
Aucunement. Il existe des ilots conséquents de l’extérieur au sein même de l’aire de l’intérieur. Dans son Histoire de la folie, Michel Foucault avait fait la différence entre le traitement de la folie en Occident à l’âge classique, et celui de la lèpre. Il avait ainsi montré qu’alors que les lépreux étaient enfermés, par-delà les murs de la Cité, dans un lieu (la léproserie) qu’il avait appelé « l’intérieur de l’extérieur », les fous, eux, étaient confinés, à l’intérieur même des murs de la Cité, dans un lieu (l’asile) qu’il avait décrit comme étant « l’extérieur de l’intérieur ». Affinant donc notre analyse, nous pourrions dire que l’extérieur se subdivise aujourd’hui en un intérieur de l’extérieur (les nouveaux lépreux) et en un extérieur de l’intérieur les nouveaux fous), l’intérieur de l’extérieur étant constitué de tout ce qui se situe par-delà le mur immatériel mais néanmoins réel qui a remplacé celui de Berlin, et l’extérieur de l’intérieur étant constitué par tout ce qui, quoique intra-muros, demeure exclu de la civitas, soit physiquement (ghetto, cité de banlieue, squat, prison, maison de redressement, hôpital psychiatrique), soit socialement (immigrés, sans-papiers, gens du voyage), soit culturellement (Noirs, musulmans), soit économiquement (clochards, vagabonds, travailleurs au noir, contrebandiers, adeptes du troc). En schématisant, on pourrait dire que le tiers monde, qui habite l’intérieur de l’extérieur, est le lépreux des temps modernes, et que le quart monde, qui squatte l’extérieur de l’intérieur, en est le fou.
Comment cette dichotomie intérieur/extérieur s’articule-t-elle sur le paradigme du monopole de la violence légitime ?
Ces deux notions dichotomiques d’intérieur et d’extérieur ainsi posées, il devient peut-être possible d’entrevoir une stratégie de pouvoir fondée sur l’exercice de la violence légitime et qui tendrait à un dual containment : contenir le tiers monde à l’intérieur de l’extérieur, et contenir le quart monde à l’extérieur de l’intérieur.
Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, et plus encore depuis le 11 septembre, cette stratégie duale de renfermement repose pour l’essentiel sur les épaules de quatre pôles de pouvoir travaillant tant bien que mal par paires : Affaires étrangères-Défense, d’une part, Justice-Intérieur, de l’autre. À la paire Affaires Étrangères-Défense, est dévolue la mission de s’assurer que les ennemis de l’extérieur sont tenus à distance, contenus, et neutralisés. Les Affaires étrangères s’acquittent de colle tache en forgeant des alliances tant avec les partenaires de l’intérieur qu’avec des gouvernements « amis » de l’extérieur. Quant à la Défense, elle s’acquitte de sa tache en entrant dans des alliances bilatérales et multilatérales, en augmentant ses capacités de projection militaire, en établissant des bases avance copies marches de la Cité (ainsi le projet de déplacer l’essentiel des bases militaires américaines d’Europe occidentale vers la Roumanie la Bulgarie et la Pologne), en créant des points d’ancrage et de mouillage (lily-pads) le long de « l’are d’instabilité » (notamment en Irak, au Pakistan, en Afghanistan et dans les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale), et en renforçant les outils de contrôle de régimes peu recommandables mais néanmoins amis (ainsi, l’Algérie ou l’Ouzbékistan).
Le but, dans l’un comme dans l’autre cas, est de prévoir et de contrer toute action émanant de l’extérieur et pouvant menacer l’intérieur, ses intérêts et ses citoyens. D’un autre coté, à l paire Justice-Intérieur est dévolue, par la législation comme par la répression, la mission de s’assurer que les ennemis de l’intérieur son contenus à l’extérieur de l’intérieur. La Justice s’acquitte de sa tâche en légiférant et en harmonisant les législations transnationales de manière à criminaliser ces ennemis, et l’Intérieur s’acquitte de la sienne en négociant des accords de coopération internationale, et en pourchassant ces ennemis dûment identifiés à des criminels.
Tous les appareils d’État n’ont cependant pas le même mode de fonctionnement…
L’emphase mise par chaque État sur l’un ou l’autre volet de cette stratégie duale de renfermement (peser plus à l’extérieur ou peser plus à l’intérieur) est en grande partie déterminée par les moyens dont il dispose, et par sa culture politique. Par moyens, j’entends que plus la diplomatie d’un pays sera efficace, plus grandes seront ses capacités de projection militaire, plus il pourra mettre l’accent sur le renfermement à l’extérieur. Inversement, plus sa diplomatie sera inefficace, plus faibles seront ses capacités de projection militaire, plus il aura tendance à privilégier le renfermement à l’intérieur. Par culture politique, j’entends que plus l’État aura une tradition libérale, plus il lui sera difficile d’imposer à sa société civile des chocs internes, de type sécuritaire, susceptibles de réduire les libertés publiques. Inversement, plus l’État en question aura une culture politique répressive, plus il lui sera aisé d’introduire de nouvelles législations qui, tout en neutralisant l’ennemi de l’intérieur, affecteront aussi la société civile.
Dans ces pays où les moyens internes d’intervention sont autrement plus importants que les moyens externes, le poids est mis sur l’intérieur dans la mesure où c’est là qu’on peut vraiment générer du pouvoir. C’est le cas, par exemple, en Russie et en Chine, deux pays où il n’y a pas de tradition politique libérale, où la société civile est désorganisée et où l’appareil de répression intérieure est bien plus performant que les machines diplomatique et militaire à vocation externe. La, l’accent est franchement mis sur le renfermement au sein même des frontières et à la proche périphérie, et c’est la paire Justice-Intérieur qui prime sur la paire Affaires étrangères-Défense. C’est ce qui explique en partie pourquoi les Russes et les Chinois cassent sans état d’âme du Caucasien, de l’Ouïgour ou du dissident, tout en refusant de suivre les États-Unis sur l’Irak.
Dans les démocraties libérales, on assiste actuellement à un jeu de bascule entre les deux volets de cette stratégie duale de renfermement. Avant même l’élection de George W. Bush à la présidence des États-Unis, les néoconservateurs avaient fait de l’Irak leur priorité en politique étrangère. Le I1 septembre avait ensuite bouleversé leur agenda. Immédiatement après ces attentats, et alors que la société civile américaine était encore sous le choc, ils changèrent leur fusil d’épaule et réussirent à faire voter par le Congrès le Patriot Act. Ils oeuvrèrent aussi à fédéraliser les forces de maintien de l’ordre et à amender le Posse Comitatus Act de 1878, qui place les militaires dans une position subordonnée par rapport aux forces civiles de maintien de l’ordre. Mais, revenue du choc du 11 septembre, la société civile s’est rebiffée et mobilisée contre les atteintes aux libertés publiques et les violations de la Constitution faites au nom de la lutte antiterroriste. Confrontés à cette ligne de résistance qui bridait la paire Justice-Intérieur, les néoconservateurs, disposant par ailleurs d’un appareil diplomatique impressionnant et d’un potentiel militaire incomparable, ont à nouveau changé leur fusil d’épaule et mis en avant la paire Affaires étrangères-Défense. D’où l’aventure irakienne, qui servira, à son tour, à relancer une aventure interne qui commençait à s’essouffler.
Le pouvoir « en pente douce »
La stratégie de la classe politique française semble à ce propos plutôt atypique.
Libérale, la France devrait en principe opter pour une stratégie externe. Pourtant, on a l’impression que c’est l’inverse qui se produit. L’effort consenti à l’intérieur y est bien plus important que celui consenti à l’extérieur : nouvelles législations répressives et renforcement des forces de maintien de l’ordre, alors même que le budget de Défense est subrepticement réduit. Pourquoi ? Pour des raisons qui ont à voir autant avec les moyens dont dispose la France qu’avec sa culture politique. Culturellement, la France d’aujourd’hui hésite encore entre sa vocation « continentale » (qui la rapprocherait du mode opératoire de l’Allemagne ou de la Russie) et sa vocation « navale » (qui la rapprocherait de celui des États-Unis ou du Royaume-Uni). Quant aux moyens, ceux dont dispose Paris étant largement inférieurs à ceux de Washington, toute action externe de la France ne serait pas vraiment génératrice de plus de pouvoir pour la classe politique, qui n’aurait rien à y gagner. La France n’aurait en fait été qu’un second couteau en Irak. Si Paris avait accepté d’y suivre Washington, l’armée de terre française n’aurait pu expédier sur place que la moitié des effectifs envoyés en 1990-1991 dans le cadre de la Division Daguet, et cela avec quasiment le même matériel que douze ans auparavant. C’est dire si la force de projection française s’étiole, grevant ainsi le ministère de la Défense. Dans le même ordre d’idée, les Libyens viennent d’accepter, lors de négociations avec le Département d’État américain, d’indemniser les familles des deux cent soixante-dix victimes de l’attentat de Lockerbie à hauteur de deux milliards sept cents millions de dollars, alors qu’ils n’avaient auparavant consenti que trente-trois millions de dollars aux familles des cent soixante-dix victimes du DC-10 français. En d’autres mots, en termes diplomatiques, la vie d’un Américain valait en août 2003 dix millions de dollars, alors que celle d’un Français n’en valait que deux cent mille, soit cinquante fois moins. Le Quai d’Orsay renégocie actuellement une réévaluation de cette indemnisation à hauteur d’un million de dollars par victime, mais il n’en reste pas moins que la somme consentie par les Libyens aux victimes françaises illustre la faiblesse relative du poids diplomatique de la France. On s’étonnera moins, après cela, que l’élite politique française mise plus sur l’intérieur, source de pouvoir et de capital politique : lutte contre le terrorisme, l’insécurité, la délinquance, la fraude, la vitesse au volant, la marginalité, la déviance, les sans-papiers. Mais il ne faut pas s’y méprendre : intérieur/extérieur, ou intérieur et extérieur, sont autant de stratégies différentes de pouvoir, qui épousent la ligne de moindre résistance. C’est la mode au pouvoir en pente douce.
Ces stratégies de pouvoir ont-elles leurs limites ou allons-nous assister au triomphe définitif de la guerre préventive à l’extérieur, et du tout-sécuritaire à l’intérieur ?
J’entrevois un nombre de contradictions internes qui en montrent d’ores et déjà les limites. Je vois une contradiction entre la stratégie de l’intérieur qui a aujourd’hui cours dans les sociétés occidentales, et le libéralisme politique et économique qui fonde ces mêmes sociétés. L’État légifère et contrôle de plus en plus ses citoyens, alors même qu’il se désengage des domaines social et économique. Nous avons vu cela au Royaume-Uni dès les années 1980 avec les conservateurs, et nous soyons à présent cela dans la France jacobine, le parti au pouvoir passant subrepticement du souhait d’un « État modeste » au désir d’un « État minimum ». De fait, plusieurs questions se posent. Tout d’abord, jusqu’à quel point un État qui se délie de ses citoyens et leur rend en quelque sorte leur liberté d’adultes peut-il continuer à les traiter comme des enfants et à renforcer ses systèmes de contrôle sur leur vie quotidienne ? Ensuite, jusqu’à quand l’économie libérale pourra-t-elle continuer d’accepter ces ingérences systématiques qui brident la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux ? Il arrivera un moment où le citoyen ordinaire refusera de continuer de se laisser dicter sa vie par un appareil d’État qui ne lui assure même plus les services publics les plus élémentaires, et où la libre entreprise refusera, elle, de renouveler sa confiance à une caste politique qui l’empêche de respirer. A voir le cosmos si parfaitement réglé qu’on nous promet, on en vient presque à regretter le chaos où nous vivons. C’est à croire que, dans la guerre froide qui vient de s’achever, le vainqueur n’était pas celui qu’on croyait.
Une deuxième contradiction réside dans l’émergence de castes bureaucratiques s’articulant autour des stratégies de pouvoir que je viens de décrire, et qui ont une fâcheuse tendance à vouloir se substituer aux classes sociales. Or, si les classes sociales sont par essence mobiles (d’où les notions de nouveaux riches et de parvenus), les castes qui s’y superposent le sont beaucoup moins. Il y a danger que les choses se figent, ceux qui sont en haut de l’échelle s’y maintenant, et ceux qui sont en bas y demeurant durablement. D’où des frustrations, source de contradictions entre les puissants et les petits, comme entre certains petits et d’autres petits : petits blancs, petits porteurs d’explosifs, petits porteurs de baluchons, petits porteurs d’actions.
De même, il y a contradiction entre la vocation universelle de l’Amérique et l’exclusion volontaire de l’islam par cette même Amérique. Les États-Unis ont vocation à absorber des groupes ethniques, culturels et religieux divers. Or, pour la première fois dans leur histoire, ils excluent de leur étreinte une partie non négligeable de la population mondiale : les musulmans. L’Amérique, qui accueillait jadis tous les exclus (hétérodoxes anglais, paysans sans terre siciliens et irlandais, persécutés d’Europe centrale, laissés-pour-compte du monde entier), les rejette à présent. On connaît le poème d’Emma Lazarus ornant la statue de la Liberté :
Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me :
I lift my lamp beside the golden door
qu’on pourrait traduire par :
Donnez-moi vos corps éreintés, vos miséreux, vos masses entassées aspirant à la liberté, Le misérable rebut de vos rivages grouillants. Envoyez-moi ces sans feu ni lieu que la tempête malmène : Je tiens ma lampe allumée près de la porte dorée.
Aujourd’hui, l’Amérique pourrait aussi bien écrire un pastiche de ce poème, et le substituer à celui d’Emma Lazarus sur la statue de la Liberté :
Gardez donc vos corps éreintés, vos miséreux, vos masses entassées aspirant à la liberté, le misérable rebut de vos rivages grouillants. Ne vous avisez surtout pas de m’envoyer ces sans feu ni lieu que la tempête malmène : Car j’ai éteint la lampe qui éclairait la porte dorée.
Les sans feu ni lieu qu’Emma Lazarus appelait de ses voeux deviennent de fait des sans foi ni loi qu’il faut exterminer. C’est la première grande limite que les États-Unis se posent à eux-mêmes, et elle ne sera pas sans conséquences sur leurs prétentions universelles et sur l’image, qu’ils souhaitent projeter d’eux-mêmes, d’une superpuissance bienveillante.
Il existe par ailleurs un risque de contradiction entre les rivaux de l’intérieur. Dans cette optique, il n’est pas inintéressant de rappeler qu’au début de la dernière crise irakienne, l’ennemi (irakien) des Américains a vite été effacé par le rival (français) de l’Amérique. Or, il existe un risque de glissement, à l’intérieur, du concept de rival vers celui d’ennemi. Après tout, cela s’est déjà vu à deux reprises dans la première moitié du siècle dernier. Une répétition de ce glissement ne peut être exclue, et elle se fera d’autant plus facilement que la menace externe sera écartée. Quand l’ennemi externe deviendra une simple proie, les rivaux-alliés de la veille deviendront des prédateurs et se disputeront les morceaux de choix. Ce risque est d’ailleurs à la fois attisé et freiné par la nouvelle doctrine stratégique américaine, qui repose sur un postulat assez simple : empêcher le reste du monde d’atteindre la parité militaire et technologique avec les Etats-Unis. En d’autres termes, les moyens militaires et le potentiel technologique de toutes les nations confondues ne devront jamais égaler les moyens et le potentiel américains. D’un côté, le discours américain sur cette nouvelle doctrine (ainsi dans The Weekly Standard ou le The New Republic) attise les contradictions au sein du camp dit de l’intérieur, mais de l’autre, sa mise en application réussie par le Pentagone contribue à freiner ces contradictions et à les maintenir en deçà du seuil guerrier. L’ami américain ? le rival américain ? ou l’ennemi américain ? La réponse est probablement : les trois à la fois. Le dernier roman d’Alan Judd, The Kaiser’s Last Kiss, éclaire assez bien le va-et-vient permanent qui a cours, au sein de l’aire de l’intérieur, entre la perception de l’Autre comme ami, comme rival et comme ennemi : on y voit l’empereur Guillaume d’Allemagne en exil pester contre son cousin Georgie (George V d’Angleterre) pour ne pas avoir volé au secours de leur cousin Nicolas (le tsar Nicolas II), renversé puis assassiné par les bolcheviks, oubliant ce faisant que le cousin Georgie et le cousin Nicolas avaient été ses ennemis durant la Grande Guerre.
On assiste, semble-t-il, à une certaine ambiguïté de l’Amérique aujourd’hui. Il y’a celle qui échoue : « l’Amérique de Bagdad », malgré une doctrine stratégique qui se maintient et l’idée néoimpérialiste, selon laquelle les Américains pensaient se faire acclamer en Irak. Mais il reste tout de même une forte demande d’Amérique. Qu’en pensez-vous ?
Les néoconservateurs estiment que l’Amérique est investie d’une mission universelle, qu’il est de son devoir d’apporter à tous la liberté et la démocratie, et cela, même à ceux qui n’en voudraient pas et n’en
auraient que faire. C’est ce que l’un d’entre eux appelle « America’s profound sense of mission ». Malheureusement, cela ne donne pas toujours le résultat escompté. Rappelez-vous la croisade meurtrière de T’abolitionniste John Brown, au Kansas, à la veille de la guerre civile de 1860. Rappelez-vous aussi ce personnage d’Alden Pyle, décrit par Graham Greene dans Un Américain bien tranquille, qui sème la mort et la désolation dans l’Indochine des années 1950, tout cela avec les meilleures intentions du monde. Contrairement aux démocrates qui préconisaient le soft power (à savoir la propagation de l’influence américaine par la culture et par l’économie), les néoconservateurs voudraient changer manu militari la culture politique de sociétés entières, notamment au Moyen-Orient, jadis berceau des religions et des civilisations, aujourd’hui celui, disent-ils, de tous les maux. Pour les décrire, Chris Patten, l’actuel chancelier de l’université d’Oxford et dernier gouverneur britannique de Hong Kong, emprunte d’ailleurs très justement à Robespierre la notion de « missionnaires armés ».
Mais cette aventure missionnaire a ses limites. L’expansion américaine est en effet moins mue par les hommes que par la technologie. Elle est technologically driven. Les États-Unis démentent en fait le vieil adage qui voudrait que la fin justifie les moyens. Avec eux, ce sont plutôt les moyens qui justifient la fin. L’ancien régime irakien a eu beau leur jurer qu’il ne détenait plus d’armes de destruction massive, ils y sont quand même allés. Inversement, le régime nord-coréen a beau déclarer qu’il possède désormais des armes de destruction massive, les Etats-Unis rétorquent que ceci n’est pas encore confirmé. Pourquoi ? Parce que. technologiquement, ils pouvaient aller jusqu’à Bagdad, mais pas encore jusqu’à Pyongyang. Les Américains font ce qu’ils savent pouvoir faire. Ils vont là où ils savent pouvoir aller. Si possible à moindre frais. Si possible sans trop de sacrifices. Encore une fois, c’est la ligne de moindre résistance. Le pouvoir en pente douce. C’est peut-être pour cela que nous leur manquons parfois de respect, et que nous leur nions tout héroïsme. Après tout, les héros sont censés faire l’impossible, non le possible.
Cela dit, je suis d’accord avec vous pour dire qu’il y a une demande d’Amérique. Mais je l’exprimerais quant à moi surtout comme un désir de changement. On appelle les Américains faute d’autre chose, et faute bien sûr de pouvoir effectuer le changement soi-même. Si l’on fait appel à l’Amérique, c’est parce qu’elle est la seule à avoir démontré la volonté de s’engager là où d’autres ne le voulaient ou ne le pouvaient pas. Les critiques qui fusent aujourd’hui en Irak contre l’occupant américain font d’ailleurs partie de ce désir d’Amérique : on proteste parce que la protestation est désormais possible, grâce, précisément, aux Américains.
Pas assez d’Europe, trop d’Amérique
Dans votre discours, l’absence de l’Europe est frappante.
C’est vrai, et c’est en partie dû au poids considérable des États-Unis sur la scène et dans l’économie mondiales. Certains chiffres ne trompent pas : le marché intérieur américain est de 33 % supérieur au marché intérieur européen ; sur chaque dollar dépensé de par le monde en publicité, quarante-neuf cents (soit 49 %) le sont sur le marché américain même ; le taux de natalité américain a désormais dépassé le taux de natalité européen; en 2050, les Américains seront un demi-milliard ; toujours en 2050, la moyenne d’âge aux États-Unis sera de trente-sept ans, contre cinquante-sept ans en Europe ; le budget militaire des Etats-Unis équivaut aujourd’hui au budget militaire de tous les autres pays réunis ; les Américains investissent plus en recherche et développement que toutes les autres nations confondues.
De ce fait, on voit déjà le grand capital européen prendre ses distances avec les États-nations de l’Europe pour se rapprocher des États-Unis : lors du dernier conflit irakien, quand la France a voulu se démarquer de l’Amérique, les grandes entreprises françaises, craignant un boycott américain, ont fait pression sur le gouvernement français afin qu’il change de politique.
Mais il y a plus. On pourrait en fait dire que l’Europe, aujourd’hui, ce sont les États-Unis. L’Europe est absente parce que l’Amérique est la prolongation des valeurs européennes. Cela a été le cas tout au long de la guerre froide, quand le camp occidental, mené par les États-Unis. était censé représenter les valeurs démocratiques occidentales et le camp socialiste mené par l’Union soviétique, les valeurs du despotisme oriental. L’Europe paie en ce sens le prix de la primauté qu’elle a accordée à l’Amérique dans la seconde moitié du siècle dernier. On ne peut cependant pas exclure que dans une cinquantaine d’années, le président des États-Unis soit coréen ou philippin. La special relationship si chère aux Anglais ne se fera alors plus par-delà l’Atlantique, mais par-delà le Pacifique, et l’Europe, Royaume-Uni y compris, en sera exclue. Le fonds commun euro-américain ne sera alors plus le même, et le décalage entre les valeurs européennes et les valeurs américaines ira grandissant. Néanmoins, pour l’instant, les Etats-Unis s’affichent comme une Europe plus vivante, plus dynamique. C’est là le principal problème de l’Union européenne, qui ne pourra le résoudre qu’en se démarquant culturellement et ethniquement des États-Unis d’Amérique.
Comment comprenez-vous le décalage entre la performance militaro-technologique des Etats-Unis et leur incapacité à être présents autrement que sur ce mode-là ? Est-ce qu’on peut le considérer comme une insouciance face à la question identitaire, ou comme une panique concernant la question nationale ?
Vous avez raison de remarquer que les États-Unis ont, quelque part, un problème avec la question nationale. Ils semblent se situer sur un plan plus religieux et « cosmique » que national et territorial. Ainsi, récemment, quand il s’est agi pour eux de trouver le bon équilibre lors de la constitution d’un conseil de gouvernement irakien, ils ont opté pour un dosage ethno-religieux qui reflète une vision plus religieuse que nationale des choses. Le conseil qu’ils ont formé comprend en effet quatorze chiites, quatre sunnites, cinq Kurdes, un Turkmène et un chrétien (en d’autres termes, quatorze musulmans chiites, dix musulmans sunnites et un chrétien). Ce faisant, ils ont certes réussi un équilibre ethno-religieux, mais aux dépens de l’équilibre politique national. Le bloc chiite, par exemple, est politiquement très hétéroclite et va du secrétaire général du parti communiste aux islamistes pro-iraniens. Pourtant, tous les membres de ce bloc sont identifiés par les Américains comme étant avant tout et surtout des chiites, qu’ils le veuillent ou non.
Mais il y a plus. L’une des difficultés auxquelles les États-Unis sont confrontés en Irak vient du fait qu’ils avancent en ordre dispersé. Plus qu’un jeu à deux entre les Américains et les Irakiens, nous assistons en réalité à une partie à trois entre les Irakiens, certains Américains (les néoconservateurs, les interventionnistes, le Pentagone, la Maison-Blanche) et d’autres Américains (les libéraux, les isolationnistes, le Département d’État, voire la CIA), dans laquelle les Irakiens ne sont pour l’instant qu’un simple faire-valoir qui sert a confirmer ou à infirmer les thèses des uns et des autres, et à renforcer ou à fragiliser leurs stratégies respectives de pouvoir.
Une autre difficulté, pour les Américains, vient du fait qu’ils voudraient bien être aimés. Le soldat américain de base est convaincu que sa croisade est juste, et ses maîtres à Washington sont persuadés qu’il leur suffit d’apparaître, comme ça, pour lier l’Autre tel quelque roi-magicien. Contrairement aux Israéliens ou aux Anglais, les Américains ont besoin d’être appréciés. Ils refusent qu’on mette leur bonne foi en cause. Or, cela ne s’est pas passé tout à fait comme ils le souhaitaient : d’un côté, l’accueil réservé par les Irakiens aux militaires américains a fait à ces derniers l’effet d’une douche froide, de l’autre, leurs maîtres à Washington se sont rendu compte que la gestion postconquête requiert des qualités de prêtres-juristes que les rois-magiciens qu’ils sont ne possèdent pas nécessairement.
Les Américains ont peut-être aussi un problème avec la déterritorialisation. Après tout, ce sont des impérialistes, non des colonialistes. Leur engagement physique demeure relativement limité. Ils rechignent à l’expatriation. On peut le comprendre, d’ailleurs, puisqu’ils sont déjà des expatriés, d’Europe ou d’Asie. Ils semblent avoir un rapport plus spatial que territorial au monde externe. Ils reproduisent militairement leurs incursions dans l’espace. Chacune de leurs aventures spatiales met en scène des dizaines de milliers d’hommes au sol (savants, techniciens, bureaucrates) et juste une poignée dans l’espace. C’est un modèle pyramidal d’expansion, avec une base extrêmement large et bien ancrée dans le sol (américain), des relais-bulles sécurisés, et une toute petite pointe de rien du tout qui s’élève vers le ciel, ou qui s’avance vers l’Autre. Début septembre 2003, dans un article paru dans The Weekly Standard, deux des chefs de file du courant néoconservateur plaidaient désespérément pour l’envoi de troupes supplémentaires en Irak. « Le fait est, écrivaient-ils, qu’il n’y a simplement pas assez de bons [good guys] qui pourchassent les méchants [bad guys]. » L’interface humaine entre les Etats-Unis et le monde extérieur demeure, pour l’instant, minimaliste. Sans vouloir porter un jugement de valeur sur les néoconservateurs, ni mettre en doute leur sincérité, on est en droit de se demander s’ils n’auraient pas les yeux plus gros que le ventre. Une croisade, on la fait avec des Croisés, non avec des machines.
Dans le même ordre d’idées que la dichotomie que vous proposez, il y a ce que Pierre Hassner appelle « la dialectique du bourgeois et du barbare » : si les États-Unis souhaitent embourgeoiser les barbares, il faut qu’ils se barbarisent eux-mêmes (qu’ils fassent preuve de valeurs guerrières, qu’ils soient capables d’instaurer l’ordre, etc.), ce qui souligne l’impossibilité d’une stricte dichotomie. Cette dialectique bourgeois/ barbare se superpose-t-elle à l’idée d’intérieur/extérieur ?
Dans un sens, oui. Je pense néanmoins que l’intérêt de la manoeuvre réside, non pas dans l’atteinte de l’objectif affiché (réussir à embourgeoiser le barbare), mais dans la seule poursuite du but (viser à embourgeoiser le barbare). Les États-Unis ne souhaitent peut-être pas tant embourgeoiser les barbares que tendre à les embourgeoiser, allant à chaque fois jusqu’à la limite, sans pour autant dépasser le seuil. Rappelez-vous qu’à la sortie de la première guerre d’Irak.
Colin Powell justifiait la décision de Washington de ne pas pousser jusqu’à Bagdad en arguant que la formation sociale irakienne était telle, que le renversement de Saddam Hussein aurait amené au pouvoir un clone de ce même Saddam : un autre dictateur. Autant dire qu’il y a une dizaine d’années, le secrétaire d’État américain était loin d’être convaincu que les États-Unis pourraient apporter la démocratie aux Irakiens. Rappelez-vous aussi qu’à l’époque, alors que leurs forces se trouvaient à portée de canon de la capitale irakienne, les États-Unis avaient sans cérémonie lâché la majorité chiite qui s’était soulevée contre le régime. Je ne vois pas ce qui aurait pu changer au cours des dix dernières années en Irak et qui ferait que la démocratie, telle que nous la concevons, y serait soudain devenue possible. Pas plus que je ne vois pourquoi les Américains réussiraient, à des milliers de kilomètres de chez eux, ce qu’ils n’ont pas pu réussir à leur frontière : l’Amérique centrale est-elle démocratique ?
Même si, comme le déclarent les Américains, on voudrait sincèrement sauver le « fou » et guérir le « lépreux », on ne le pourrait pas, ne serait-ce que pour des raisons financières. Nos économies sont en effet en crise. Nous sommes dans l’incapacité de financer des expéditions militaires durables. L’Irak coûte déjà mille dollars par an à chaque foyer américain. Nous sommes de même dans l’incapacité financière de faire de chaque « barbare » un consommateur. Nos dirigeants ont déjà assez de mal à maintenir le pouvoir d’achat de leurs propres électeurs-consommateurs.
D’ailleurs, même si l’on réussissait à embourgeoiser les barbares, rien ne dit qu’ils adopteront autre chose que nos valeurs de pure consommation et qu’ils ne délaisseront pas le reste. Récemment, en Malaisie, un tribunal islamique a jugé légal la répudiation par homme de son épouse par simple message texto envoyé sur un téléphone portable. On voit comment les produits bourgeois de consommation peuvent être dévoyés et servir des buts fort éloignés des pratiques démocratiques. Et que dire de la jet-set terroriste islamiste responsable du 11 septembre ? Contrairement au terrorisme islamiste régional, qui recrute des gens simples issus de milieux défavorisés, cette jet-set est constituée de barbares aussi cosmopolites qu’embourgeoisés.
Embourgeoiser les barbares, leur inculquer nos valeurs démocratiques : sommes-nous certains de le vouloir ? Notre contrat social, qui repose sur la répartition plus ou moins équitable, à l’intérieur, de richesses produites pour l’essentiel à l’extérieur, y survivrait-il ? Pourrions-nous continuer à consommer comme nous le faisons sans l’électroménager et l’électronique produits à bas prix en Asie du Sud-Est, sans les tapis d’Orient tissés par les enfants-esclaves pakistanais, sans les oléoducs construits en Birmanie par le travail fore encouragé par les pétroliers ? J’en doute. En 1917, au plus fort de la Grande Guerre et comme pour remercier les cinq cent mille Indiens qui participaient aux combats dans les rangs de l’armée britannique. Londres annonça un train de réformes politiques visant à donner plus de responsabilités aux Indiens dans la gestion de leur propre pays. Aussitôt la victoire assurée, l’Empire oublia sa promesse et introduisit plutôt des lois répressives qui portaient atteinte aux libertés civiques. Il y a à mon avis une relation de cause à effet entre démocratie et impérialisme, et je doute que nos démocraties, dans leur forme actuelle, puissent survivre à notre impérialisme. Ne nous leurrons pas, notre démocratie est en réalité réservée aux seuls Athéniens, ou aux seuls Romains : il y a les citoyens de Rome, il y a les Italiens (ainsi, les nations qui bénéficieront de l’élargissement de l’Union européenne), et il y a tous les autres, c’est-à-dire l’écrasante majorité du genre humain.
Un pouvoir démultiplié dans un monde dépolitisé
Voire expressions dual containment rappelle le containment dans la guerre froide, dont les Etats-Unis Étaient les acteurs. Or, dans notre dichotomie on perçoit mal qui est l’acteur de ce dual containment. Est-ce l’État ? Si c’est le cas, n’est-ce pas lui accorder une place trop importante alors que les acteurs non étatiques sont la force émergente de système international ? En d’autres termes, quel est ce « pouvoir » dont vous parlez ?
Michel Foucault écrivait que le pouvoir n’existe pas. Il y a plutôt du pouvoir. Et il est toujours à prendre. Ce pouvoir peut exister a sein de l’appareil d’État, comme hors de lui. Vous avez néanmoins raison de souligner le rôle des acteurs non étatiques comme force émergente du système international. On pense aux ONG, aux multinationales, aux pétroliers, aux oligarques russes. Prenez les compagnies pétrolières : après s’être laissées dicter leurs conditions par les pars producteurs de pétrole entre 1970 et 1990, elles ont fusionné et repris l’avantage. Prenez les ONG : certaines, comme Transparency, ont pu introduire des législations qui ont modifié le mode de fonctionnement du commerce international ; d’autres, comme Amnesty, ont influencé la politique étrangère du président Clinton. Prenez les oligarques russes : dans les années 1990, ils ont fait la pluie et le beau temps dans la nouvelle Russie.
L’âge d’or de ces acteurs non étatiques se situait en réalité entre la chute du Mur et le 11 septembre. Durant une douzaine d’années, c’est la, plus que dans les appareils d’État, que se générait l’essentiel du pouvoir. Mais le 11 septembre a projeté à nouveau à l’avant-scène l’exercice de la violence légitime à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières, et l’État a repris du poil de la bête. Qui parle encore de droits de l’homme et de bonne gouvernance dans la nouvelle administration américaine ? Qui, des grands pétroliers, oserait aujourd’hui s’engager sur l’Irak sans l’aval de Washington ? Qui parierait sur l’ONU sans la bénédiction des États-Unis ? Oui miserait sur Yukos sans l’accord du Kremlin ? C’est une période de flux et d’incertitude, qui favorise les grands appareils d’État. En attendant que l’espace international se strie à nouveau, les acteurs non étatiques ne pourront générer du pouvoir que dans la mesure où ils se couleront dans la stratégie des castes qui dominent ces appareils d’État.
Les acteurs non étatiques qui ont aujourd’hui le vent en poupe, on les trouve donc surtout parmi ceux qui collent le mieux aux grands appareils d’État et à leurs projets sécuritaires et guerriers. Je pense. bien sûr, aux grands groupes de défense (Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, EADS, British Aerospace Systems, Thalès), mais aussi à des noms bien moins connus. On assiste en effet à une privatisation rampante de la guerre et de la sécurité, notamment par le truchement des CMP (compagnies militaires privées), entreprises en plein essor qui ne sont pas sans rappeler les lansquenets, les Suisses, et autres compagnies mercenaires de la Renaissance. En France, aujourd’hui, la seule unité militaire qui refuse du monde est la Légion étrangère. Le plan Colombia élaboré par Washington pour combattre les cartels de la drogue repose pour T’essentiel sur des CMP, et non sur du personnel militaire américain. De ce fait, la fiction du 0. K. (Zero Killed) peut être maintenue, et le Congrès n’a même pas besoin d’être informé. Durant la première guerre d’Irak, un militaire sur cinquante déployés sur le terrain a été un contractant privé : soit 2 % des forces engagées. Douze ans après, il y en a un pour dix militaires américains : soit 10% des forces actuellement engagées en Irak. Pour l’instant, les acteurs non étatiques les plus intéressants à suivre ne sont ni les grandes ONG, ni même les multinationales que tout le monde connaît, mais les CMP comme DynCorp. Vinnell Corp, ARINC, KBR, MPRI, Kroll, ICI, PAE, AirScan ou TASK International, toutes prestataires de main-d’oeuvre, de know-how et de services sécuritaires et guerriers. Il y a là de quoi nous faire réfléchir sérieusement sur le monopole de la violence légitime.
On assiste aussi à une privatisation de la paix, conséquence logique de la privatisation de la guerre. Au Liberia, c’est une société privée qui devrait assurer les services de support logistique et humanitaire. Un groupement de CMP a de même proposé les services d’une force privée de maintien de la paix en appui aux opérations de l’ONU dans la République démocratique du Congo. Les opérations de maintien de la paix et les opérations humanitaires vont dépendre sans cesse plus de ces privés. Cela doit nous faire réfléchir sur la croisade des néoconservateurs américains : une croisade, on la fait avec des Croisés, non avec des mercenaires.
Qu’en est-il de la vie politique dans votre dichotomie intérieur/extérieur ? En effet, si l’on considère le monde de l’intérieur, on assiste à une sorte de dévitalisation de la lutte pour le pouvoir, puisque l’autre n’est qu’un rival, donc légitime. De l’autre côté, on pourrait croire que la politique se trouve à l’extérieur, là où la présence d’un ennemi justifie cette lutte ; mais, à l’extrême, on risque de tomber dans la guerre civile. Où se trouve donc la politique ?
Il y a effectivement absence de politique dans l’aire de l’extérieur, qui relève davantage pour l’instant du domaine de l’armée et de la police que du domaine de la politique. Il y a de même une dévitalisation de la politique et de la lutte pour le pouvoir à l’intérieur. Cette dévitalisation de la politique à l’intérieur n’est d’ailleurs pas sans rapport avec le fait que vous évoquiez, à savoir que l’Autre n’y est pas un ennemi sans légitimité, mais un rival légitime. Les anciens clivages, comme gauche et droite, libéral et socialiste, européen et souverainiste, se confondent désormais dans le brouillard du doute et de l’incertitude. On ne sait plus ce qu’on est, et on a donc du mal à identifier l’Autre comme un ennemi ou un rival pérenne. En attestent le fort taux d’abstention aux scrutins électoraux, le désintérêt des jeunes pour la politique, les difficultés de recrutement auxquelles font face les forces armées, l’incapacité dans laquelle se trouvent les services de renseignement d’attirer des « preneurs de risques », ou l’entrée des fonds de pension américains sur les bourses européennes. On a l’impression que désormais, à l’intérieur, tout se vaut. C’est bonnet blanc et blanc bonnet. En France, des gens de gauche votent Chirac ; au Royaume-Uni, le socialiste Tony Blair est surnommé Tory Blair; à la Bourse de Paris, 43 % des avoirs du CAC 40 sont détenus pas des étrangers ; chez le « Français » Total, 72 % des actions sont entre les mains de capitaux étrangers. On ne sait plus qui est qui, ni qui est quoi. Tout contribue à l’étiolement identitaire, à la démobilisation politique et à la dévitalisation de la lutte pour le pouvoir.
Mais est-ce à dire que la politique n’existe plus ? qu’il n’y a plus de lutte pour le pouvoir mais une seule course aux places, aux privilèges, aux signes extérieurs de richesse ? Au pire, l’immonde rat race, au mieux, un jeu de chaises musicales ? Je ne le crois pas. La lutte pour le pouvoir existe, mais elle change de visage. Et, ne s’étant pas encore habituée à son nouveau visage, elle en a honte et s’en cache. À mesure que la menace extérieure (terrorisme, armes de destruction massive) reculera, on verra les tensions entre les nations de l’intérieur s’exacerber (entre la France et les États-Unis, par exemple, entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, entre les puissances continentales et les puissances navales), et la politique et la lutte pour le pouvoir reprendront leurs droits, selon de nouvelles règles que les événements déterminent d’ores et déjà. Il faudra alors, pour se battre à armes égales, des outils neufs. Les outils actuels sont en effet trop visibles et consensuels pour être sollicités efficacement dans cette nouvelle lutte pour le pouvoir. Ils ont trop flirté avec l’Autre pour pouvoir, du jour au lendemain, le traiter en ennemi. Il en va ainsi de nos services secrets (somme toute si peu secrets), qui font aujourd’hui un travail de police et de liaison bien plus qu’un travail clandestin de renseignement. Ils sont pris dans trop de comités transnationaux de concertation et de coordination. Ils ont effectué trop d’opérations conjointes avec les services « amis ». Ils sont trop transparents. Trop bien connus. Trop politiquement corrects. Trop domestiqués. En un mot, ils n’ont plus rien d’une machine de guerre. Or, pour être à la hauteur dans la nouvelle lutte qui s’annonce pour le pouvoir, et pour défendre ses intérêts contre les amis-rivaux de l’intérieur (défendre Airbus contre les menées de Boeing ou vice versa, défendre le Français contre l’Anglais ou l’inverse, défendre la Politique agricole commune, défendre les subventions fédérales à l’industrie aéronautique américaine, maintenir la politique protectionniste de l’acier, contrer les subventions de Séoul aux chantiers navals coréens), ce qu’il faut, c’est une vraie machine de guerre.
Aux États-Unis, tout porte à croire qu’une telle machine de guerre est d’ores et déjà en place. Pas de ce côté-ci de l’Atlantique, où l’on tergiverse encore, où l’on adopte des demi-mesures, et où l’on semble se complaire dans la stratégie du « un pas en avant, deux pas en arrière ». Pourquoi ? À cause d’un mélange de peur et de culpabilité : peur de provoquer l’ami américain, et culpabilité à l’idée d’envisager quoi que ce soit qui n’ait pas une dimension universelle. Convaincus que ce qui est bien pour eux l’est aussi pour le reste du monde, les Américains peuvent se permettre d’être à la fois patriotiques et universels, à la fois chauvins et altruistes. Les islamistes aussi, d’ailleurs. Plus les Allemands. Plus les Français. Et pas encore les Européens. D’où des problèmes de culpabilité et de mauvaise conscience. Or, on sait, depuis Nietzsche, où peuvent mener la mauvaise conscience et le sentiment de culpabilité. De ce côté-ci de l’Atlantique, on attend toujours le roi-magicien qui osera.
On pense aussi à la thèse de Fareed Zakaria (l’Avenir de la liberté, chez Odile Jacob), qui analyse la tendance à l’« illibéralisme » vers lequel tendraient nos démocraties : un système politique dans lequel on valorise le rapport direct entre peuple et pouvoir (élections, référendum...), plus que les principes mêmes du libéralisme, à savoir l’État de droit. Mais quelles sont, par exemple, les garanties démocratiques du multipartisme (on pense à l’Algérie) ? Peut-on toujours parler de politiques de la liberté ?
Fareed Zakaria a bien raison de dire que ce n’est pas en instaurant le multipartisme et un système du type « un homme, un vote » que l’on installera la démocratie dans des pays comme l’Irak ou le Nigeria. Ce qu’on appelle un peu trop facilement démocratie, dans certains pays, n’est en réalité rien de plus qu’un équilibre de mini-autocraties, résultant de l’atomisation d’un pouvoir despotique antérieur (ainsi le faux multipartisme qui succéda, en Algérie, au système du parti unique). La tentation de la démocratie participative prime néanmoins sur d’autres considérations, telles que la constitution d’un État de droit ou la transformation des rapports sociaux en vue, précisément, de changer la politique. Notre désir d’exporter la démocratie est en partie une survivance de la guerre froide. C’est un mot d’ordre auquel on avait cru durant la période de rivalité entre les blocs communiste et occidental, et que l’on reconduit aujourd’hui à l’égard de sociétés qui n’ont rien à voir avec celles de l’ancien bloc de l’Est. Ce n’est plus de la démocratie, mais de la démagogie. Ce même désir d’exportation de la démocratie est aussi mû par notre incapacité a accueillir chez nous ceux qu’on dit vouloir civiliser et convertir à nos valeurs. Il y a corrélation entre ces murs que nous érigeons un peu partout, depuis la chute du Mur, afin de garder les autres à distance, et notre souhait d’apporter notre démocratie jusqu’à leur porte. Il y a assurément corrélation entre l’incapacité dans laquelle les néoconservateurs se trouvent de remplir leur mission purificatrice et salvatrice sur le territoire même des États-Unis, et leur volonté acharnée d’exporter cette même mission aux quatre coins du globe. Ce n’est plus de la démocratie, mais de l’impérialisme.
Le principe de la démocratie participative offre en fait l’avantage d’être simple, intelligible, accrocheur et clair. C’est un slogan. Il est plus facile à « vendre » en interne (à l’opinion, à la presse, aux élus) que ne le serait l’idée de mettre en place un véritable État de droit. La mère du soldat américain tombé à Bagdad aimerait pouvoir dire que son fils est mort pour la liberté, non qu’il est mort pour l’article 3 alinéa b de la nouvelle Constitution irakienne. Dans ce même ordre d’idée, Churchill avait insisté pour changer le nom de code initialement choisi pour le débarquement de Normandie, lui préférant celui d’Opération Overlord. Pourquoi ? Parce qu’il ne pouvait pas se résigner à devoir écrire aux parents d’un soldat tué en leur disant que leur fils était mort lors d’une opération au nom ridicule et manquant franchement de gravitas, comme Pistush ou Foggy Bottom.
L’émergence d’un terrorisme rhizomique
Peut-on considérer le terrorisme comme un paradigme inédit de « l’ordre mondial » ? Ou bien pouvait-on en déceler, dans la guerre froide, les premières esquisses ? Si l’on définit le terrorisme comme une esquive de la conflictualité politique, ne permet-il pas de mieux comprendre la dichotomie intérieur/extérieur ?
Là, on touche directement au monopole de la violence légitime. Pour l’instant, deux nations, les États-Unis et Israël, se détachent du lot et en usent allégrement hors de leurs frontières. En face, le terrorisme fait figure de réponse du plus faible. Le terrorisme n’est d’ailleurs que l’une des formes possibles de réponse à ce monopole de la violence. Il en est d’autres : jacquerie, banditisme, délinquance, vandalisme, anarchisme, désobéissance civile.
Le terrorisme post-guerre froide est inédit, en ce sens qu’il ne se confond plus avec le terrorisme d’État (ainsi le Jihad islamique dans les années 1980) ou avec le terrorisme revendicatif (ainsi l’ETA, ou le Hamas palestinien) hérités de l’ancien ordre mondial. Le 11 septembre a en effet favorisé l’émergence d’un terrorisme décentré, plus difficile à appréhender, qui coexiste néanmoins avec les « terrorismes d’ancien régime ». On continue cependant de parler d’Al-Qaida comme d’une sorte d’Islamintern centralisé qui expliquerait toute la violence politique d’aujourd’hui. Je ne nie pas l’existence d’Al-Qaida, mais de la à croire que tous les attentats, de l’Indonésie au Maroc en passant par le Kenya, le Yémen et la Tunisie, sont planifiés et exécutés par ce groupe... Toute cette violence n’est pas organiquement liée à Al-Qaida. Et pourtant, on persiste à crier « Al-Qaida, Al-Qaida », comme qui dirait « Satan ». Pourquoi ? Parce que l’appareil d’État fonctionne sur un mode de pensée arborescent et projette son mode de pensée et de fonctionnement sur l’Autre. On s’imagine que les groupes terroristes sont, tout comme l’appareil d’État qui les combat, arborescents, à l’image de ces branches et de ces racines qui se déploient de part et d’autre d’un tronc central. En Irak, quatre mois après la chute de Bagdad, les Anglo-Américains persistaient encore à voir la main de Saddam Hussein et des restes de son appareil d’État derrière tous les attentats visant les forces de la coalition. Lorsque l’on appréhende la violence terroriste, il faut garder l’esprit ouvert et accepter que diverses formes de terrorisme peuvent coexister dans le même environnement. Ainsi, en Irak aujourd’hui, nous avons à faire, en même temps, à un terrorisme rhizomique (une résistance armée atomisée qui se développe indépendamment de l’ancien appareil d’État) et à un autre terrorisme arborescent je pense aux attentats contre l’ambassade de Jordanie et contre le siège de l’ONU durant l’été 2003, qui semblent relever du terrorisme d’État). À trop vouloir privilégier un modèle de terrorisme, on s’empêche de comprendre.
Al-Qaida, pour reprendre cet exemple, était peut-être en voie d’arborescence lorsque le régime taliban était encore en place en Afghanistan. Mais depuis la chute des talibans, les terroristes islamistes, sevrés, se sont émancipés, fonctionnant sur un mode beaucoup plus rhizomique. Le tout est de savoir si ceux parmi les islamistes qui passent aujourd’hui à l’action violente et plus ou moins efficace le font sous l’effet d’un catalyseur externe, d’un fait générateur exogène (un peu comme ces agents dormeurs qu’on voit dans les films d’espionnage, qu’un appel téléphonique réveille), ou si le fait générateur n’est pas plutôt endogène et propre au terroriste en herbe et à son groupe restreint de proches et d’amis. En d’autres termes, quand un islamiste indonésien ou marocain perpétue un attentat suicide, le fait-il après avoir été « activé » par un cerveau central, ou bien est-il mû par des considérations plus personnelles et plus circonscrites ? On n’a toujours pas pu prouver l’existence d’un lien organisationnel entre les terroristes de Bali, de Djerba ou de Casablanca (entendus comme membres), et Al-Qaida (entendue comme cerveau). Nous entretenons néanmoins volontiers la fiction d’un tel lien. Nous refusons d’accepter l’évidence. Nous persistons à vouloir traiter une menace terroriste de type rhizomique comme si elle était de type arborescent. Aujourd’hui, Al-Qaida est plus un modèle idéalisé qu’une organisation aux ramifications internationales. Al-Qaida, c’est, pour certains, la Révolution, tout comme Oussama Ben Laden serait, pour certains, le Che. Il ne servirait à rien de décapiter Al-Qaida : les rhizomes qu’elle a suscités continueront, nonobstant, d’exister.
Pour s’attaquer à une organisation arborescente, il suffit d’en attraper un bout. Trouvez le tronc, et puis descendez, à partir du tronc, jusqu’aux différentes branches et racines. Ou alors, inversement, saisissez-vous d’une branche et suivez-la jusqu’au tronc central. C’est relativement aisé. Mais un terrorisme rhizomique, cela ne fonctionne pas du tout comme cela. Contrairement à un arbre, dans un rhizome, il n’y a ni tronc central, ni racine ou branche privilégiée. Toutes les tiges se valent, et une bifurcation, vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas, peut intervenir à tout moment et à n’importe quel point. Coupez une tige du rhizome, et le reste continuera sa vie comme si de rien n’était. Contrairement au traitement du terrorisme de type arborescent, le traitement du terrorisme rhizomique nécessite de traiter le sol même : le vivier où le rhizome se nourrit. A moins de traiter le vivier, on ne peut pas vaincre le rhizome. Il faut réussir à isoler le rhizome de son vivier.
On peut par exemple supposer qu’Al-Qaida trouvera un écho chez, disons, cinq mille musulmans de Bradford, en Angleterre. Ces cinq mille Britanniques musulmans pourront avoir de la sympathie pour Oussama Ben Laden, mais ils ne feront, finalement, rien de plus que souhaiter secrètement qu’il ne soit pas capturé par les Américains. Sur ces cinq mille, cinq cents changeront peut-être de valeurs et de mode de vie, se découvriront plus musulmans que britanniques, fréquenteront assidûment la mosquée du coin, et demanderont à leur femme ou à leur soeur de se voiler. Sur ces cinq cents, une poignée de désespérés passera à l’action violente. Le travail sur le vivier consistera donc à oeuvrer à baisser le nombre initial des cinq mille sympathisants, à réduire par conséquent le nombre de cinq cents zélotes néophytes, et à décourager les desperados parmi eux de franchir le pas et de se muer en bombes humaines.
Or, paradoxalement, les organismes qui, dans nos sociétés, seraient les plus à même de traiter cette menace rhizomique sont en perte de vitesse et en mal de moyens. Je pense aux ministères de l’Éducation, de la Culture, des Affaires sociales, de la Santé, du Travail, du Logement et du Sport. Ceux-là sont bien mieux équipés que les ministères de la Défense ou de l’Intérieur pour gérer les rhizomes. Les militaires et les policiers, eux, sont plus formés au traitement des menaces arborescentes. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est que, faute de moyens et d’appétit, les ministères « sociaux » se désengagent, permettant ainsi au rhizome de se développer dans le vivier. On rameute ensuite les militaires et les policiers, et on les implore de neutraliser un rhizome qu’ils n’arrivent même pas à appréhender intellectuellement.
Du citoyen producteur au consommateur-rentier
La dichotomie intérieur/extérieur est perceptible au niveau national, avec les inclus et les exclus du système. N’y a-t-il pas eu un glissement des problèmes internes vers l’international, du centre vers la périphérie ?
Ce glissement du centre vers la périphérie est dû en partie au manque d’autorité politique, et en partie aussi à l’effondrement de l’Union soviétique, qui aura permis à l’Occident d’agir impunément à l’extérieur. Aurait-on pu imaginer la dernière guerre d’Afghanistan, ou celle d’Irak, si les Soviétiques étaient encore là ? C’est en ce sens que le 11 septembre aura été le déclencheur d’un choc bien antérieur et datant de la fin de la guerre froide. Le vide laissé par l’Union soviétique et par le pacte de Varsovie est à présent rempli par l’Occident lui-même, qui se laisse d’autant plus aisément tenter qu’il peine à résoudre ses propres problèmes internes. Le Premier ministre britannique s’est d’autant plus volontiers lancé dans la croisade antiterroriste et dans l’aventure irakienne qu’il lui manque l’autorité nécessaire pour s’attaquer, chez lui, à la crise des transports, à celle du système de santé, à celle du droit d’asile ou à l’adoption de la monnaie unique européenne.
En réalité, les élites politiques ont aujourd’hui bien du mal à gérer le citoyen. Ou, plus exactement, à gérer un citoyen en pleine mutation. Le citoyen en Occident change en effet subrepticement de statut. Du producteur qu’il avait été depuis la Révolution industrielle, il se mue graduellement en consommateur. Dans les années 1930 déjà, Keynes estimait que, dès la première moitié de ce siècle, la croissance économique aurait réussi à créer assez de richesses pour satisfaire une majeure partie de nos besoins matériels et qu’alors, l’hédonisme se répandrait. Et c’est un fait qu’en Europe, du moins, le temps de travail tend à se raccourcir alors que les gens pensent bien plus à la qualité de la vie qu’à la croissance. Récemment, au Royaume-Uni. les autorités n’ont pas hésité à sanctionner un hôpital de l’assistance publique accusé de « soumettre ses employés à un stress excessif ». Pour tout dire, on a de moins en moins besoin des citoyens comme producteurs de valeurs et de richesses. Mais on a besoin de les coopter en valorisant leur statut de rentiers. En France, on voudrait bien donner plus d’aides aux fermiers, à condition, surtout, qu’ils ne produisent pas plus; on voudrait bien continuer de payer les fonctionnaires, même s’ils restent en réserve de la République; on voudrait bien continuer à payer les ouvriers, même s’ils ne sont pas très compétitifs; on voudrait bien donner plus d’allocations aux chômeurs afin qu’ils continuent de se taire; on voudrait bien donner leur retraite aux vieillards afin de gagner leur suffrage. Mais on y arrive de moins en moins.
Dans cette perspective, il est intéressant de noter que les grèves qui « font mal », aujourd’hui, sont celles qui perturbent la consommation, non celles qui perturbent la production. Tout comme les mineurs britanniques dans les années 1980, les ouvriers métallurgistes français pourraient faire grève des mois durant sans pour autant inquiéter le pouvoir. Tout au plus réussiront-ils à inquiéter les élus de leurs circonscriptions. En revanche, il suffit que les intermittents du spectacle fassent grève pour que le gouvernement panique. De même, quand le gouvernement français injecte régulièrement de l’argent frais dans une entreprise en difficulté comme Giat, il le fait surtout pour la sauvegarde de l’emploi. L’emploi (comprenez : les salaires) est aujourd’hui le maître mot. En ce sens, ce ne devrait plus être au ministère des Finances de renflouer régulièrement une entreprise publique déficitaire, mais plutôt au ministère des Affaires sociales. Car ce qu’on tente de maintenir à tout prix, c’est moins la production, ou certaines compétences stratégiques, que le pouvoir d’achat. Pourquoi ? Parce que le citoyen, qui a le droit de vote et donc de sanction, devient rentier. Rentier, et grand consommateur de biens, de services, de médicaments, de culture, de loisirs, de voyages, de mots, d’images et de rêves. L’impasse actuelle des élites politiques réside en partie dans le fait qu’elles peinent à contenter ce citoyen-rentier. Elles peinent aussi à le convaincre que ses droits légitimes de citoyen ont un pendant tout aussi légitime : ses devoirs de citoyen. La patrie n’est plus « vendeuse ». On a de plus en plus de mal à convaincre les gens de faire des sacrifices ou de s’engager dans la politeia. Les élites multiplient donc les mécontents, et se lancent ensuite dans des diversions guerrières ou sécuritaires afin de galvaniser le citoyen et lui faire oublier quelque temps ses frustrations de rentier-consommateur. Car les aventures guerrières et sécuritaires offrent le grand avantage de produire des images et du discours : images et discours sur la guerre et sur la violence qu’on jette volontiers en pâture à la plèbe. A la mode du pouvoir en pente douce, répond celle du citoyen couch potato.
On s’aperçoit qu’il est de plus en plus demandé à l’État une politique de sécurité, qui accompagne cette fragmentation sociale…
Plus il y aura fragmentation, plus on mettra l’accent sur la sécurité. Dans les Morts de la Saint-Jean, Henning Mankell décrit en ces termes l’attitude du policier à l’égard de l’insécurité grandissante : « Un bon policier espère que le crime va diminuer. Mais il sait que c’est peu probable. Aussi longtemps que la société restera ce qu’elle est, avec ses injustices incluses, condition indispensable au jeu des forces de la mécanique sociale. » Une politique de sécurité a pour but d’organiser cette fragmentation, de la gérer, et surtout de la faire accepter par ceux qui en font les frais. A la question de savoir ce que fait au juste le ministère de l’Intérieur, un ancien ministre français répondait un jour que ce ministère fait tout ce que les autres ministères ne veulent pas faire. On pourrait ajouter : tout ce qu’ils ne peuvent plus faire. De nos jours, on demande au ministère de l’Intérieur de pallier les carences des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, bien sûr, mais surtout celles des ministères dits « sociaux ». On le charge à toute force. Il intervient là où les autres défaillent. Demain, avec les pensions et les retraites qui s’effritent, nous risquons en sus d’avoir des délinquants du troisième âge.
Les raisons du tout-sécuritaire
Pour l’élite politique, miser sur le tout-sécuritaire plutôt que sur le tout-social ou le tout-économique est d’ailleurs un pari gagné d’avance. Car le pouvoir n’y est pas tenu à une obligation de résultat. Contrairement à une politique économique ou sociale, une politique de sécurité n’a pas à être couronnée de succès. Elle peut (elle doit, même) être permanente. Pensez au Patriot Act voté par le Congrès dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre. Deux ans après, alors que la peur d’attaques terroristes aux Etats-Unis recule, le Patriot Act suscite des critiques de plus en plus acerbes tant au Congrès qu’au sein de l’opinion (plus de cent cinquante villes américaines ont déjà passé des résolutions le condamnant), contraignant l’attorney general, John Ashcroft, à faire une tournée du pays dans le but de le défendre. Inversement, pensez à la politique du gouvernement israélien. Elle n’a pas amené plus de sécurité aux citoyens. Cela n’a pourtant pas empêché ces mêmes citoyens de reconduire ce gouvernement aux dernières élections. L’insécurité suscite une peur qui provoque un vote d’affirmation plus qu’un vote de solution. On ne reconduit pas un gouvernement prônant le tout-sécuritaire parce qu’il aurait réussi à réduire l’insécurité. On le reconduit parce que l’insécurité persiste. De même, on ne reconduit pas un gouvernement prônant la guerre préventive parce qu’il aurait réussi à neutraliser une menace externe. On le reconduit plutôt parce que la menace perdure. Les électeurs britanniques n’ont-ils pas remercié Churchill aussitôt la menace nazie évaporée, et les électeurs américains George Bush senior aussitôt le Koweït libéré ?
C’est ainsi que naissent et que s’incrustent les, castes. On est en pleine dérive. Dérive, en ce sens que ceux qui vivent du mal qu’est la violence sont plus nombreux que ceux qui en sont les victimes. Il y a aujourd’hui bien plus de gens qui prospèrent du fait de la violence que de gens qui en pâtissent. Hommes politiques, militaires, mercenaires, agents secrets, agents de sécurité, policiers, experts, consultants, avocats, journalistes, conférenciers, intellectuels, cinéastes, romanciers : des carrières, des renommées, et parfois même de vraies fortunes, se font autour de la violence et sur le dos de ses victimes.
Le rôle théologico-politique de l’État — qui nécessitait l’articulation d’une autorité quasi transcendante à un pouvoir — est par là même remis en question : on demande à l’État d’être un pouvoir, alors que celui-ci fait de moins en moins autorité…
Il fut un temps où l’État fonctionnait harmonieusement en usant de sa seule autorité, qu’elle soit d’origine divine ou humaine. Aujourd’hui qu'il ne fait plus autorité, il fait volontiers usage de ses instruments de pouvoir, oubliant un peu trop vite qu’il n’est de véritable pouvoir que celui dont on n’use pas. Il y a corrélation entre la perte d’autorité de l’État et le renforcement de son appareil répressif. Une image me vient à ce propos, un son aussi, que j’évoque ici à titre anecdotique : c’est l’image du bobby londonien, et le son des sirènes de la police britannique. Le bobby faisait jadis sa ronde seul et nan arme, puisant son immunité dans la seule autorité que lui conférait son uniforme. A cette époque-là, les sirènes des voitures de police tintaient dans les rues de Londres comme les cloches d’une église. Plus maintenant. À présent, les policiers patrouillent dans certains quartiers de Londres bardés, harnachés et équipés comme s’ils étaient à Bassora, et leurs sirènes ululent comme pour annoncer la venue de l’Antéchrist. Il fut un temps où l’État, confiant en lui-même, se voulait rassurant. Plus maintenant. A présent, il a peur. Et, ayant peur, il ne cherche plus qu’à faire peur.
Vous avez raison de dire que c’est l’autorité qui est la clef de tout. Au risque de paraître cynique, je dirais que ce qui est surtout gênant chez nos princes, ce n’est pas tant le fait qu’ils mentent si naturellement, mais que, manquant d’autorité, ils sont dans l’obligation de mentir afin d’emporter l’adhésion. Dans le dernier conflit irakien, des chef » imprégnés d’un véritable « sens de mission », apparemment convaincus de la justesse de leur cause et qui assurent vouloir fonder leur action politique sur la foi, ont dû, pour convaincre, mentir quant à l’implication de l’Irak dans le terrorisme et dans la fabrication d’armes de destruction massive. Des princes « chrétiens » ont eu recours à de faux miracles pour amener le peuple à faire acte de foi en eux. Ce n’est plus Jésus, c’est Simon le magicien. C’est à mon avis cela, bien plus que le mensonge en lui-même, qui est désolant.
Si l’on devait mesurer l’autorité de tel ou tel de nos princes, on pourrait probablement le faire à l’aune de ceux à qui il n’aurait justement pas besoin de mentir pour qu’ils acceptent de le suivre sur tel ou tel dossier (que ce soit la législation anti-ETA pour José María Aznar, la guerre d’Irak pour Tony Blair, ou la réforme des retraites pour Jean-Pierre Raffarin). En d’autres termes, on pourrait mesurer l’autorité d’un prince à l’aune de ceux auprès de qui il fait autorité nonobstant la rationalité de ses arguments ou la justesse « objective » de sa cause. Ce faisant, on pourrait tracer les contours de sa base naturelle de pouvoir (sa constituency), et évaluer la vigueur de l’esprit de corps qui le sous-tend et le porte (la Ðasabîya d’Ibn Khaldoun). Or, les lois de nos démocraties participatives sont telles, que nos princes sont en permanence contraints de ratisser large et d’aller pêcher en dehors de leur base naturelle de pouvoir. Là, pour compenser leur carence en autorité, ils utilisent des procédés douteux qui contribuent à miner le respect qu’ils imposent. Car il ne peut y avoir d’autorité sans respect, et il faut reconnaître que le respect manque cruellement de nos jours. Dire aujourd’hui de quelqu’un, qu’il est « respectable » est quasi risible. On ne peut s’empêcher de sourire à chaque fois qu’on entend parler de « respectabilité ». Monarque, sage, santon, chef d’État, chef de famille, chef d’entreprise, chef de tribu ou chef de guerre, l’homme respectable, qui emporte l’adhésion sur son seul nom et se comporte en conséquence, a vécu. C’est à présent le règne des gens habiles, des petits malins, des docteurs ès influence, des spécialistes de la rumeur, des maîtres en désinformation : des tricheurs, en somme, qui maîtrisent parfaitement les modes de fonctionnement de notre démocratie participative.
Ne vous méprenez pas. Il n’y a, dans mon propos, aucune nostalgie. Je ne pleure pas un temps révolu. Je n’idéalise pas davantage le passé. Je ne dis pas que les princes d’hier étaient plus honorables que ceux d’aujourd’hui. Les tricheurs ont toujours existé. Mais ce qui est nouveau, c’est que les tricheurs se retrouvent aux commandes alors même qu’on nous dit que nous sommes en guerre (en guerre contre le terrorisme, contre la drogue, contre la misère, contre la famine, contre l’obscurantisme, contre le despotisme, contre la barbarie). Or, une telle guerre, on la fait avec des guerriers, et non pas avec des tricheurs. Hector n’a plus sa place parmi nous, et, quoi qu’en dise Homère, ce n’est pas Achille qui l’a vaincu, mais Ulysse.
Percy Kemp