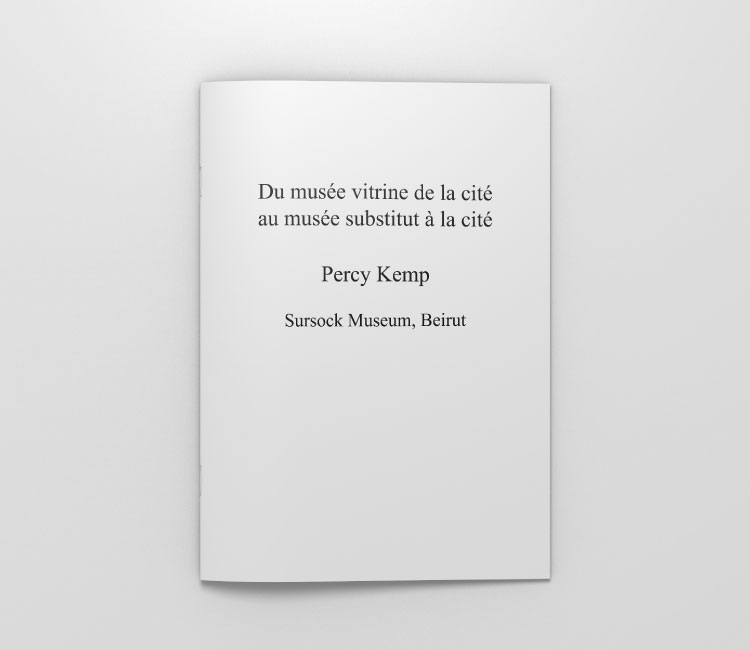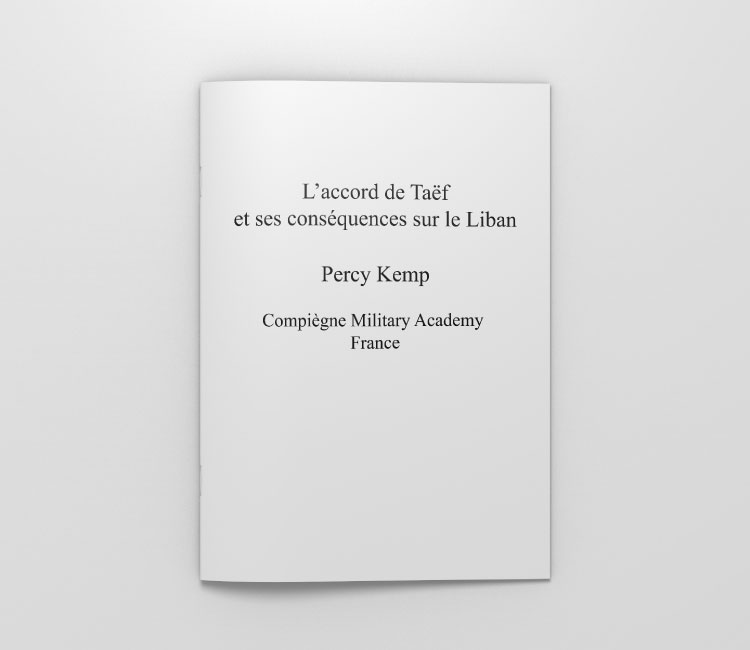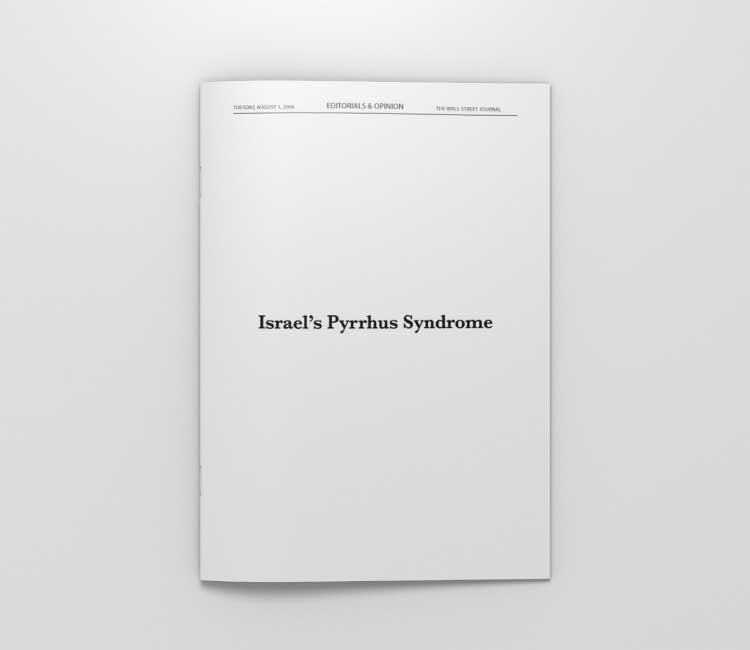Nous voilà donc réunis dans un musée. Et quel musée ! Avant cependant d’en parler, quelques mots peut-être sur la notion même de musée.
Le mot musée nous vient du latin museum, lui-même dérivé du grec mouseîon qui signifie « le temple des muses. » On dira donc mouseîon comme on dirait pántheion pour « le temple de tous les dieux. » Dans la civilisation hellénistique née des conquêtes de Philippe II de Macédoine et de son fils Alexandre, le mouseîon tenait en réalité moins du musée tel que nous l’entendons, que de la bibliothèque et de l’université. Il en était ainsi du Musée d’Alexandrie fondé par Ptolémée 1er au 3ème siècle avant Jésus-Christ, lieu de réflexion philosophique et de débats intellectuels, et une bien belle vitrine pour ce diadoque macédonien qui, après avoir pris part aux conquêtes du grand Alexandre et avoir hérité à sa mort d’une partie de son empire, se lissait désormais les plumes.
Le déclin de la civilisation hellénistique à partir du 2ème siècle avant notre ère et la montée en puissance concomitante de Rome entraînèrent une évolution de la notion de musée. Vitrine d’une société en pleine expansion, le museum romain s’apparentait de fait moins au mouseîon grec qu’à nos musées modernes. À la différence que chez les Romains la notion de museum ne renvoyait pas tant à un édifice physique ouvert au public, qu’à une collection d’œuvres d’art et d’objets précieux, propriété d’un puissant personnage. Tite-Live nous a décrit le triomphe que Marcus Fluvius Nobilior avait organisé à Rome après sa victoire à Ambracie, en Grèce, en l’an 189 avant notre ère. Ce dernier, nous apprend-il, fit parader 750 statues de bronze et 230 statues de marbre, lesquelles vinrent s’ajouter à tous les autres objets d’art ou précieux pris sur l’ennemi, butin de guerre qui formait le museum privé du général victorieux : sa collection particulière. On voit bien, là, comment, en passant de la civilisation grecque, portée sur les idées, à la civilisation romaine, bien plus prosaïque, on était aussi passé du musée entendu comme lieu d’inspiration et de réflexion au musée entendu comme repositoire et lieu d’exhibition de richesses et de possessions.
Un millénaire après l’effondrement de l’empire romain, à la Renaissance, un Occident revigoré et à nouveau conquérant renoua avec cette tradition romaine du museum. De la moitié du 15ème siècle à la fin du 17ème, âge d’or d’une expansion européenne débridée, sous l’effet d’une curiosité renouvelée à l’égard des civilisations et des cultures étrangères comme à l’égard d’espèces animales et végétales exotiques, sous l’effet, aussi, d’un désir profond de s’approprier, par l’argent, sinon par le fer, œuvres d’art et objets précieux, et de les exhiber comme autant de signes de puissance et d’opulence, nombre de monarques et de notables européens, les Médicis en tête, se constituèrent des collections privées d’art, d’antiquités, comme de curiosités.
À cette période d’expansion européenne succéda, alors que la puissance de l’Europe atteignait son apogée, une autre, de consolidation. Les initiatives personnelles qui avaient été jusque-là le moteur de la constitution des collections se fondèrent alors graduellement dans l’initiative collective représentée par les grandes institutions nationales (universités, sociétés scientifiques) comme par l’appareil d’état. Ce qui explique sans doute la décision de l’Anglais Elias Ashmole, homme politique et grand commis de l’état, astrologue, botaniste et alchimiste par ailleurs, de céder à la toute fin du 17ème siècle son immense collection privée à l’université d’Oxford, à condition (et c’est important de le souligner) que soit érigé un bâtiment qui lui serait dédié, et qu’il soit aussi ouvert au public. C’est ainsi que naquit l’Ashmolean Museum, premier musée public européen, semble-t-il. Quoique d’autres sources suggèrent que le premier musée ouvert au public eût été Montagu House, à Londres, lequel ouvrit ses portes en 1753.
Quoi qu’il en soit, cette période de consolidation fut caractérisée, dans les musées, par un profond désir d’interprétation et de classement scientifique des collections par l’analyse et par la typologie. C’est comme si l’Occident avait cherché à faire siens par la science et la compréhension des artefacts et des spécimens animaux et végétaux appartenant à d’autres mondes et un autre temps. Dans l’un de ses romans, Italo Svevo ne fait-il d’ailleurs pas dire à l’un de ses personnages que les bourgeois ne peuvent apprécier une œuvre d’art que s’ils estiment pouvoir la comprendre ?
Deux siècles et demi plus tard, au sortir de la deuxième guerre mondiale, à cette longue période de consolidation succéda, notamment en Europe, une autre, de récession. Récession, comme dans le poème Recessional de Kipling, appelé ainsi en référence à l’hymne de sortie de l’office anglican. J’en cite quelques vers qui parlent d’eux-mêmes : « Appelées au loin nos marines s’effacent. Sur les dunes et les promontoires les feux s’éclipsent. Voyez, toute notre pompe d'hier ne fait plus qu’un avec celles de Ninive et de Tyr ! Juge des Nations, épargne-nous encore, afin que nous n’oubliions, afin que nous n’oubliions pas ! »
C’est que, entretemps, le centre de gravité du monde avait basculé de l’Europe vers l’Amérique, mais aussi vers l’Asie. Les Européens ne faisant désormais plus la loi, leurs musées en pâtirent évidemment. De conservateurs, les conservateurs des grands musées européens devinrent alors franchement frileux. Ce qui se comprend. Car non seulement les administrateurs et les soldats européens ne contrôlaient plus les pays lointains d’où ces musées avaient jadis tiré une bonne partie de leurs fonds, non seulement l’argent public nécessaire à de nouvelles acquisitions se faisait maintenant rare, non seulement les musées américains et ceux des pays émergents commençaient à leur faire une rude concurrence, mais certains pays avaient à présent le culot d’exiger qu’on leur restituât ce sur quoi, en des temps plus heureux, les grands musées européens s’étaient généreusement servis chez eux. Ainsi, les marbres du Parthénon, dont la Grèce exigeait du British Museum la restitution.
Comment s’étonner, après cela, que lors de cette phase de récession les conservateurs des grands musées européens se soient raccrochés maladivement à leurs fonds et à leurs collections, tels des retraités dont une dévaluation de la monnaie aurait grignoté inexorablement la pension, et qui sauraient pertinemment qu’ils ne pouvaient plus compter sur de nouvelles rentrées. Pire encore, le roi étant nu, ne voilà-t-il pas qu’on n’hésitait plus à le voler. Ces vingt dernières années le British Museum s’est ainsi vu dérober pas moins de deux mille de ses pièces. De vitrine de la Cité européenne, le musée était devenu un simple reflet de son glorieux et regretté passé.
On pourrait penser que la récession, avec le déclin qui la caractérise, est ce qui pourrait arriver de pire à une cité jadis conquérante et rayonnante. Rien n’est cependant moins sûr. Il arrive en effet qu’une cité se rétracte, quand des pans socio-culturels entiers se replient sur eux-mêmes dans un mouvement de qui les sépare brutalement du tissu social dominant. Ainsi, les catholiques anglais sous les Tudor, les protestants français après la révocation de l’édit de Nantes, les Russes blancs après la prise de pouvoir par les Bolchéviques, les chrétiens et les musulmans de Jérusalem après l’occupation de la partie orientale de la ville par Israël, ou les fondamentalistes musulmans du takfîr wa l-hijra dans l’Égypte étatique et laïque.
Et cette phase de rétraction a elle aussi ses musées. Ils différent cependant, dans leur fonction comme dans leur mission, des musées propres à une société en phase d’expansion ou de consolidation, en ce sens qu’ils ne font plus tant office de vitrine ou d’ornement de la cité mais viennent plutôt s’y substituer. Et c’est assurément à cette dernière catégorie de musées qu’appartient celui où nous nous trouvons aujourd’hui. Au même titre que d’autres espaces culturels libanais similaires ; au même titre, aussi, que les intérieurs et l’intimité de ceux-là qui visitent et fréquentent de tels lieux.
Dans Les 28 hommes de Panfilov, un film sur la deuxième guerre mondiale, le cinéaste russe Andrey Shalopa fait dire à l’un de ses personnages : « Pays et patrie sont deux choses différentes. Alors que notre pays est le l’endroit où l’on vit, notre patrie, elle, est la façon dont on y vit. » Que faire, alors, dès lors que notre lieu de vie ne correspond plus à notre manière de vivre ? Que faire lorsque notre pays ne se confond plus avec notre patrie ? Que faire, sinon partir pour l’exil. Ou alors, s’exiler sans partir : entreprendre un exil intérieur, et chercher éperdument, ici et là, de petits espaces d’extraterritorialité qui seraient autant de substituts à un pays dans lequel on ne se reconnaitrait plus et où l'on vivrait désormais sans pour autant exister.
Et c’est là qu’interviennent les espaces culturels tels celui-ci. En accueillant entre leurs murs des êtres déclassés, marginalisés, spoliés, parfois même désespérés, ils prolongent leur intérieur et leur intimité dans l’espace public, leur permettant ainsi de ne plus se sentir constamment étrangers dans leur propre pays. N’est-ce pas cela que propose le théâtre Al-Madîna depuis trente ans déjà ? Al-Madîna : la ville, bien sûr, mais aussi la cité. La cité au sens de civitas, soit l’ensemble des citoyens. Effectuant une inversion des rôles, Al-Madîna fait du théâtre un lieu de citoyenneté, alors que hors les murs, à l’extérieur du théâtre--au Parlement, par exemple--, se joue une lamentable pièce tragi-comique.
Faudrait-il se désoler de cette rétraction de la cité, et du statut officieux d’extraterritorialité de certains espaces culturels devenus synonymes d’aires de jeu sans conséquence aucune sur la marche du pays, voire de fêtes des Fous consenties par un pouvoir s’en servant cyniquement comme d’un exutoire ? Pour ma part je choisis de faire confiance à Sénèque, lequel nous dit que rien n’est bon ou mauvais en soi et seule la pensée le rend ainsi. Je me dirais cela, et je choisirais de voir dans un musée tel celui-ci, qui expose des œuvres que je puis contempler et admirer à satiété sans pour autant en avoir le titre de propriété, un rappel de la différence essentielle qu’il y a entre ce qui est propre à moi et ce qui ne l’est pas.
Sous notre contrôle, nous dit Épictète, il y a les impressions, comme la conception, le choix, la volonté, l’amour, la haine, le désir ou l'aversion. En un mot, tout ce qui est de notre propre fait. Hors de notre contrôle, nous dit-il aussi, il y a nos possessions, notre réputation, notre position sociale, nos relations, et même notre corps. En un mot, tout ce qui n'est pas de notre fait. Tout ce qui est sous notre contrôle, conclut-il, est par nature libre et sans entraves, car l’usage que nous faisons de nos impressions ne dépend que de nous seuls. Alors que ce qui est hors de notre contrôle est par essence servile, sujet à entraves, et ne nous appartient pas vraiment, puisqu’il peut nous être ôté à tout instant : par les circonstances, l’arbitraire ou le fait du Prince. « Louez chez un homme ce qui ne peut ni lui être donné ni lui être enlevé, nous exhorte Sénèque, louez chez un homme uniquement ce qui est propre à lui. »
Ce verre d’eau que nous avons sous les yeux est rempli à moitié. C’est un fait. Mais ce verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? La réponse à cette question dépend de la façon dont nous gérons nos impressions. Et cela, personne, même celui qui a sur nous un droit de vie et de mort, ne pourra jamais nous l’enlever. Même sous la contrainte nous demeurons maîtres de nos impressions. "Rappelez-vous, nous dit aussi Épictète, que ce qui vous fait injure n'est pas la personne qui vous insulte ou vous maltraite mais votre jugement sur le fait que cette personne vous fait injure. Ainsi, chaque fois que quelqu'un vous irrite, reconnaissez que c'est en vérité votre opinion qui vous a irrité. » Ou, comme disent les Anglais, un vrai gentleman ne se sent jamais insulté.
Alors que tout, ou presque tout de ce qui fut diligemment construit nous échappe aujourd’hui--nos biens, notre position sociale, nos économies, notre pension, nos relations, nos projets, nos ambitions--, quel meilleur moment que celui-ci pour décider de ne plus nous soucier que de ce que nous contrôlons. À savoir, nos impressions. Alors profitons pleinement de ce moment convivial passé ensemble dans ce magnifique endroit, tirons-en de belles impressions, et disons-nous qu’elles sont nôtres, qu’elles nous définissent bien mieux que tout ce que nous pouvons posséder par ailleurs, et que rien ni personne ne pourra jamais nous les ôter.