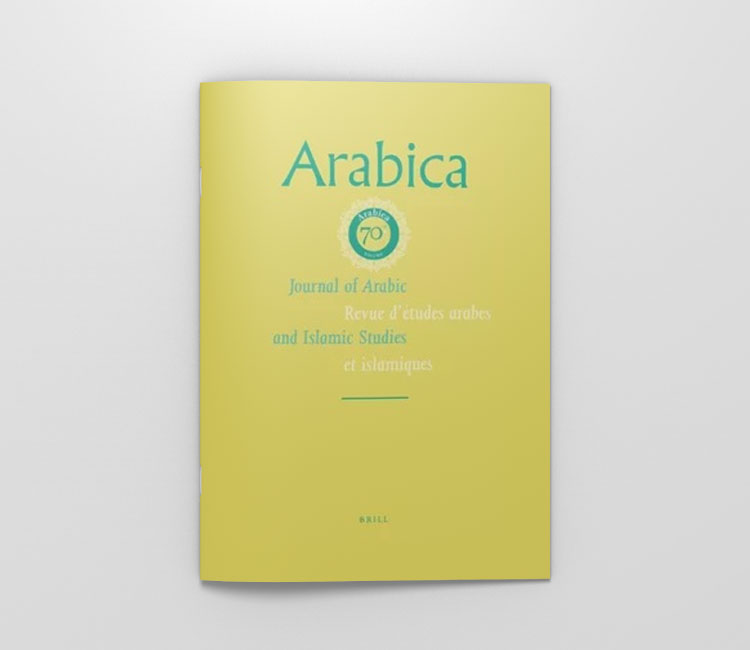|
O |
n Understanding Islam. Tel est l’intitulé riche de sens et de possibilités du dernier ouvrage de Wilfred Cantwell Smith[1]. Ce livre regroupe seize articles qui retracent en chassé-croisé le cheminement de la pensée de W. C. Smith et l’élaboration de son œuvre islamologique. L’ouvrage se divise en quatre parties. La première est une mise en place globale de l’Islam donné au lecteur à travers l’étude du concept d’histoire islamique et celle de la shahāda entendue comme représentation symbolique. Dans la deuxième partie, l’auteur quitte le domaine du général et nous invite à le suivre dans sa réflexion sur l’Islam, religion et politique, sur la Loi islamique et sur la foi, et ce à partir d’études philologiques minutieuses portant sur les concepts d’islām, imām, fiqh, jtihād, sharÄ«’a et shar’, taÅŸdÄ«q, et arkān. La troisième partie de l’ouvrage retrace l’histoire de l’Islam dans le sous-continent indien. Enfin, dans la quatrième et dernière partie, l’auteur se penche sur les rapports de divergence et de convergence entre Musulmans et Chrétiens.
Le terme d’Islam, remarque W.C. Smith, recouvre trois réalités distinctes. L’Islam, c’est tout d’abord un engagement : la soumission de l’individu à la volonté divine. C’est ensuite l’idéal platonicien d’une entité religieuse institutionnalisée. C’est enfin la réalité empirique de cette même entité. Il a semblé à W. C. Smith (p. 45) que bien que le terme d’Islam soit de nos jours entendu dans les trois sens sus-mentionnés, cela n’a pas toujours été le cas, et qu’on peut même percevoir l’ascension, consacrée à l’époque moderne, du troisième sens du terme, c’est-à-dire de l’Islam système religieux historique, empirique, observable. Or, nous dit W.C. Smith, bien que l’Islam ait été, dès l’origine, plus structuré et plus institutionnalisé que les autres grandes religions, il a néanmoins été tout d’abord appel personnel à Dieu : la systématisation est survenue par la suite. Et il en va de même pour la Loi. Le Coran, la Sunna, l’ijmā’, le qiyās et l’ijtihād sont perçus et entendus comme sources de la Loi. Mais, nous dit W.C. Smith, ils ne sont en réalité que les sources de la perception humaine de la Loi. Même sans la Révélation, il y aurait toujours une Loi, qui existe en soi et qu’il s’agit d’appréhender indépendamment. La Loi est divine, le fiqh et le ‘ilm, eux, sont humains ; la Loi est éternelle, la science juridique, elle, est historique (pp. 79-80). Existence pré-discursive de la Loi qui milite, on le voit, en faveur de l’ijtihād : car dire que la porte de l’ijtihād est close, c’est dire que les hommes ont élucidé la Loi et épuisé ses possibilités. Barrer la route à l’ijtihād équivaut donc à réifier l’Islam, à le raidir en consacrant la prééminence du système religieux historique sur l’idéal et sur l’acte personnel de foi. Et cette chosification de l’Islam est un phénomène historique observable. Dans l’Inde des Grands Mogols, par exemple, W. C. Smith pense pouvoir déceler l’ébauche d’un processus de cristallisation vers la fin du XVIIe siècle. Ce serait à cette époque que le soufisme-machine de guerre, dynamique porteuse de mouvement, aurait été supplanté par l’orthodoxie-appareil d’état, statique mère de la réification. Ce raidissement sectaire de l’Islam indien étant entre autres illustré par la marginalisation du wahdat al-wujÅ«d d’Ibn ‘Arabi, et la consécration corrélative du wahdat ashshuhÅ«d de SirhindÄ« (mort en 1624). Substitution fondamentale qui nous invite à réaliser « que les conséquences politiques, économiques et sociologiques du rejet du monisme métaphysique sont énormes, car croire en l’unité du monde et de l’univers, c’est, justement, croire en l’unité du genre humain ». (p. 130).Et un dévoiement similaire est perceptible dans l’histoire des rapports entre l’Islam et le Christianisme. Cette fois-ci cependant, le référent unitaire que W.C. Smith prend comme exemple n’est plus celui du monisme métaphysique, mais celui, historique lui, de la Bible. W.C. Smith nous propose d’envisager l’Islam, le Christianisme et le Judaïsme comme trois mouvements participant au phénomène scripturaire majeur qu’est l’Ancien Testament. Il nous invite à rejeter les dichotomies faciles (Juifs/Chrétiens, Chrétiens/Musulmans), et à dépasser le schéma binaire afin d’en rejoindre un autre, ternaire lui : une « trifurcation » Orient-Occident-Centre du processus scripturaire qui prend le relais de l’Ancien Testament et qui gravite — dans con affirmation comme dans sa négation — autour de la personne du Christ. Le Centre serait le Judaïsme, et les deux autres. Orient et Occident ensemble, auraient constitué le Christianisme. Plus tard, le Christianisme se serait divisé en deux : um Occident gréco-romain, et un Orient sémite. Plus tard encore, le mouvement religieux chrétien qui assumait le Christ et raisonnait en langue sémitique aurait, dans sa majeure partie, adopté un nouveau cadre métaphysique pour sa vie religieuse : ce cadre nouveau, c’est ce que nous appelons l’Islam (p. 260). La dichotomie Chrétiens/Musulmans autour de la personne du Christ relèverait donc de l’interprétation, de la contingence, et non de l’essence. Historique, cette dichotomie serait humainement surmontable, on pourrait la détourner. Et W. C. Smith nous invite, par delà les religions, à un voyage dans la religion. Car si la loi n’est pas la Loi, si la sharî’a n’est pas le shar’, et si les sources discursives de la Loi ne sont en réalité que les sources de la perception humaine de la Loi, alors l’Islam, pour le prendre comme exemple, ne serait pas que système religieux historique, ou que système religieux idéal, il serait surtout — et avant tout — islām personnel. Le divin recouvre ainsi sa liberté, enchainée par le système, et l’humain la sienne, usurpée par le législateur. L’homme renoue avec son créateur par-delà la réification de sa religion et à travers un acte de foi pré-institutionnel. La foi : le sacro-saint, le privacy, l’endroit même, si j’ose dire, de l’intimité avec Dieu. On pourrait en effet — et à juste titre — penser que l’homme, fuyant la chosification effrénée de sa religion, trouverait dans la foi un sanctuaire inviolé (la trêve de Dieu en quelque sorte). Loin de là. Non contente de recouvrir de son glacier le domaine de la Loi et de la théologie, voilà que la réification s’immisce entre l’homme et son créateur en envahissant impunément le domaine de la foi. L’offensive est telle, nous raconte W. C. Smith, que la foi n’est plus la foi, que les mots ont perdu leur sens originel, que de nouvelles significations sont apparues, et que, du coup, on ne croit plus de la même façon qu’auparavant. Croire, qui à l’origine voulait dire aimer, s’engager, se confier à [2], dénote aujourd’hui une notion sceptique. Et c’est par ce terme qu’on traduit de nos jours le terme arabe d’Ä«mān. Or l’Ä«mān n’est pas la croyance, et le mu’min n’est pas le croyant : l’Ä«mān, c’est la foi ; et le mu’min, c’est le fidèle. On en est néanmoins arrivé à traduire Ä«mān par croyance, bien que cette dernière notion soit étrangère au Coran où la catégorie croire, entendue comme activité religieuse, n’apparaît pas, et où par contre les termes signifiant’ savoir (‘alima, ‘arifa) sont fréquents et emphatiques. Le credo musulman, insiste W. C. Smith, n’est pas un credo si par credo on entend une affirmation de croyance. Le credo musulman est shahāda, il est témoignage. Le Musulman ne dit pas « Je crois qu’il n’y a de dieu que Dieu ... » il dit « Je professe qu’il n’y a de dieu que Dieu ... ». Ces notions ne sont pas crues, elles sont bien présupposées : et elles le sont tant dans le cas de l’Ä«mān que dans celui du kufr. Car le premier ne veut pas dire croyance, et le second ne renvoie nullement à l’incroyance. Ensemble, ces deux termes impliquent un cadre conceptuel à l’intérieur duquel l’un désigne une acception active, l’autre un rejet tout aussi actif (pp. 122-126). Le concept croire, en tant que catégorie religieuse, est étranger au Coran, conclut l’auteur. Croire est un concept moderne, un concept anthropocentrique, alors que la vision coranique du monde, elle, est théocentrique. On voit pourtant la réification de la religion étendre son ombre et recouvrir la foi, interceptant et annexant le rapport intime que l’homme peut entretenir avec son créateur. Le rôle comminatoire du langage est tel que le Commandeur des Fidèles devient le Commandeur des Croyants.[3] Ce processus de cristallisation des communautés religieuses n’est cependant ni abadi ni azali. Un retour, un détour, une parallèle est toujours possible. Belle gageure qu’une meilleure écoute des mots, une véritable philologie spirituelle, peut aider l’intéressé à réussir.[4] De cela, On Understanding Islam se voudrait témoignage actif : fides, et shahāda.
La critique — surtout la critique extrinsèque — tient du morbide. L’écrivain qui met le point final à son manuscrit se condamne au silence : au critique, alors, de procéder à l’autopsie. Dans la vaste surface discursive qui s’offre à lui, le critique choisit ses points de pénétration à sa guise. Les faiblesses qu’il décèle dans le texte sont en réalité ses forces à lui : ses centres d’intérêt intellectuels ou affectifs, à partir desquels il élabore une critique qui a une apparence de cohérence ; ses points d’ancrage, à partir desquels il lance des expéditions punitives en pays déjà soumis. Pourtant la critique extrinsèque n’épuise ni la totalité de l’ouvrage, ni même l’intégralité des passages retenus. Elle réussit peut-être à démontrer le comment de l’affaire, mais non le pourquoi. Ce pourquoi, la critique extrinsèque ne peut y répondre, car elle perçoit le texte par référence à un savoir extérieur, à une science normative. S’attachant aux organes malades, aux dysfonctionnements du corpus (du corps ?), elle ne s’attaque en réalité qu’aux absences. Or, comme dit Michel Foucault[5], « on ne peut dénoncer les ‘absences’ dans une analyse que si on a compris le principe des présences qui y figurent ». Ce principe des présences, une lecture intrinsèque, immanente, de On Understanding Islam nous permettra peut-être de le saisir.
Dès que l’on accepte de faire une lecture immanente de On Understanding Islam, on ne peut manquer d’être frappé par la religiosité du texte. Religiosité qui explique — en partie du moins — l’opacité du langage. On Understanding Islam ne fait pas que parler de la religion, son langage même n’est pas profane. Et ce qui, de prime abord, a l’apparence d’une redondance, n’est souvent que la marque de cette religiosité. Ainsi, l’expression the Qur’ān text, redondance flagrante, ne viendrait jamais à l’esprit du chercheur profane qui, lui, se contenterait d’écrire the Qur’ān. Et pourtant, il y a bien, quelque part, une différence entre le Coran, message divin révélé, et le texte matériel qui le représente (différence, je présume, entre qur’ān et mushaf sharif). De même, l’expression each poem that human beings produce n’est redondante qu’aux yeux de ceux pour qui tout poème est, ipso facto, d’origine humaine. Discours religieux. L’un des fondements de On Understanding Islam est justement que l’histoire de l’humanité ne peut être correctement appréhendée à moins d’une prise de conscience effective de sa dimension transcendantale longtemps occultée : l’historique et le transcendantal ne sont point deux catégories distinctes (p. 59). Voilà bien le prisme de W. C. Smith : une histoire religieuse du monde et de l’Islam. Ni lutte de classes, ni déterminisme économique : nageant à l’encontre du courant, l’auteur nous invite à le rejoindre, non pas au nom d’un quelconque idéal religieux, mais parce qu’à son avis le prisme religieux offre une meilleure compréhension de l’Islam : « L’orientaliste occidental moyen’ tend à appréhender l’Islam comme un phénomène sociologique, comme une réalité historique qui serait à étudier objectivement. Pour lui l’Islam n’est pas une idée dans l’esprit de Dieu, mais une simple élaboration humaine évoluant sur la scène de l’histoire. Je ne partage aucunement cet avis (...) comprendre une religion qui n’est pas la nôtre exige une révision sérieuse de la majorité de nos termes et de nos concepts. » (p. 59). On Understanding Islam est effectivement un ouvrage révisionniste. Et ce révisionnisme contribue à l’opacité du langage, W. C. Smith cherchant en effet à faire passer de nouveaux concepts et à ébranler des significations séculaires (p. 235). Histoire islamique, islām, Ä«mān, sharî’a, déterminisme historique, tout est sujet à révision. Concept après concept, brique après brique, W. C. Smith déconstruit l’édifice de l’orientalisme, européocentriste et anthropocentriste. A travers ce travail de révision, ce que l’auteur recherche, c’est la Vérité. Cette Vérité, il la sait, mais il la cherche néanmoins. Cette Vérité est présupposée, mais elle est aussi à démontrer épistémologiquement. Et cette démonstration épistémologique de la Vérité est perçue par W.C. Smith comme la condition sine qua non de son actualisation. Le point peut bien, aux yeux du profane, sembler obscur, et la quête tautologique.[6] L’approche transcendantale de l’auteur est pourtant simple : la Vérité n’a absolument rien à craindre des vérités scientifiques, et c’est uniquement en faisant preuve d’intégrité intellectuelle et de scientificité qu’on pourra accéder à cette Vérité première et, y accédant, l’actualiser. La Vérité est fin, et elle est moyen. Cette Vérité implique l’imbrication de l’historique dans le transcendantal et, partant, l’imbrication des diverses formes de l’historique (l’unité en devenir) : « Dieu, qui n’est pas Pluriel, engage l’homme où qu’Il le trouve du mieux qu’Il peut, en dépit — ou dans le cadre même — des limitations des diverses formes de la religion. » (p. 237). Vérité moniste donc : si le transcendantal et l’historique ne sont pas deux catégories séparées, alors les histoires (islamique, chrétienne ou autre) ne sont que les manifestations contingentes d’une seule et même histoire. Ainsi, les définitions que les mutakallimÅ«n donnent de la foi « ne sont nullement les définitions de la foi islamique, mais les définitions islamiques de la foi humaine. » (p. 152). Moniste, On Understanding Islam ne l’est pas uniquement dans son contenu, il l’est aussi dans son style. D’où les hésitations de l’auteur à chaque fois qu’il s’agit pour lui de formuler les rapports inter-religieux : Chrétiens Musulmans ? ou Musulmans/Chrétiens ? De même, l’introduction de la variante féminine après chaque masculin : him/her, he/she, etc. Désir moniste, et outillage moniste : W. C. Smith ambitionne en effet de comprendre l’Islam afin de comprendre à travers lui la religion entendue comme phénomène global (pp. 6, 45. 111, 113 et 152). Or. se désole l’auteur, l’Islam que nous appréhendons est un Islam réifié, tant dans sa réalité socio-historique que dans les concepts qui nous la livrent. D’où l’importance du travail de révision qui devra aller puiser par delà la corruption et le dévoiement des mots un sens originel, pré-systématique. Ce sens originel est moniste, alors que celui qui prévaut aujourd’hui est réifié, communaliste, sectaire, diviseur (pp. 45, 178-179, 183, 188, 192). Il en va ainsi pour le concept d’Ä«mān, dont le sens premier, moniste, est celui de foi, et dont le sens second, réifié, est celui de croyance. Or, « tant pour les Musulmans que pour les Chrétiens, la croyance et la foi, loin de signifier la même chose, sont en réalité deux catégories distinctes : dans notre croyance, nous nous différencions les uns des autres (...) dans notre foi par contre, nous sommes bien plus proches les uns des autres qu’on ne pourrait l’imaginer. » (p. 134). D’un mot, W. C. Smith avance ici l’hypothèse que l’humanité ne serait fragmentée qu’en fonction des concepts réifiés ou profanes qui fondent notre appréhension de nous-mêmes et notre vision de l’autre. Il invite le chercheur occidental et chrétien à réviser le vocabulaire qui fonde son rapport au divin et sa relation à l’Islam. II enjoint de même les chercheurs Musulmans à dépasser la vision réifiée qu’ils ont de leur propre religion. Voilà bien le parti pris de W.C. Smith : pour la Loi et contre la loi, pour le shar’ et contre la sharî’a, pour les soufis et contre les « communalistes », pour l’ijtihād et contre le dogmatisme. « Un Musulman ne serait pas un Musulman s’il refusait de se soumettre à l’impératif divin, mais nul n’est en droit de mettre en doute l’Islam d’un homme qui, en toute conscience et en toute sincérité, se trouve en désaccord avec d’autres quant à la nature exacte de cet impératif. » (p. 85). Cette invitation à se joindre à la quête de la vérité s’adresse à une élite : élite qui sait où qui soupçonne. Et là quête, on le voit, se fonde dans le logos : c’est essentiellement par le logos dévoyé que notre vision s’est réifiée, et c’est par ce même logos que nous serons sauvés. Prééminence du logos : qui dit théologie dit Dieu, bien sûr, mais il dit autant — si ce n’est parfois plus — connaissance, science, savoir. La théologie est une quête épistémologique — et donc sociale — de la Vérité Cette quête, On Understanding Islam la formule, page après page, en des termes qui élaborent une « nouvelle théologie » se passant de particularisation.
Cette nouvelle théologie s’oppose au dogmatisme religieux — musulman ou chrétien, qu’importe — ainsi qu’au rationalisme profane. Aux dogmatiques religieux de tous bords, elle oppose le monisme dans ses nombreuses manifestations empiriques : développement des communications et des échanges, imbrication politique, économique et sociale des sociétés humaines, progrès d’une science aux dimensions mondiales, essor des rapports inter-culturels et inter-religieux : « Symbole de la fin de la période d’isolement : les nouveaux centres de collaboration scientifique qui s’érigent aujourd’hui, et où chercheurs occidentaux et savants musulmans travaillent côte à côte et œuvrent ensemble à une meilleure compréhension de l’Islam. » (P. 298). À tous les dogmatiques religieux qui lui cherchent noise la nouvelle théologie rétorque : Il ne peut plus y avoir aujourd’hui une théologie efficace, ayant prise sur le réel, et qui soit islamique, catholique ou protestante ; il ne peut plus désormais y avoir qu’une théologie humaine, globale ; Dieu est Un et l’a toujours été ; à présent la science devient Une : monisme épistémologique : le Un de la Science du Un. Mais y-a-t-il vraiment combat ? On pourrait en effet — et à juste titre — penser que ces dogmatiques, nostalgiques survivants d’un autre âge, sont bien tenus en laisse par les divers organismes internationaux (onu, Banque Mondiale, etc.) ainsi que par les idéologies universalisantes qui répartissent l’aide financière, canalisent la coopération, et monopolisent le discours public à l’échelle mondiale. Décrié, ridiculisé, le discours de jactance, le discours raciste (au sens premier du terme). Il ne trouve sa place ni dans la science ni même dans l’art.[7] Il existe, pour sûr, mais il est « mineur », on le cache chez soi, il ne prend jamais l’air. Et dans ces pays où il éclate au grand jour pour y être béni par l’État, il irréalise et finit par devenir mensonger (qu’on pense, par exemple, au discours intégriste de la révolution islamique qui n’empêche nullement les autorités iraniennes de recevoir une assistance militaire d’Israël). Dogmatique, raciste, chauvin ou obscurantiste, l’ennemi d’hier vaincu, maté, s’est, bon gré mal gré, plié aux exigences du jeu international, et l’humanisme moniste a fini par le digérer par l’entremise des structures universelles et dichotomiques (Est/Ouest, Nord/Sud, etc.).
Autre ennemi, le rationalisme profane, anthropocentriste, auquel la nouvelle théologie oppose sa vision théocentrique du monde et sa foi en l’imbrication de l’historique et du transcendantal. Et pourtant, malgré les apparences, et quoi qu’en dise W. C. Smith, le rationalisme anthropocentrique accommode très bien la nouvelle théologie. Il fait place à ce discours qui, comme lui, est essentiellement moniste : unesco et autres onu, dialogues islamo-chrétiens, « trilogues »[8], rencontres entre chercheurs musulmans et leurs collègues occidentaux, donations pétro-islamiques aux universités de l’Europe et de l’Amérique, etc. Tout cela fait une place de choix à W. C. Smith et à la nouvelle théologie, au nom d’une humanité une et d’un avenir commun.[9] Lisant (p. 237) « Dieu, qui n’est pas Pluriel, engage l’homme où qu’Il le trouve du mieux qu’il peut, en dépit — ou dans le cadre même — des limitations des diverses formes de la religion », et lisant (p. 260) l’hypothèse de W.C. Smith sur les divergences christologiques entre langues sémitiques et langues indo-européennes, j’avais frémi — et pas d’horreur. Mais j’ai vite déchanté. Il parait en effet que la différence existe, mais qu’elle est là pour être identifiée, « reconnue », étudiée, et par l’étude sauvegardée mais dépassée (e.g., pp. 218-219). Non, il n’y a là nul hymne à l’inégalité ontologique, nul chant de la différence, nulle jactance, nulle noblesse raciste, mais encore, mais toujours, cette humilité, cette humilité étouffante, castratrice, la fausse humilité des envoyés divins, porteuse de culpabilité. L’arène internationale et ses supports institutionnels sont l’apanage du discours de conciliation et du langage d’harmonie. L’auto-censure y est de règle. Tout le monde est gentil. Tout le monde est le frère de tout le monde. Mais certains frères, il faut bien le dire, n’ont pas eu beaucoup de chance : ils étaient peut-être trop éloignés de l’océan, ou alors trop proches. Et puis, c’est aussi la faute à la colonisation (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa sur les bancs européens), sans oublier les phallocrates. Mais à présent, tout va changer : Les PA (pays-avancés) aideront les PMA (pays-moins-avancés), et bientôt tout le monde deviendra PTAALUQLA (pays-tout-aussi-avancés-les-uns-que-les-autres). Les intellectuels au rabais de l’Occident continueront à s’offrir des colloques ensoleillés aux frais de la princesse (arabe pour le moment), et du tiers-monde, des élites étatiques et mimétiques continueront à venir s’entasser à Paris autour du temple moniste de l’unesco. Et tout le monde sera l’égal de tout le monde. Et l’homme blanc se blanchira en collaborant avec le Noir bon teint. Et on ira tous s’habiller chez unisex. Et on inventera le pronom neutre. Et le pigeon english dominera la terre. Et rien ne changera. J’en veux pour preuve ce graffito lu dans le métro londonien : « Les humbles hériteront peut-être de la terre, mais les puissants se réserveront certainement les richesses du sous-sol. »
La dialectique de la différence a finalement détrôné la dialectique de la contradiction. « L’unité dans la diversité » est le nouveau slogan. Que le Musulman reste musulman, et le Noir noir, et le Blanc fidèle à lui-même, notre diversité. « Le droit à la différence » est le mot d’ordre du jour. Mais la différence relève-t-elle du droit ? Peut-elle être octroyée, reconnue, et préservée à coups de chartes et de discours ? Ou alors s’arrache-t-elle ? Praxis, la différence doit s’imposer, et à chaque instant. Loin de se fonder dans le droit, elle surgit de la fureur. En ce sens, le fameux droit à la différence rejoint les parcs naturels, les réserves forestières, les campagnes écologiques, et les décrets pour la sauvegarde des espèces animales et végétales en voie de disparition. Ce droit à la différence est synonyme de folklore, de décor, il n’est pas synonyme de vie. Octroyé par le plus fort au plus faible (par l’homme blanc à l’esquimau, à l’indien d’Amérique ou au phoque) à grands flots de sympathie, ce droit-là est un leurre qui cache mal un désir de totalisation, et qui ne laisse survivre que l’ombre d’une différence déjà abolie. Non, je n’ai vraiment aucune envie d’être une baleine bleue.[10] « Vive la différence » est un slogan anesthésiant, faux. Seul est vrai le cri — inintelligible effrayant — de « Vive ma différence ». Mais reconnaitre ce fait, c’est accepter, pour le moins, d’assumer la fureur, l’ire, la volonté de puissance, et l’identité parfaite de la défense avec l’attaque.[11] Reconnaitre ce fait, c’est surtout risquer de sortir du domaine du sens universel. Ce, justement, qu’on cherche coûte que coûte à éviter.
Moniste, la nouvelle théologie n’a absolument rien à craindre de l’anthropocentrisme. De l’européocentrisme, peut-être oui, mais il est mort : il s’est anéanti de bonne grâce dans l’anthropocentrisme totalisant. Les présupposés de la nouvelle théologie et de l’anthropocentrisme peuvent bien être différents — Dieu d’un côté, l’homme de l’autre — , le message, lui est identique, et commune aux deux la sacralisation du logos. Dans les deux systèmes, en effet, le prisme est le savoir. Tout comme l’anthropocentrisme, la nouvelle théologie recherche la Vérité par la voie de la connaissance scientifique. Du coup, elle ne s’oppose pas tant à la rationalité profane, son émule, qu’à la spiritualité, c’est-à-dire à la recherche de la Vérité par le déplacement, l’ascèse et le décentrement subjectif.[12] Muette, insensible aux catégories du social, peu férue d’anthropologisme, la spiritualité échappait encore largement aux relations de pouvoir. Pour la traquer, l’anthropocentrisme rationnel était bien piètrement équipé. Il fallait pour cela un Cheval de Troie, un Grand Inquisiteur à l’allure de prophète, un domini canis travesti : la nouvelle théologie. Brandissant l’étendard de la spiritualité, la nouvelle théologie s’efforce de récupérer la spiritualité au profit de l’anthropologisme moniste (monotheos, monanthropos, monologos) et de la mobiliser contre tout ce qui — illuminé, partisan pervers et entêté de sa singularité, absentéiste, ou idolâtre pour qui deux malheureux bouts de bois crucifiés valent bien une guerre — met en cause le sens universel et ébranle la domination des schémas perceptifs unitaires.[13] Face à cette vaste offensive qui cherche à la théologiser, la spiritualité cède du terrain, elle se fait atopique, elle passe ailleurs en se créant de nouvelles lignes de fuite. Chassée du sacré, elle investit le profane, et pour se dérober, d’aucuns[14] tentent aujourd’hui d’expérimenter une véritable spiritualité immanente — spiritualité matérielle, si j’ose dire.
Dans le domaine des études arabo-islamiques[15], on voit de même se dessiner de telles lignes de fuite esquissées par des chercheurs qui veulent se déprendre du pouvoir, religieux soit-il ou profane. L’orientaliste qui, de nos jours, tente d’éluder les relations de pouvoir et de recouvrer sa liberté de savant et d’écrivain, s’efforce de se situer à l’intérieur d’un champ d’objectivité, de scientificité, de désir de vérité et d’empathie. Il œuvre à évacuer de son discours les préjugés racistes hérités de l’orientalisme traditionnel ; il laisse de côté tout jugement de valeur ; il accepte l’autre — en l’occurrence l’arabo-islamique — dans sa digne altérité ; et il lui arrive même de se rapprocher de cet autre afin de contribuer à lui restaurer son authenticité. Approche positive, scientifique et anti-raciste qui prend le contre-pied d’un orientalisme traditionnel trop longtemps lié au colonialisme, fondant son savoir sur des principes supputés essentiels, et dont le discours, au ton volontiers méprisant, s’articulait sur une pléthore de dogmes racistes et anhistoriques. Il ne serait pas faux, je crois, de dire que la liberté et l’indépendance de l’orientaliste se mesurent aujourd’hui au décalage qu’il effectue par rapport aux acquis de la vieille école, ainsi qu’à cet élan farouche et généreux qui le pousse à se démarquer des instances officielles du pouvoir. Fini -- ou presque — le temps où l’on discourait cohéremment sur le bon Musulman et le mauvais Musulman. Ni bon ni mauvais, le Musulman est désormais un homme, comme tous les autres hommes : l’émancipation de l’orientaliste retrouve ainsi celle du tiers-monde. Les orientalistes des trois dernières décades ont, dans leur grande majorité, été formés dans ce climat d’étude positif et objectif. Militants de l’humanisme, certains se montrent d’ailleurs plus sensibles aux besoins des anciennes colonies qu’aux exigences supposées de leurs propres sociétés, et ils sont plus proches des pays en voie de développement que des chancelleries occidentales. Moins enclins à la croisade humaniste, d’autres recherchent, loin du temps présent, une sérénité caractéristique de ces siècles que la politique semble délaisser. D’autres encore se taillent innocemment de petits domaines philologiques, numismatiques ou ésotériques libres, en apparence du moins, de toute polémique. C’est donc par un décentrement par rapport à son époque, par un mouvement de déterritorialisation vers l’Orient, ou encore par un sentiment de sympathie envers le tiers-monde, que l’orientaliste moderne réaffirme son indépendance vis-à-vis du pouvoir et souligne sa liberté de pensée et d’écriture. Objectivité, scientificité, volonté de vérité et empathie humaniste tracent les lignes de fuite qui emportent l’orientaliste au loin, hors d’atteinte des tentacules du pouvoir.
Vœux pieux. On n’échappe pas aussi facilement au pouvoir. Et si l’on croit y échapper, c’est qu’on se fait du pouvoir une idée fausse. On imagine le pouvoir comme un phénomène extérieur à soi, propre à un appareil d’état, à une classe, à une élite dirigeante : un diable qui viendrait investir un discours candide et s’en emparer. Barthes, Deleuze, Foucault, d’autres encore, l’ont montré : le pouvoir est diffus, il n’est pas un mais pluriel, le pouvoir n’existe pas, il y a du pouvoir, il y en a dans les groupes, les individus, les rapports sociaux, et surtout dans le langage. Pas plus que l’orientaliste traditionnel qui reconduisait le pouvoir occidental en place et l’assumait pleinement et volontairement, le nouvel orientaliste qui, lui, récuse ce pouvoir occidental et le dénonce, n’arrive, en réalité, à se mouvoir hors des relations de pouvoir. À cela deux raisons : l’une relève de l’a priori d’objectivité, de scientificité et d’empathie qui fonde le nouveau discours orientaliste ; l’autre est le propre du langage.
L’objectivité de W. C. Smith, ses scrupules et son empathie participent pleinement, on l’a vu, à une configuration dominante de pouvoir ; ils renforcent l’idéologie totalisante qui articule notre société et le monisme qui nous emporte. Parlant par ailleurs[16] Orientalisme d’Edward Said, j’avais fait remonter l’humanisme de l’auteur, sa sympathie pour l’Islam, sa dénonciation des abus occidentaux et sa critique acerbe de l’orientalisme traditionnel jusqu’à cette même configuration de pouvoir. Théocentrisme d’un côté, anthropocentrisme de l’autre, mais toujours monisme. Dialectique de la différence chez l’un, dialectique de la contradiction chez l’autre, mais toujours, mais encore, humanisme. W. C. Smith et Edward Said peuvent bien, chacun à sa manière, vitupérer le dogmatisme, le racisme, le colonialisme ou le chauvinisme. Ils ne font la que toucher à des pouvoirs bien circonscrits, contingents, caractérisables, et souvent dépassés. S’acharnant contre un pouvoir donné, ils passent à côté de la réalité du pouvoir, ils épargnent surtout cette figure particulière et triomphante de pouvoir qui façonne leur propre discours et détermine le message rédempteur dont ils se font les hérauts.[17] W. C. Smith et Edward Said n’arrivent à échapper à une configuration donnée de pouvoir (celle qui soutenait l’orientalisme traditionnel) qu’en se jetant au cou d’une autre configuration de pouvoir, plus avancée, elle, plus efficace aussi, et certainement plus subtile. C’est qu’on n’a jamais le choix entre l’extérieur du pouvoir et son intérieur. On peut uniquement choisir entre diverses figures du pouvoir. Il s’est fait que Smith et Said, pour les prendre comme exemple, ont choisi de saborder un bateau qui coulait déjà, pour voler au secours de la victoire et aller rejoindre le courant humaniste et révolutionnaire : une révolution, disons-le, assez bien assise.
Or, si l’orientaliste ne réussit pas à se propulser hors du pouvoir, ceci n’est pas uniquement dû à la manière dont il parle, par exemple, de l’Islam. Le comment d’un discours sur l’Islam reflète en effet une figure particulière et caractérisable du pouvoir (humaniste, raciste, impérialiste, révolutionnaire). Mais si, par delà cette figure précise, l’orientaliste s’inscrit, bon gré mal gré, dans des relations de pouvoir indépendantes du contenu doctrinal de son discours, c’est bien parce que cet orientaliste parle, c’est-à-dire parce qu’il fait usage du langage. Il n’est plus ici question d’un pouvoir particulier, contingent (réactionnaire ou progressiste), mais du pouvoir pluriel et palingénésique : « La raison de cette endurance et de cette ubiquité, c’est que le pouvoir est le parasite d’un organisme trans-social, lié à l’histoire entière de l’homme, et non pas seulement à son histoire politique, historique. Cet objet en quoi s’inscrit le pouvoir, de toute éternité humaine, c’est : le langage — ou pour être plus précis, son expression obligée : la langue. ».[18]
Omniprésence du pouvoir, et qui se fait d’autant plus pesante et étouffante dans le champ des études arabo-islamiques. L’Islam est en effet trop actuel, trop chargé. Au nom de cet Islam, trop d’hommes rêvent et désespèrent, souffrent et font souffrir, dominent et sont dominés, tuent et sont eux-mêmes tués, pour qu’on puisse, en toute quiétude et mine de rien, chercher à le comprendre, cet Islam, à l’appréhender, à le saisir, à le posséder comprendre, appréhender, saisir, posséder : vocabulaire épistémologique certes, mais aussi — mais autant — vocabulaire comminatoire, policier. L’Islam fait couler trop d’encre. Volens nolens, il suscite dans trop de lieux savants, trop de départements où trop de chercheurs cherchent à le comprendre, en confondant souvent comprendre avec prendre. L’orientaliste peut-il espérer en sortir ? Peut-il envisager, réellement, de se tracer une ligne de fuite qui serait autre que leurre ou que silence ? L’aventure vaut d’être tentée, même si le voyage s’annonce pour le moins hasardeux.
Désapprendre l’orientalisme : pénible apprentissage. En comparaison, la maitrise orientaliste fait figure de voyage organisé. Apprenant à connaître l’Islam et à le comprendre, l’aspirant orientaliste se coule en effet dans un discours enveloppant. Guidé par des mentors qui ne demandent qu’à être rattrapés, il se laisse porter par des concepts dont la récurrence le berce et le réconforte. La voie étant tracée, creusée, il lui suffit de la raffiner, de l’enrichir. Rien de tel quand il s’agit de désapprendre. Ni maitre, ni modèle, ni institution, ni récurrence : la montée vers la maitrise est ici « élévation à l’inquiétude et à l’absence de repos » (Michel Serres). Solitaire, l’orientaliste devra tracer ses propres lignes de fuite où l’affect le disputera souvent à l’intellect. Du moins pourrait-on en évoquer ici quelques figures possibles. Désapprendre l’orientalisme nécessite en effet certains réajustement préliminaires, propres à ébranler la quiétude et la cohérence de l’islamologie tel que nous la vivons.
Réajustement mental d’abord. L’orientaliste devra se dégager de l’actualité de l’Islam (anglais : topicality). Ce qui ne veut nullement dire se retirer loin des réalités d’un Islam contemporain pour se réfugier dans l’héraldique médiévale ou dans l’autourserie. Ce que cela veut dire, c’est qu’il faut cesser d’envisager l’étude de l’histoire islamique comme une opération de recouvrement d’un passé enseveli ou interrompu, et sa restitution à une humanité infidèle ou amnésique, ou alors à un Islam mutilé, amputé de sa mémoire. Effectuant un réajustement mental, l’orientaliste se placera donc vis-à-vis de son objet d’étude islamique dans cette même position qu’il pourrait adopter envers, disons, l’étude de Gog et Magog ou celle de l’Atlantide. Il appréhendera de même la langue arabe comme une langue morte, et non comme une langue chargée de pouvoir et pour laquelle — et par laquelle — des hommes, aujourd’hui, se constituent en groupes et en partis, se définissent, et luttent pour le pouvoir. Toujours, l’orientaliste évitera d’envisager l’Islam comme « secteur de notre humanité commune » (W.C. Smith dixit), et l’histoire islamique comme phase d’un temps linéaire et qui serait un. L’orientaliste devra effectivement trivialiser son objet de recherche afin de contrer l’utilisation grégaire de son savoir et son annexion par le pouvoir. Borges disait un jour que si l’on faisait abstraction de l’Afrique noire, si l’on supposait que cette Afrique n’avait jamais existé, l’histoire de l’humanité n’en serait pas pour autant différente : avec ou sans l’Afrique noire, les choses se seraient passées de la même façon. Borges entendait par là trivialiser l’Afrique noire, mais il le faisait dans le cadre mental d’une humanité commune et d’une histoire une. Si l’on tente à présent d’appliquer cette logique de trivialisation à l’aire arabo-islamique, l’opération ne réussirait pas. Ou plutôt si : elle pourrait en fait réussir si bien qu’elle ferait voler en éclats le cadre coercitif d’une humanité une et d’un temps linéaire façonnés rétrospectivement par les survivants, qui, écrivant l’histoire, s’approprient les morts et imposent un ordre à la multiplicité. Trivialisant l’Islam, l’orientaliste redistribuerait alors les données islamiques dans une galaxie de mondes possibles (Jaakko Hintikka), mondes possibles conjugués au passé, inactuels et inactualisables, et, partant, difficiles à annexer. Le pouvoir aura beau chercher, il ne lui sera pas facile de les utiliser.
Réajustement mental d’autant plus nécessaire que la réclusion volontaire que l’orientaliste peut s’imposer en se confinant à des domaines d’étude partiels et marginaux (philologie, astronomie, etc.), et le retrait stratégique qu’il peut effectuer dans le temps, loin de la politique et de la polémique, ne suffisent plus, tant s’en faut, à assurer que son travail échappera au pouvoir. Le pouvoir s’empare en effet de la recherche et de l’écriture pour en faire ses choses et s’en servir, non seulement au niveau des recettes de domination ou d’exploitation directe, mais aussi — et c’est par là qu’il touche à ces champs marginaux et à ces siècles reculés chers à l’orientaliste — pour les utiliser dans le cadre de stratégies diplomatiques, culturelles, qui, plus que les politiques de domination et d’exploitation caractérisent la figure contemporaine du pouvoir.[19] Plutôt que de délaisser les zones polémiques de la recherche pour se réfugier, en bonne conscience, dans des objets apparemment innocents, l’orientaliste devra apprendre à se rétracter quand il le faudra, et à dénoncer toute annexion de son savoir par le pouvoir, sans pour autant chercher à faire la part des choses en distinguant une bonne annexion d’une mauvaise annexion (oui à la paix / non à la guerre, oui à l’harmonie / non au chauvinisme, etc.). Par delà les bonnes et mauvaises utilisations du savoir par le pouvoir, c’est le principe même de cette utilisation qui devra être mis en cause. De nos jours, les figures dominantes du pouvoir semblent être l’humanisme moniste, l’intégrisme raciste et, figure la plus puissante : celle qui nait de l’imbrication complice de l’un dans l’autre.[20] L’orientaliste tentera d’éluder les figures de pouvoir qui dominent le moment ; il cherchera à se situer dans une figure minimale, une figure embryonnaire qui ne génère encore du pouvoir que par à-coups, quitte à en sortir aussitôt qu’elle aura acquis assez de cohérence pour pouvoir s’imposer à son tour.
Politique, cette deuxième opération en appelle une troisième, politique aussi, mais également institutionnelle : repenser les rapports entre les orientalistes occidentaux et les historiens, politologues, sociologues et autres savants orientaux qui se penchent sur l’Orient. Il faut en effet se rendre à l’évidence que ces chercheurs (Israéliens, Libanais, Arabes, Iraniens ou autres) font, eux aussi, de l’orientalisme ; et non des moindres, puisqu’ils pensent et représentent, au profit d’un pouvoir établi ou alors d’un projet de pouvoir, des événements, des sociétés, des hommes et des rapports dits orientaux. Et avant que de crier au racisme, considérons plutôt l’hypothèse suivante : en cette période marquée par l’émancipation du tiers-monde et la marginalisation corrélative de l’orientalisme par rapport aux pouvoirs en place en Occident, ce sont en réalité ces orientalistes orientaux qui ont repris à leur compte les vieilles fonctions de l’orientalisme traditionnel. La décolonisation a en effet libéré le tiers-monde et écarté l’orientaliste occidental, puis elle a remplacé ce dernier par le savant « indigène ». Les mots d’ordre, les symboles, les couleurs et l’habit ont peut-être changé, mais la fonction est restée la même. Le chercheur arabe, israélien ou iranien qui étudie « son » histoire et « sa » société se retrouve, vis-à-vis des instances officielles du pouvoir, dans la même position occupée jadis par l’orientaliste occidental qui, du temps des empires, étudiait cette même histoire et cette même société. Colonisation d’un côté, révolution de l’autre, mais toujours récupération et annexion. Tout comme l’orientaliste occidental d’avant-guerre, le chercheur oriental contemporain est souvent l’instrument direct d’un pouvoir en place, sinon d’un autre pouvoir qui cherche à se faire une place. Et, contrairement en cela à l’orientaliste occidental qui est aujourd’hui marginal ou marginalisé, l’orientaliste oriental est directement imbriqué dans le pouvoir : il y joue un rôle formatif. Et voilà que par l’entremise des dialogues nord-sud, des « trilogues » arabo-afro-européens, des colloques redondants et des tournées sur tapis rouge des al-Utah al-kabir, voilà donc l’orientaliste occidental qui se fait le complice d’un collègue oriental plus militant qu’intellectuel, et plus apparatchik que chercheur. Désapprendre l’orientalisme exige qu’on dise non aux élans — encouragés — de sympathie révolutionnaire, qu’on dise surtout non à la mauvaise conscience, a cette culpabilité génétique héritée de la déconfiture coloniale et du traumatisme nazi et, du coup, qu’on refuse d’avoir quoi que ce soit d faire avec des mondanités savantes et des discours sirupeux qui, tous, reconduisent des élites politiques et culturelles orientales souvent trop bien assises, même dans l’opposition.[21] Croyez-vous donne que parce que mon Père a été jadis au service d’un pouvoir colonial, je vais à présent m’acoquiner avec les valets d’un pouvoir révolutionnaire ? Chargé de tous les péchés du monde, l’Ane nietzschéen s’est déjà enfoncé dans le désert. Faut-il donc que je prenne le même chemin que lui en m’inventant de nouveaux péchés ? La véritable rupture avec l’orientalisme traditionnel passe à mon avis par une cassure avec l’orientalisme oriental contemporain. Car ce serait là, non plus une simple substitution de signes et de symboles, mais une véritable césure au niveau même de la fonction du savoir dans la société.
Et pour compenser cette césure — tout en la consacrant d’ailleurs on pensera par exemple à intégrer à l’orientalisme de jeunes esprits heureusement ignorants.de l’Islam et libres de tout savoir orientaliste. À ceux-là, on ne cherchera pas à inculquer les concepts de l’islamologie ; on se contentera de leur assurer la maitrise de la langue (arabe, persan) entendue comme code, comme chiffre. Avec la seule langue pour outil, ces chercheurs travailleront à même les textes (le Kâmil d’Ibn al-Athir, par exemple), élaborant ainsi leurs propres Islams et leur propres Orients, libres de toute essence et de toute identité présupposée. Ils pourront ainsi, peut-être, dire vrai, sans pour autant être dans le vrai de l’orientalisme.[22] Originalité de vue et fraicheur de l’approche viendraient alors pallier les aveuglements et les tares engendrés dans l’orientalisme par trop de mariages de raison et trop de rapports épistémologiques consanguins. Et aux savants orientalistes viendraient s’ajouter des chercheurs « naïfs » qui insuffleraient dans les veines raidies de l’islamologie une saveur nouvelle.
L’orientaliste devra aussi s’attaquer aux formes de son discours afin d’esquiver, dans la mesure du possible, les relations de pouvoir véhiculées par la langue même et d’alléger le pouvoir qu’elle exude. Et là, une première tâche sera de rejeter catégoriquement le langage-transparence qui caractérise (c’est du moins ce que l’on veut nous faire croire) la recherche scientifique. Refuser le langage-transparence, c’est refuser de considérer l’écriture comme étant l’expression limpide d’une pensée déjà cristallisée dans un temps pré-discursif ; c’est aussi refuser d’y voir le reflet fidèle d’un réel fini et qui ne demanderait qu’à être représenté. Refuser le langage-transparence, c’est accepter que la pensée évolue et se forme dans l’acte même d’écriture ; c’est aussi accepter que le réel, qui est un ordre pluridimensionnel, ne coïncide jamais exactement avec le langage qui, lui, est unidimensionnel.[23] L’écriture entretient en effet avec la pensée comme avec le réel des rapports de modification, et de violence porteuse de nouvelles réalités. L’écriture n’est pas un miroir docile, elle n’est pas que mimésis : elle transforme la pensée, elle dé-forme le réel. Rejetant loin de lui le mythe du langage-transparence, l’orientaliste viendra donc s’installer à même ce mur qu’on élève un peu trop facilement entre les savants d’un côté, les écrivains de l’autre. D’un mot, il se créera à tâtons, et loin du langage-transparence dominant, une écriture lisible mais inutilisable. Ce palier d’écriture, on pourrait lui donner le nom d’art, et plus précisément de littérature. En ce temps ou l’art et la littérature de l’Orient, soumis au jeu politique, sont totalement annexés par le pouvoir[24], on cherchera à hâter l’émergence d’un art et d’une littérature orientalistes qui ne seraient nullement pont entre l’Orient et l’Occident, mais qui seraient surtout déportement. Le savoir orientaliste viendrait alors se fondre dans la forme, illustrant ainsi l’importance de la littérature comme outil du désapprentissage. Car la littérature « fait tourner les savoirs, elle n’en fixe, elle n’en fétichise aucun ; elle leur donne une place indirecte, et cet indirect est précieux (...) la littérature ne dit pas qu’elle sait quelque chose, mais qu’elle sait de quelque chose (...) Parce qu’elle met en scène le langage, au lieu, simplement, de l’utiliser, elle engrène le savoir dans le rouage de la réflexivité infinie : à travers l’écriture, le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir, selon un discours qui n’est plus épistémologique, mais dramatique ».[25] Il est bien entendu que dans la mesure où il continuera d’écrire, l’orientaliste ne sera jamais hors-pouvoir. Il fera cependant de sorte à être toujours sortant, en voie de sortie : jamais à l’extérieur, certes, mais toujours vers l’extérieur, dans un transit continu. Et c’est dans ce déplacement constant que l’orientaliste désapprendra l’orientalisme. Il privilégiera l’approche expérimentale aux dépends des recettes méthodologiques, et le style aux dépends des données brutes de savoir ; plus que dans des rapports interdisciplinaires — grégaires par excellence — , c’est dans des rhizomes humains — individuels et pervers — qu’il ira se couler ; et, intégrant à la recherche scientifique la littérature, la musique, le cinéma et, pourquoi pas, la télévision, il délaissera l’écriture verticale de la spécialisation — facilement récupérable — au profit d’une écriture horizontale qui renouerait avec son existence extra-muros. Au niveau même de l’écriture, le travail prendra des formes multiples et personnel, les : Averroès et la rhétorique : Joyce et la ponctuation ; Borges et ses apocryphes ; Pétrarque, Dante et les alternances entre le classique et le vernaculaire ; Barthes et la fragmentation ; Deleuze, Guattari les plateaux et l’écriture à plusieurs : Nietzsche et ses aphorismes ; Michel Serres, Michel Foucault et l’écriture dédifférenciée.[26] On pensera de même, selon, au bilinguisme et au trilinguisme, aux pseudonymes, aux anonymes, à la note infra-paginale digressive. En bref, on fera tout pour intriguer le bibliothécaire, pour embrouiller le fichier bibliographique, et pour dérouter l’expert avide de renseignements.
Mais c’est sur le contenu même du savoir orientaliste que devra porter le travail. Désapprenant, l’orientaliste fera donc abstraction des données traditionnelles de savoir. Ce qui ne veut nullement dire jouer à l’ignorant et négliger les événements, les manuscrits, les monuments et autres traces « arabo-islamiques ». Ce que cela veut dire, c’est qu’il faudrait mettre en question les concepts mêmes qui fondent le principe de distribution des dites traces dans le champ du savoir. Scientifique ou vulgarisé, le discours orientaliste s’articule en effet autour d’une série de concepts organisateurs (tels que Islam, Sunnisme, Arabité, soufisme, etc.) que l’Europe était allée puiser dans le discours même de l’indigène.[27]. Articulant le discours orientaliste et consacrant sa spécificité, ces concepts distribuent et ordonnent tout ce que l’on sait, tout ce que l’on peut savoir, tout ce que l’on pourrait prévoir, au sujet d’une certaine aire géographique et humaine découpée en fonction de ces mêmes concepts, et, en fonction d’eux, dite arabo-islamique. Le mythe du langage-transparence, et la recherche effrénée d’une écriture scientifique dénuée de tout « artifice » littéraire, ont assuré la prépondérance de ces concepts dans l’organisation cohérente, logique et intelligible du prisme orientaliste sur l’aire (arabo-islamique) qu’il découpe du fait même de son fonctionnement.[28] Solidaires — ne serait-ce que par tassement historique et par inertie mentale —, ces concepts fondent l’islamologie articulent son discours, déterminent le découpage universitaire et le partage disciplinaire, canalisent la recherche et façonnent le classement bibliographique. Graduellement, de la simple « lunette » qu’ils avaient été, ces concepts se sont mués en véritables instruments régulateurs et normalisateurs dans l’appareil épistémologique orientaliste. Chemin faisant, et en l’absence de toute mise en question sérieuse, ils ont sacrifié l’intelligence à l’intelligibilité. Surdéterminés par un désir institutionnel de « passer » et de permettre à des interlocuteurs privilégiés de communiquer entre eux, ils ont pour fonction inhérente de comprendre (cerner), d’appréhender (arrêter), de saisir (s’approprier) une réalité et une multiplicité qu’ils ne sont plus à même de penser. Puisés chez l’indigène ou forgés en Europe, ils sont pareils aux programmes informatisés en ce sens qu’ils laissent passer d travers les mailles de leur filet systématisé tout ce qui — vie, événement, singulier, hésitation ou contradiction — ne peut pas, ou ne veut pas, répondre à leur questionnaire. En bref, ces concepts sont devenus l’alpha et l’oméga de toute une recherche qui ne se meut plus qu’en vase clos, puisqu’elle subordonne toute interrogation portant sur les concepts eux-mêmes à une vision de l’histoire et du monde centrée sur ces mêmes concepts.[29] Désapprendre l’orientalisme exige qu’on délaisse ces concepts organisateurs afin de redistribuer les données historiques, les traces, les monuments, dans un espace enfin ouvert et débarrassé des aires essentielles et des structures sophistes d’accueil. Et une telle opération demeure tributaire d’une nouvelle forme d’écriture qui articulerait deux plans — différents, mais complémentaires — de perception et de représentation, A savoir une intuition du singulier et une analyse de situation.
L’intuition du singulier, c’est aller retrouver, par delà les concepts généraux, les signifiants qui sont propres aux hommes, aux événements, aux choses, aux animaux, aux plantes. C’est donc tout d’abord un éloge du nom propre, du singulier et de l’hétéroclite, sacrifiés à l’autel de la schématisation et de la totalisation.[30] L’intuition du singulier, c’est aussi une réhabilitation du genre descriptif, trop souvent décrié, trop longtemps écrasé par une frénésie analytique injustifiée.[31] L’intuition du singulier, c’est de même une redécouverte des corps individuels des sujets historiques »[32] et une réappréciation du genre biographique snobé par la modernité scientifisante et par un mode de pensée qui voudrait qu’intelligence soit synonyme d’abstraction.
Ce recouvrement du singulier et cette libération du multiple ne suffisent pourtant pas à qui veut désapprendre l’orientalisme. Et la valeur d’une telle « désabstraction » ne doit pas rester confinée au domaine esthétique ou littéraire. Encore faut-il que ces données, enfin débarrassées d’un cadre essentialiste et coercitif, soient redistribuées selon un mode dynamique qui leur confère une efficacité épistologique et une fonction critique propres à bouleverser l’espace du savoir. Ce pourquoi l’intuition du singulier devra être intégrée à une analyse de situation. Mais qu’est-ce qu’une analyse de situation ?
Islam, Arabité, Orient et Occident, soufisme, Chiisme : tous ces concepts qui fondent l’orientalisme sont des concepts « codés », chargés à l’avance d’un savoir établi, intelligibles avant même d’entrer en scène pour représenter une réalité nouvelle. Codés, ces concepts renvoient, a priori, à l’identité du signifié, à ses caractéristiques et à l’aire de son possible (qui il est et à qui il s’oppose, ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas faire, jusqu’où il peut aller avant de se disqualifier vis-à-vis du concept qui le désigne). L’analyse de situation, quant à elle, met en œuvre des concepts totalement différents. Ceux-ci ne relèvent en effet ni de l’essence, ni de l’identité, ni du sophisme. Empiriques, fonctionnels, géopolitiques, ils coupent à travers les concepts essentiels sur lesquels se fonde l’orientalisme, et ils les redistribuent et les regroupent — même quand ces derniers semblent être antagonistes — dans des combinaisons variables. Ces concepts de situation ne sont nullement à créer. Ils sont là, mais encore faut-il les libérer des codes ordinateurs auxquels ils ont été jusqu’à présent soumis. Ces concepts existent, et ils ont nom, entre autre, appareil d’État, machine de guerre, désert, montagne, orthodoxe et hétérodoxes (indépendamment de tout contenu doctrinal), foule, plèbe.[33] Contrairement aux concepts codés de l’orientalisme, ces concepts de situation n’ont pas d’ADN. Ce sont des concepts sans qualités intrinsèques qui délaissent l’essence, l’identité et l’histoire-mémoire-savoir pour s’attacher aux relations spécifiques et ponctuelles qui se nouent entre divers individus et groupes, ainsi qu’à leur situation sur une scène historique donnée ou dans un champ discursif précis. Perçus à travers ces concepts de situation, individus et groupes se voient alors affectés d’une identité purement fonctionnelle et relationnelle qui reflète leur efficacité, leur activité et leur possible.
Ainsi, les Mongols de Jinkiz Khân, pour les prendre comme exemple, étaient appareil d’État en Asie intérieure au début du XIIIe siècle, mais ils étaient désert (pillards, nomades, brouillons, ils désertifient) au Moyen-Orient à la même époque. Différence de situation qui n’a rien à voir avec l’essence des Mongols ou avec leur identité, mais avec leur rapport à différents groupes, tant dans l’Asie profonde qu’au Moyen-Orient. De même, au niveau du discours, si les Mongols apparaissent dans les chroniques persanes comme des nomades sédentarisés, islamisés, favorables au développement de la vie citadine, dans les chroniques arabes, par contre, ils sont surtout présentés comme des hordes de tueurs sans foi ni loi, et leur Islam y est souvent occulté. Différence de situation qui, là aussi, n’a rien à voir avec une quelconque essence mongole, mais plutôt avec les rapports savoir/pouvoir : la Perse ayant été dominée et gouvernée par les Mongols, alors que le Moyen-Orient arabe n’a connu ces derniers que sous leur aspect d’envahisseurs, puis, immédiatement après, de vaincus — sacrifiés par l’historiographie arabe au profit des Turcs mamlouks vainqueurs. Articulant le singulier à un prisme de situation, l’orientaliste élaborera donc une véritable dramatisation des Mongols ; soit sur la scène historique, soit sur celle du discours, soit sur les deux en même temps. Les concepts d’identité (Mongol, Mamlouk, Musulman) ne doivent en aucun cas être considérés comme explicatifs en soi, et l’analyse ne doit pas découler du code mental ou épistémologique qu’ils véhiculent. Mais ces mêmes concepts, entendus comme simples points de repère pour le chercheur, doivent être soumis à un prisme situationnel qui les ferait éclater pour les redistribuer selon un mode franchement empirique et dramatique.[34]
Pour mieux envisager la différence entre l’analyse orientaliste et l’analyse situationnelle, examinons à présent deux cas bien documentés. Soit, tout d’abord, l’expansion européenne et le phénomène de la colonisation. Le discours orientaliste — entre autres — sur la colonisation met en œuvre toute une série de concepts essentiels et souvent dichotomiques tels que Orient et Occident, Europe et Islam, nation et religion, modernisme et archaïsme, État-nation et empire despotique. Pourtant, à y regarder de plus près, on peut percevoir, par delà ces concepts codés aux qualités intrinsèques et premières, des catégories purement situationnelles qui sont plus à même d’éclairer la dynamique historique du moment : résultat d’un agencement entre le singulier (un homme, une aventure, un hasard, une découverte scientifique) et une conjoncture d’accueil (des conditions climatiques, des schèmes mentaux, une structure d’État). Comment oublier, par exemple, que la maîtrise anglaise sur les mers à partir de la fin du XVIe siècle ne fut pas le fait de l’État-nation moderne et de sa stratégie consciente, mais de pirates. Ces pirates étaient de véritables machines de guerre, indépendantes de la Couronne, et plus tard récupérées par cette dernière par l’entremise de l’institution de la course : pirate/machine de guerre, corsaire/appareil d’État.[35] Comment oublier que Colomb découvrit l’Amérique par hasard — par déviation du projet d’État dont il était porteur ? Et toute l’expansion coloniale européenne jusqu’au XVIIIe siècle ne fut-elle pas due, essentiellement, à ces machines de guerre que furent les aventuriers, les marchands, les missionnaires, les guerriers, dont le travail fut par la suite, et seulement par la suite, récupéré par l’État-nation moderne ? Et que dire de Ferdinand de Lesseps, dont le projet grandiose de creusement du canal de Suez ne fut adopté par le gouvernement français que quand il était sur le point de s’achever ? Pirates, missionnaires, cadets de familles nobles anglaises, Compagnie des Indes, capitaines et aventuriers écossais, sont des structures situationnelles sans qualité et sans identité autres que celles que leur confère leur déploiement dramatique sur la scène de l’histoire. Coupant à travers les catégories essentielles et dichotomiques (e.g., Orient et Occident), ils assurent, de par leur parcours historique, le passage d’une forme donnée d’État (l’État-nation) à une autre plus efficace (l’empire colonial). L’étude de ces catégories situationnelles ne devra pas se faire dans le cadre d’une aire découpée à l’avance, ni selon des concepts codés et qui leur seraient antérieurs, mais dans le cadre d’un espace et d’un temps d’activité, justement définis par le déploiement et l’efficacité historiques de ces mêmes catégories. L’activité et le dynamisme des individus et des groupes perçus empiriquement doivent fonder l’étude, et non venir se couler — et se perdre dans un moule conceptuel qui subordonne l’action à sa représentation, le possible à l’ADN, et le hasard aux rationalisations rétrospectives. La machine de guerre existe : reste à la voir, sans se laisser leurrer par les schèmes mentaux et épistémologiques réducteurs. Pirates, aventuriers, marchands, missionnaires, ne sont pas l’« Europe ». Ce sont des pions dans un jeu de dames. Sans qualités intrinsèques, ces pions avancent sur l’échiquier historique, acquérant des propriétés et une efficacité en fonction justement, de leur parcours et de leur situation sur l’échiquier. Ce sont donc ces parcours — parcours individuels, singuliers — qu’il convient de reconstruire afin d’élaborer une histoire situationnelle qui élude les explications essentialistes. Hors la conscience de soi et hors la représentation, la scène historique sur laquelle évoluent ces pions n’a en effet nom ni Orient ni Occident, ni Islam ni Europe ; mais c’est cette scène historique qui est esquissée et façonnée par le parcours même des pions qui la traversent.[36]
Autre exemple, l’histoire-légende de Qays et Laylâ. Quand elle n’est pas occupée à discuter le quotient de vérité de l’histoire en question, l’exégèse s’efforce de se représenter les anecdotes et les poèmes qui la constituent en fonction de divers concepts orientalistes et psychologiques tels que Islam, soufisme, oudhrisme, folie, amour, amour chez les Arabes, etc. Procédant par comparaison, l’exégèse appréhende le corpus par référence à d’autres corpus déjà connus, et classés selon un code conventionnel (e.g., littérature des soufis, poésie des oudhrites). Ayant intégré le drame de Qays et sa poésie à une ou plusieurs de ces catégories prismatiques, l’exégèse va, dans un second temps, chercher à établir des rapports entre les dites catégories (e.g., amour/folie, amour/soufisme). L’appareil conceptuel strie donc l’espace et le temps où évoluent le drame de Qays et sa poésie selon un code normatif qui permet à l’exégète de se faire reconnaitre par ses collègues et comprendre par ses lecteurs. Ce faisant, l’exégète se situe assurément dans le vrai de sa discipline, mais il ne dit pas nécessairement vrai. En effet, que Qays ait été formellement perçu comme un fou, un amoureux, un soufi ou un oudhrite, cela ne l’engage en rien à lui, corps historique, sujet parlant. A plus forte raison, si Qays n’a jamais vraiment existé, et si son histoire est collective et apocryphe, cela n’engage en rien les mille et un Qays qui ont pu versifier et qui ne furent ni fous, ni soufis, ni peut-être même amoureux. D’un autre côté, que Qays (au singulier ou au pluriel) ait pu s’annoncer lui-même comme fou, amoureux, soufi ou oudhrite, cela ne nous engage en rien à nous, lecteurs — à moins, bien sûr, d’être sophiste. Que nous importe, finalement, de savoir que Qays s’apparente à Jamîl, ou qu’il rejoint le soufisme ? De telles comparaisons et catégorisations ne servent, tout compte fait, qu’à rassurer le chercheur et le lecteur, déroutés par la singularité et la multiplicité, et qui pourront désormais aller puiser dans leur culture ou leur savoir les éléments qui leur permettront de se représenter Qays en l’assimilant à ce qui est déjà connu. Ce genre d’exercice favorise l’intelligibilité et la communication au détriment de l’intelligence et de la pensée. Il ne faudrait pas faire évoluer Qays et sa poésie dans un décor construit d’avance sur fond d’Islam, d’Arabité, de soufisme et de oudhrisme ; mais ce sont justement Qays et sa poésie qui élaborent, chemin faisant, leurs propres décors. Sur cette scène d’activité et de discours, tout se passe au futur, ou, mieux, au devenir. La vie, on le sait (de même que l’œuvre, d’ailleurs), est avant tout hésitation, interrogation, aventure, contradiction. Ce n’est que plus tard, et rétrospectivement, qu’elle devient mémoire, histoire, système. Négligeant les concepts codés et organisateurs, on ira donc chercher le singulier qu’ils recouvrent : ces parcelles de vie faites de pulsions, d’affects, de stratégies, de trahisons et de retournements tant existentiels que discursifs. Ce singulier, on l’intègrera alors à un prisme situationnel qui éclairerait les diverses options stratégiques s’offrant à Qays, à tout moment, en fonction de ce qu’il dit et fait. Et plutôt que de tenter, à tout prix, de caser Qays chez les fous, les amoureux, les soufis ou les oudhrites, on s’interrogera, non point sur ce que Qays est (identité, essence, ADN), mais sur ce qu’il devient (rôle, situation, fonction, choix, possible) à la lumière, justement, de ce qu’il dit et fait : devenir-poète de Qays qui privilégie le tâshbib au détriment de la possession de l’être aimé ; devenir-subversif de Qays qui délaisse la sagesse et le détachement des soufis au profit d’une stratégie de comploteur : devenir-machine de guerre de Qays qui procède par décodage en amputant toutes les représentations de pouvoir (statut social de fils de sayyid, richesse, habits, etc.) ; devenir-despote de Qays qui se retrouve, dans son exclusion même, au centre de la collectivité ; devenir-éternel de Qays dont le drame et la poésie, véritables syndromes, s’imposent à la postérité. Islam, soufisme, oudhrisme, folie, amour : ces concepts organisateurs et distributeurs perdent alors leur prééminence circulaire et centripète. Éléments, entre autres, d’un système culturel formel, ils viennent recouper à la perpendiculaire la ligne esquissée par les stratégies de Qays et par ses options.[37]
L’étude empirique de fonctions, de relations et de stratégies centrées sur les corps historiques ou discutons autre que situationnelle engendrera de nouveaux découpages spatio-temporels : découpages mouvants, et qui négligent les partages institutionnels et les plages épistémologiques dominants. Une telle étude empirique fera vaciller les concepts trop bien assis, donnés comme a priori du discours, et sur lesquels repose l’orientalisme.[38] Elle bouleversera les départements universitaires spécialisés, l’organisation de la recherche, et la rationalité de nos bibliothèques. Opération drastique, certes ; mais sortir du vrai de l’orientalisme est probablement le prix qu’il nous faudrait aujourd’hui payer si l’on veut espérer pouvoir dire vrai. Sortir du vrai de l’orientalisme et de ses structures d’accueil — structures de capture — afin que les données de savoir, enfin libérées d’un cadre conceptuel réducteur, enfin débarrassées de l’essence, enfin perçues empiriquement, puissent se redistribuer sur une scène spatio-temporelle lisse et ouverte où les seules lignes seraient celles des parcours effectués par les divers protagonistes envisagés au singulier. Telles sont quelques-unes des tâches auxquelles nous convie le désapprentissage de l’orientalisme.
Ce désapprentissage de l’orientalisme n’évolue certainement pas dans une quelconque vacuité épistémologique et politique. Des conditions nouvelles sont en effet apparues qui permettent à mon discours, ici, d’être, et qui favoriseront peut-être l’émergence d’un orientaliste moins servile, moins courtisan. Il ne s’agit nullement de réitérer ici sa confiance en un sujet souverain dont le discours se situerait, ex nihilo, hors pouvoir. C’est on s’en serait douté, les prémices d’une nouvelle figure de pouvoir qui donne encore le ton. Et pour être plus précis, c’est l’essoufflement — presque imperceptible — de la configuration dominante de pouvoir qui rend possible un nouveau discours orientaliste.
Cette configuration dominante de pouvoir qui montre aujourd’hui quelques signes de fatigue remonte à l’entre-deux-guerres. Mais elle s’est surtout imposée lors du vaste mouvement de décolonisation des années cinquante et soixante. Elle a donné naissance à une nouvelle stratégie régissant les rapports entre les anciennes métropoles et feu leurs empires. Bon gré mal gré, les pays occidentaux ont dû réévaluer leur politique envers le tiers-monde et délaisser l’action militaire ou économique directe au profit de l’offensive diplomatique, et même culturelle. Concurremment, l’émergence, sur la scène internationale, de nouveaux États souverains, s’est accompagnée de l’apparition d’un savoir orientaliste tiers-mondiste révolutionnaire et « authentiste » imbu d’exigences nationales de progrès et de développement, et animé d’une volonté de recouvrement d’un passé occulté. Ce savoir orientaliste oriental disputait farouchement les acquis de l’orientalisme traditionnel, et c’est dans cette nouvelle configuration de pouvoir que se situe l’agonie de la vieille école orientaliste et qu’apparait la fêlure entre elle et le pouvoir occidental. Confronté au désir d’affirmation du tiers-monde, l’Occident n’a plus cherché à comprendre l’Orient, à le classer, à le prévoir ; il se contenta désormais — très délicatement et très diplomatiquement d’ailleurs — d’accepter cet Orient tel qu’il se présentait à lui par l’entremise de ses élites politiques et culturelles. La mode était à nouveau au sophisme. Le pouvoir occidental n’a plus voulu puiser sa vision de l’Orient dans l’orientalisme traditionnel ; il est allé la demander au discours que l’Orient tenait sur lui-même. Ce que le pouvoir occidental exigeait à présent de l’orientalisme occidental, c’était surtout de renvoyer vers l’Orient l’image projetée par les élites du tiers-monde — si possible en l’enjolivant, mais toujours en l’entérinant. C’est dire que l’orientalisme occidental s’est trouvé largement marginalisé par rapport aux pouvoirs en place. Certains savants ont bien continué à perpétuer la vieille tradition des recettes politico-économiques d’intervention directe et de rapports étroits avec les gouvernements occidentaux ; mais la majeure partie des orientalistes s’est retrouvée dans le biais d’un pouvoir sur lequel elle n’exerçait plus aucun impact formatif, et auprès duquel elle remplissait désormais une fonction autre de diplomatie, de culture.
Ce réajustement de stratégie bénéficia de la montée d’une nouvelle vague d’orientalistes imbus d’idéaux humanistes et révolutionnaires, trop heureux de pouvoir expier les péchés du Père en se faisant du même coup une place au soleil dans le cadre d’une nouvelle figure du pouvoir. Ces nouveaux orientalistes qui n’avaient, eux, jamais goûté aux plaisirs du pouvoir direct et aux délices de l’impact formatif, acceptèrent avec joie le rôle ornemental et décoratif qu’on leur assignait à présent d’ambassadeurs diplomatiques, culturels : véritables ponts entre l’Orient et l’Occident. Et ce fut l’ère de la Méditerranée, des Andalousies, de l’unesco, des dialogues islamo-chrétiens. Les orientalistes ont voulu voir dans cette distanciation vis-à-vis du pouvoir colonial, et dans cette intimité rédemptrice avec les élites du tiers-monde, une mesure de leur liberté individuelle, de leur empathie objective et de la souveraineté de leur discours. Ils n’ont pas su reconnaître, les malheureux, que si leurs pères avaient jadis été les laquais du pouvoir en place, ils étaient, eux, les laquais des laquais de ce pouvoir : laquais des technocrates, intellectuels et apparatchiks du tiers-monde ; laquais des politologues, économistes et sociologues d’Occident. Surtout, ils n’ont pas réalisé que leur humanisme et leur révolution faisaient partie de cette nouvelle fonction d’apparat qui leur était à présent dévolue dans le cadre d’une nouvelle figure du pouvoir. Leurs pères traitaient directement avec des ministres, des généraux, des haut-commissaires ; eux ont à faire à des leaders tiers-mondistes d’un jour, à des attachés culturels, à des sous-fifres onusiens. Anesthésie générale résultant de l’anthropologisme dominant et de la mauvaise conscience européenne, et à laquelle contribuaient la multiplication des carrières, la floraison des départements et des chaires et l’accélération de la production et de la propagation du discours. On dénonça donc allègrement l’orientalisme traditionnel, on métamorphosa l’annexion du nouveau savoir orientaliste par le pouvoir en révolution de la conscience, et on réitera sa foi en la souveraineté du sujet et de son discours. Et plutôt que de profiter de la brèche ainsi ouverte, l’orientaliste se fit maçon et entreprit de la colmater.
Mais voici qu’on se rapproche peut-être aujourd’hui d’un nouveau seuil de rupture. Tout d’abord, la culpabilité engendrée tant par le pillage du tiers-monde que par le nazisme recule jusqu’aux confins des mémoires. C’est que la décolonisation a été menée à terme ; et le tiers-monde s’affiche à présent agressivement, alors que le pillage — indigène cette fois — continue.[39] C’est que, d’un autre côté, Israël, création expiatoire, se porte bien, merci — trop bien même au goût de certains, effrayés par la puissance de l’État juif et rendus perplexes par son racisme à rebours.[40] Ensuite, la génération pétrifiée par le dernier conflit mondial s’efface, et avec elle les visions existentielles d’un holocauste généralisé. Depuis l’avènement de l’ère atomique, plus de cent dix conflits majeurs ont éclaté, sur toute la surface du globe, et la conflagration atomique tant redoutée ne s’est pas concrétisée. On s’est finalement rendu compte qu’il était en fait possible de mener une guerre, même de grande envergure, même dans les points « chauds », sans pour autant mettre en péril la paix du monde et l’avenir de l’homme.[41] En dépit de la prolifération des nucléaires (ou peut-être même à cause de cela), l’éventualité d’une guerre terminale s’éloigne, et les armes conventionnelles reprennent petit à petit leurs droits, longtemps usurpés par le grand frère dissuasif. Et à mesure que s’évanouit le spectre obsédant du champignon atomique, des ambitions, des fureurs, des calculs et des discours jusqu’alors frappés d’interdit surgissent sur la scène géopolitique et diplomatique, ébranlant la vision bicéphale et apocalyptique du monde née de la guerre froide, et minant du fait même tous les organismes, toutes les idéologies et tous les mots d’ordre unitaires et castrateurs qui lui servent de (mauvaise) conscience. La vision manichéenne d’un monde régi par les deux superpuissances et uni par la hantise de leur confrontation finale à coups de missiles atomiques s’effrite. Concurremment, les idéologies humanistes, monistes et universalisantes qui prennent le contre-pied de cette vision se mettent à chanceler. Et ce n’est pas par hasard qu’on assiste aujourd’hui au discrédit croissant des organismes internationaux qui alimentent et propagent le mythe unitaire, prétendant retarder l’échéance atomique fatidique en empêchant les conflits localisés qui sont censés nous y mener. Se dénoue alors le lien rattachant les conflits localisés à la troisième — et dernière — guerre mondiale. Du coup, les organisations internationales d’entraide, de coopération, et de dialogue salutaire entre le peuple apparaissent sous leur vrai jour : des lieux privilégiés de logorrhée, des instances de production et de propagation de diarrhée verbale qui ont de plus en plus de mal à occulter un réel qui les déborde.[42]. Les théories sur la finitude de l’homme raffinées et consacrées par la pensé classique [43] se déconstruisent, et nous nous retrouvons probablement aujourd’hui dans une situation analogue à celle que durent vivre, au Moyen Age, les Chrétiens qui n’en finissaient plus d’attendre la fin du monde et le règne de l’Antéchrist, annoncés pour l’an mil. Subrepticement, nous sommes passés de la psychose de la guerre atomique à celle de l’accident nucléaire, de la fatalité nucléaire au fatalisme tout court, et de la notion de l’escalade « logique » à celle du « monstre ». De nos jours, on craint certainement plus l’accident nucléaire (e.g., une fuite dans une centrale) que le déclenchement prémédité d’une guerre atomique à l’échelle du globe. Même dans le cadre du militaire, ce qui hante surtout les consciences c’est la possibilité d’un accident, d’une erreur qui provoquerait le lancement irréversible d’un missile nucléaire et les conséquences irrémédiables qui en découleraient. Et pourtant, l’insistance accrue sur l’accident dénote bien l’embarras d’un monde de pensée apocalyptique qui doit à présent aller puiser sa justification aux marges de la logique guerrière, dans des catégories « monstrueuses » qui lui sont en réalité exogènes (accident, erreur, folie, aveuglement). Certes, tant que persistera la peur de l’accident, la vision apocalyptique du monde ne disparaitra pas tout à fait. Et cependant, la notion d’accident reflète une flexion certaine dans nos schèmes mentaux, et elle annonce la déconstruction de la psychose qui nous habite. En effet, dans neuf cas sur dix (et dans tous ces cas où le déclenchement accidentel ou « fou » d’une explosion nucléaire n’implique pas la structure militaire des deux super-grands) l’accident nucléaire est essentiellement et prévisiblement limité, tant dans son aire d’impact que dans ses conséquences (fuite dans une centrale nucléaire en France, accident lors d’un essai atomique dans le Pacifique, et même, à la rigueur, bombe indienne contre le Pakistan ou bombe israélienne sur Bagdad). Et la lutte contre de tels accidents engage surtout des aires géopolitiques limitées et des groupes restreints (l’Europe perçue comme champ de bataille entre les deux supergrands, les habitants d’une région où s’est implantée une centrale nucléaire, etc.). La notion d’accident a donc pour conséquence de privilégier les luttes partielles au détriment des luttes globales, et de valoriser les identifications existentielles et singulières (Européens menacés par les Pershing ou les SS20, Pennsylvaniens vivant dans l’ombre d’une centrale nucléaire) aux dépends des identifications globales et universalisantes (l’homme, l’humanité). La « démocratisation » du nucléaire et sa propagation ont eu pour effet de banaliser les armements et les énergies nucléaires et d’« atomiser » l’humanité en fragmentant et en dispersant justement les sources possibles de destruction. Fragmentation, dispersion et prolifération qui font que le fait nucléaire échappe de plus en plus à l’« homme » pour retomber en deçà de lui, sur des communautés particulières. Lentement, on passe de la fatalité nucléaire érigée en système à un fatalisme, et de la résistance idéologique globale à une résistance existentielle, localisée. Du coup, c’est l’assiette unitaire même de l’anthropologisme qui se met à basculer. Mais il y a encore plus dans cette notion d’accident. En effet, si l’accident nucléaire fait partie intégrante du possible nucléaire, il reste néanmoins largement extérieur à la fatalité nucléaire (il est moins certain que probable, et moins probable que possible). Arbitraire et imprévisible par définition, l’accident demeure largement extérieur au système nucléaire guerrier, et surtout à la logique militaire ; il n’obéit pas aux lois des tensions internationales, de la surenchère, de l’escalade (il n’a rien à voir avec un conflit localisé donné, il ne s’intègre pas à un processus d’escalade dont il constituerait le point culminant et le seuil qualitatif de rupture). En réalité, la notion d’accident nucléaire tranche le lien coercitif qui unit la guerre conventionnelle à la guerre atomique, et il permet par conséquent le développement et la prolifération illimitée de la première enfin libérée de la hantise de l’escalade et du passage fatidique du stade classique au stade atomique irréversible. En sa qualité de « monstre » extérieur à la logique militaire nucléaire, l’accident permet en fait aux États et aux peuples de se faire la guerre sans complexe ; d’être Blancs, Noirs, Juifs ou Chrétiens avant d’être « homme ». Et le fondement unitaire de l’anthropologisme s’en ressent. Assurément, on n’a pas assez pensé la guerre atomique comme l’un des fondements essentiels de notre vision unitaire du monde et des hommes, solidaires par continuité destructive.
Assisterait-on à l’essoufflement de l’humanisme moniste ? On pourrait le croire, à entendre l’anthropocentrisme, de concert avec la nouvelle théologie sa complice, crier au dogmatisme, mettre solennellement en garde contre une réaction « humaine » désastreuse, et pleurer la mort de l’homme. Mais ne nous y trompons pas. Nombre de phénomènes singuliers et a-unitaires (illuminés, pervers, absentéistes, idolâtres, isolationnistes, nihilistes et autres) qui débordent aujourd’hui l’anthropologisme ne constituent nullement — comme on voudrait nous le faire croire — un avatar du dogmatisme, et ils n’annoncent aucunement une réaction ou un retour aux siècles « obscurs ». Largement incapables de penser le nouveau, nos schémas perspectifs se sont néanmoins empressés de taxer toute une pensée de « nouvelle droite », et certains ont même voulu voir dans l’œuvre de Michel Foucault une renaissance du nazisme.[44] Et pourtant, ni la « nouvelle droite », ni le post-anthropologisme, ni l’émergence violente des particularismes, ne constituent un réveil du dogmatisme. Contrairement à ce dernier, qui opère un repli vers l’arrière, eux effectuent en réalité une fuite en avant : tels les Scythes décrits par Hérodote, ils sont en effet passés maitres dans l’art de la non-bataille.[45] Et contrairement au dogmatisme, création d’un autre âge que la modernité charrie, eux s’inscrivent probablement dans une configuration post-moderne. Ils ne se confondent pas inévitablement avec le dogmatisme et le racisme où l’on s’efforce à tout prix à les caser. En effet, le dogmatisme et le racisme, pré-modernes et modernes, se présentent sous deux aspects essentiels, à savoir : d’un côté un particularisme qui n’arrive à penser que le particulier, qui ne connaît pas le monde qui lui est extérieur, et qui ne peut pas agir sur ce dernier (e.g., une tribu pygmée) ; et d’un autre côté, un particularisme qui pense le monde entier, qui veut agir sur ce monde, et qui cherche à le façonner à son image (e.g., l’Islam, l’expansion européenne, le fascisme, le communisme). Alors que les phénomènes particuliers et a-unitaires qui débordent aujourd’hui l’humanisme et l’anthropologisme sont, eux, tout à fait autres. Il s’agit en effet là de particularismes et de particuliers qui, ayant pensé le monde extérieur à eux, et l’ayant déjà connu scientifiquement, refusent désormais de le connaître affectivement.[46] Ils ne se reconnaissent plus dans le monde et dans l’homme, et tout en les ayant pensés, ils s’abstiennent d’agir sur eux. Ces particularismes et ces particuliers n’ont donc pas de « projets ». Contrairement à ceux du premier groupe (e.g., pygmées), les particularismes post-modernes ont connu et vécu les schémas perceptifs unitaires. Et contrairement à ceux du deuxième groupe (e.g., Islam), eux n’ont pas de projets unitaires : à l’utopie de ces derniers, ils opposent une véritable hétérotopie.[47] Tout comme on n’a jamais vraiment pensé la guerre atomique comme fondement unitaire, de même, on n’a jamais vraiment voulu penser l’utopie comme pièce essentielle du prisme unitaire qui nous livre le monde et l’homme.[48] Or, en s’abstenant, en refusant l’utopie, les particularismes post-modernes, hétéroclites, font vaciller le plan même sur lequel se bâtit l’unité — quelle qu’elle soit. Et c’est cela qui fait trembler l’anthropocentrisme et la nouvelle théologie qui tentent, à tout prix, d’empêcher l’avènement de l’hétéroclite et sa conséquence inévitable : le règne chaotique de l’aphasie. Dans l’orientalisme de même, on voit s’esquisser une crise qui a nom : trivialisation, saturation, et désillusion. Tout d’abord, dans ce secteur minoritaire de l’orientalisme occidental qui cherche à pérenniser la fonction séculaire de service à la patrie inaugurée par un Savary de Brèves ou un Silvestre de Sacy, on perçoit un décalage croissant entre l’expertise orientaliste d’un côté, l’informatisation galopante des données de savoir, de l’analyse politique, du renseignement et des techniques guerrières de l’autre. On assiste de même à une véritable banqueroute prévisionnelle des savants orientalistes leurrés, par exemple, par le mythe d’un Chiisme aryen, incapables de penser la révolution islamique, ou pris de court par l’éruption violente des Chrétiens du Liban. De moins en moins sollicités par un pouvoir informatisé — ou alors intuitif —, ces experts orientalistes reportent vers les médias des analyses devenues folkloriques. Et c’est à croire que les pouvoirs en place en Occident ont réalisé bien avant eux l’importance qu’il y aurait à traiter avec l’autre empiriquement et selon des critères géopolitiques, sans référence aucune À l’identité, à l’essence ou à l’ADN.[49] Ensuite, dans le secteur majoritaire de l’orientalisme, moins directement lié au pouvoir en place et qui s’inscrit plus justement dans une configuration mondiale de pouvoir, on voit surgir une saturation née de la récession économique, de la momification progressive des structures institutionnelles du savoir au cours des trente dernières années, de l’éclosion à retardement de vocations en surnombre, ainsi que de la nature même d’un discours néo-orientaliste essentiellement sophiste et qui puise son efficacité dans son rapport à des figures politiques où intellectuelles quasi mythiques. Désillusion enfin, nihilisme même, qui effleure la dernière génération d’orientalistes. Eux n’ont jamais eu le plaisir de rencontrer un Nasser, un Ben Gourion ou un Khoméini. Révolution, retour aux sources, progrès, authenticité : ces oripeaux idéologiques si aisément permutables et qui hypnotisent leurs ainés, n’exercent plus aucune fascination sur leurs âmes blasées. Et dans ce Grand Carnaval humain auquel on les convie, ils ne voient que spectres morbides et pensée desséchée. Fêlure.
[1] W. C. Smith, On Understanding Islam (La Haye : Mouton, 1981).
[2] On pensera par exemple au serment féodal (fides : foi), qui est lien et engagement. Cf. Georges Duby, Vie privée, vie publique dans la société féodale, cours au Collège de France (1981-1982). Notons qu’en latin fides sert de substantif au verbe credo.
[3] « Jacobson l’a montré, un idiome se définit moins par ce qu’il permet de dire, que par ce qu’il oblige à dire (...) le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire », Roland BARTHES, Leçon (Paris : Seuil, 1978), pp. 12 et 14.
[4] « Plus le chercheur contemplatif est objectif, et moins il fonde un bonheur éternel, c’est-à-dire son bonheur éternel, sur sa relation avec l’objet de sa recherche ; puisqu’il ne peut être question de bonheur éternel que pour le sujet qui est passionnément et infiniment intéressé. », KIERKEGAARD, Concluding Unscientific Postscript, trad. anglaise par D. Swenson et W. Lowrie (Princeton : Princeton University Press, 1941), Livre I, p. 33.
[5] « La poussière et le nuage », dans L’impossible prison, ed. par Michelle Perrot (Paris : Seuil, 1980), p. 32.
[6] Indice de la gêne du profane face à une écriture non-profane : inaccoutumés, mes doigts ont longtemps hésité devant le clavier de ma machine à écrire avant de trouver les touches qui, ensemble et dans l’ordre, énonceraient le mot : Vérité.
[7] Symbole caricatural de cette tendance : l’unesco refuse de financer un ouvrage sur l’héraldique musulmane parce que le projet évoque la guerre.
[8] Le mot est de Valéry Giscard d’Estaing. En dépit du contresens évident, il a pris : indice d’un désir profond de totalisation.
[9] Cf. par exemple le titre de l’ouvrage de Roger GARAUDY, L’Islam habite notre avenir.
[10] Il faut croire qu’on a fait bien du chemin depuis ce XVIe siècle où l’on pensait que la sympathie entre les êtres, les choses et les éléments (e.g., racines → eau, tournesol → soleil) « est une instance du Même si forte et si pressante qu’elle ne se contente pas d’être une des formes du semblable : elle a le dangereux pouvoir d’assimiler, de rendre les choses identiques les unes aux autres, de les mêler, de les faire disparaître en leur individualité, — donc de les rendre étrangères à ce qu’elles étaient. La sympathie transforme. Elle altère, mais dans la direction de l’identique, de sorte que si son pouvoir n’était pas balancé, le monde se réduirait à un point, à une masse homogène, à la morne figure du Même (...) C’est pourquoi la sympathie est compensée par sa figure jumelle, l’antipathie. Celle-ci maintient les choses en leur isolement et empêche l’assimilation (...) Par ce jeu de l’antipathie qui les disperse, mais tout autant les attire au combat, les rend meurtrières et les expose à leur tour à la mort, il se trouve que les choses et les bêtes et toutes les figures du monde demeurent ce qu’elles sont. », Michel FoUCAULt, Les mots et les choses (Paris : Gallimard, 1966), p. 39.
[11] Notons, par exemple, que jusque dans les années soixante, le Ministry of Defence britannique s’appelait encore le War Office. Et que dire, alors, de Tsahal : Force Défense Israélienne.
[12] Sur le passage d’une recherche de la Vérité par l’affect à une recherche de la Vérité par la raison (« moment cartésien »), voir Michel FOUCAULT, L’herméneutique du sujet, cours au Collège de France (1981-1982).
[13] Contrairement à ce que W.C. Smith et tant d’autres voudraient nous faire croire, ces phénomènes particuliers ne sont pas un avatar du dogmatisme, et ils n’annoncent pas un retour aux siècles « obscurs ».
[14] « On a supprimé ici les noms de quelques-uns de nos auteurs. Celui qui partage le sentiment de Charlotte à leur égard trouvera leurs noms dans son cœur. Et quant aux autres, qu’ont-ils besoin de le savoir. » (Goethe, note à Werther).
[15] Pour des raisons de commodité, orientalisme et études arabo-islamiques seront employés ici de manière interchangeable.
[16] Voir « Orientalistes éconduits, Orientalisme reconduit », dans Arabica, XXVII (2).
[17] On sait que lors de son jeûne dans le désert, Jésus avait été tenté par le diable trois fois. Et trois fois Jésus résista à la tentation. Mais on dit (Somerset MAUGHAN, Le fil du rasoir) qu’en réalité l’histoire ne s’arrêta pas là. Satan revint en effet à la charge et dit à Jésus : « Si tu acceptes la honte, la disgrâce et le malheur, une couronne d’épines et la mort sur la croix, alors tu sauveras la race humaine. » Et Jésus succomba.
[18] Roland BARTHES, Leçon, op. cit., p. 12.
[19] L’unesco n’a d’ailleurs rien inventé. À la fin du XIXe siècle déjà, Guillaume II ...
[20] Cf. par exemple le discours humaniste et conciliant de l’Europe qui reconduit et renforce le racisme à rebours du tiers-monde et le pouvoir sectaire de certains régimes, et ce, pour des considérations de fournitures énergétiques, de politique interne, ou de mauvaise conscience : les Arabes et le pétrole, les Africains et la culpabilisation post-coloniale, les Israéliens, Dachau et l’électorat juif.
[21] Je lisais dernièrement les mémoires d’un éminent journaliste et nationaliste arabe dont je tairai le nom, et qui écrit qu’à la suite de la guerre de juin 67, il avait souffert d’une désillusion telle qu’il avait fait savoir aux gouvernements arabes qu’il ne reviendrait plus vivre dans le monde arabe avant la libération de Jérusalem. Son exil ? Eh bien, la Suisse !
[22] Sur la différence entre dire vrai et être dans le vrai, voir Michel FOUCAULT, L’ordre du discours (Paris : Gallimard, 1971). p. 37.
[23] Voir Michel FOUCAULT, Les mots et les choses, op. cit., p. 25, et Roland BARTHES, Leçon, op. cit.. p. 22.
[24] Ainsi, le Festival du Monde de l’Islam qui s’est tenu il y a de cela quelques années à Londres : festival culturel, mais aussi mondain, diplomatique et politique. De mème, les fonds qui permettent aux départements universitaires occidentaux d’art et d’architecture islamiques de fonctionner.
[25] Roland BARTHES, Leçon, op. cit. pp. 18-19. Sur le rapport de la littérature au savoir, voir aussi Michel FOUCAULT, Les mots et les choses, op. cit., pp. 57-59 et 307-313
[26] Sur l’écriture dédifférenciée comme outil de désapprentissage et, du fait même, instrument pour une analyse plus poussée, voir Michel FOUCAULT, Les mots et les choses. op. cit., et surtout la description qu’il donne des Ménines de Velasquez au chap. I et l’analyse qu’il fait des Physiocrates et des Utilitaristes au chap. VI (le mode dédifférencie d’écriture est présenté par l’auteur aux pages 24-25 et 213-214).
[27] Dans ce sens on pourrait dire que l’orientalisme faisait de l’histoire des mentalités (de façon sophiste, il est vrai) avant la lettre.
[28] Illustration de la prépondérance de ces concepts-cles : un orientaliste français qui ignore l’italien ou l’espagnol peut néanmoins lire les travaux de ses collègues italiens et espagnols. Et ce dans la mesure, justement, où le discours orientaliste articule une structure grammaticale et logique minimale (langage-transparence) autour de concepts conventionnels et transculturels.
[29] Ces concepts ne sont pas ce que l’on cherche à élucider, mais ce, justement, à partir de quoi on commence à parler.
[30] Bel exemple de cet éloge du singulier en cette fin du XXe siècle, La Géographie humaine du monde musulman d’André MIQUEL, dont les tomes II et III renferment quelque deux mille noms propres de pays, de villes, de peuples, de dynasties et de personnes.
[31] Voir par exemple les belles descriptions de Raoul BLANCHARD, dans la Géographie universelle, éditée par Gallois et Vidal de la Blache, et le beau livre de Steven Runciman sur la chute de Constantinople.
[32] À propos de Michelet, Barthes écrit que l’histoire « n’est pas un puzzle à reconstituer, c’est un corps à étreindre. L’historien n’existe que pour reconnaître une chaleur. », Roland BARTHES, Michelet (Paris : Seuil. 1954), p. 73.
[33] Comme dit Jacques BERQUE dans L’Égypte, Impérialisme et Révolution (Paris : Gallimard, 1967), la foule n’est qu’un moment du peuple. Et dans « Pouvoir et stratégies » (Les révoltes logiques, numéro 4, 1977), Michel Foucault insiste sur le fait que la plèbe n’existe pas vraiment, mais qu’il y a plutôt de la plèbe dans les individus et les groupes.
[34] C’est à une telle analyse de situation que je me suis essayé, avec plus ou moins de bonheur, dans Territoires d’Islam (Paris : SINAD, 1982). L’aspect négatif et coercitif des codes ordinateurs et des ADN apparaît clairement dans le cas de l’analyse de la crise libanaise. Polititologues et journalistes utilisent volontiers le terme de Phalangistes quand ils veulent parler des Kataëb (katā’ib, en arabe, voulant dire phalanges). Or ce terme est codé, puisqu’il renvoie à la Phalange espagnole. Il est aussi réducteur, puisqu’il impose un rapprochement entre le parti libanais des Kataëb et le fascisme. Et il est surtout intelligible, puisqu’il permet au lecteur occidental de situer ces Kataëb, qu’il ne connaît pas, en fonction d’une histoire européenne qui lui est familière. Mais qu’importe, finalement, que Kataëb veuille dire Phalanges ? Et qu’importe aussi que les Kataëb eux-mêmes aient, en 1936, sciemment choisi ce nom par référence à la Phalange espagnole ? Reste à voir quel rapport il pourrait y avoir entre le fascisme européen des années trente et un quelconque fascisme libanais des années soixante-dix et quatre-vingt. L’appellation Kataëb ne doit en aucune façon venir préjuger de l’analyse et déterminer notre perception de la structure du parti, de sa stratégie, de son impact et de son possible dans le contexte libanais. Délaissant codes et ADN, on envisagera donc les Kataëb empiriquement, à la lumière de leurs rapports avec les autres protagonistes. Le caractère coercitif des codes ordinateurs déborde largement le cadre de la perception et de l’analyse politique pour se retrouver dans toutes les sphères de l’activité humaine. Dans le domaine militaire, par exemple, la guerre récente pour les Falklands a bien démontré les limitations grossières que le codage imposait à ce fleet in being qui avait jadis fait la grandeur de l’Angleterre. En effet, la flotte britannique qui appareilla au printemps de 1982 pour aller reconquérir les îles Falklands sur l’Argentine était fortement codée dans ce sens que sa conception et son armement étaient programmés pour contrer, dans le cadre de l’Otan, une menace émanant du bloc soviétique (système antimissiles programmé sur les missiles soviétiques, porte-avions sacrifiés au profit des porte-aéronefs, dépendance logistique vis-à-vis des États-Unis). Or, dans l’Atlantique sud cette flotte codée se trouva confrontée à un ennemi argentin appartenant au bloc occidental. Et dont l’armement, qui n’avait rien de soviétique, échappait largement aux codes régissant le système défensif britannique, codes rivés sur les conflits géostratégiques entre blocs et sur la guerre nucléaire. On sait le prix que la flotte de Sa Majesté eut à payer en conséquence de ce codage.
[35] Dans les flottes de guerre modernes, le sous-marin fait figure de véritable navire pirate (cf. la mythologie des U-Boats au cours de la dernière guerre mondiale). Or, il est intéressant de noter ici que dans la flotte britannique, la coutume veut qu’un sous-marin de retour de mission arbore le pavillon pirate
[36] Sur la machine de guerre, simple pion sans ADN ni qualités intrinsèques premières, voir Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI, Mille plateaux (Paris : Minuit, 1980), chap. 12 et 13
[37] « .. car la chaîne signifiante par quoi se constitue l’expérience unique de l’individu est perpendiculaire au système formel à partir duquel se constituent les significations d’une culture : à chaque instant la structure propre de l’expérience individuelle trouve dans les systèmes de la société un certain nombre de choix possibles (et des possibilités exclues) ; inversement les structures sociales trouvent en chacun de leurs points de choix un certain nombre d’individus possibles (et d’autres qui ne le sont pas), — de même que dans le langage la structure linéaire rend toujours possible à un moment donné le choix entre plusieurs mots ou plusieurs phonèmes (mais exclut les autres). », Michel FOUCAULT, Les mots et les choses, op. cit., p. 392. Pour un Qays « sans qualités » (ou presque), voir André MIQUEL, Une histoire d’amour fou, cours au Collège de France (1982-1984).
[38] Voir à ce propos M. ARKOUN, « Religion et société d’après l’exemple de l’Islam », dans Studia Islamica, LV (1982), pp. 27-29.
[39] Ainsi, lors du dernier conflit pour les Falklands, l’offensive diplomatique argentine axée sur la décolonisation et l’agression impérialiste de la Grande-Bretagne n’a pas payé.
[40] E.g., l’intervention israélienne au Liban en juin 1982 a probablement sonné le glas du mythe du petit État pionnier et courageux et levé l’immunité dont bénéficiait Israël dans les milieux occidentaux.
[41] Et il semble bien que cette désescalade du sentiment de responsabilité s’accompagne d’une diminution sensible du sentiment d’engagement global et d’identification avec le monde et avec l’humanité.
[42] Pacifiques, neutres, absentéistes, isolationnistes, et menfouchistes par excellence, les Suisses ont bien, jusqu’en 1982, refusé d’intégrer l’onu qui, pourtant, prône le pacifisme, le neutralisme et la non-ingérence. À croire que les mots n’ont pas le même sens dans le discours public (onu) et dans la pratique (Suisse), et qu’entre pacifique et pacifiste, neutre et neutraliste, il y a tout un monde : celui, peut-être, de la production d’un sens universel.
[43] E.g. Ricardo et l’immobilisation de l’histoire, Marx et sa vision eschatologique d’une société ultime sans classes, Lénine et sa représentation de l’impérialisme comme stade suprême — et donc dernier — du capitalisme.
[44] Tel ce psychanalyste cité par Gilles DELEUZE (Un nouvel archiviste (Montpellier : Fata Morgana, 1972) pp. 9 et 51) qui compare Les mots et les choses à Mein Kampf et voit dans Foucault un suppôt de Hitler.
[45] « Au moment où il semble que Darius va finalement obtenir ce qu’il attend depuis le début, une bataille, une vraie, où les Scythes prennent position en ordre de bataille face à l’armée perse, comme s’ils allaient en venir aux mains, un lièvre passe entre les deux armées... Alors, au fur et à mesure que le lièvre avance, les Scythes rompent leur ordre de bataille et, sans plus se soucier des Perses, se mettent à le poursuivre : ils ont trouvé un gibier plus drôle … », François HARTOG, Le miroir d’Hérodote (Paris : Gallimard, 1980), pp. 61-62.
[46] Sur la connaissance scientifique et la connaissance affective, voir Ferdinand ALQUIÉ (auteur de La conscience affective (Paris : Vrin, 1979), « Le savoir affectif », dans Le Monde Dimanche du 27 juin 1982.
[47] J’emprunte ce terme à Michel Foucault.
[48] Voir Michel FOUCAULT, Les mots et les choses, op. cit., pp. 9-10, 265-275 et 329-333.
[49] Réfléchissant en termes d’identité et d’ADN, l’analyste s’empêche de voir l’aide militaire que l’Iran khoméiniste reçoit d’Israël, ou d’accepter que la guerre n’est nullement antinomique avec une économie de services, comme nous l’apprend le cas du Liban.