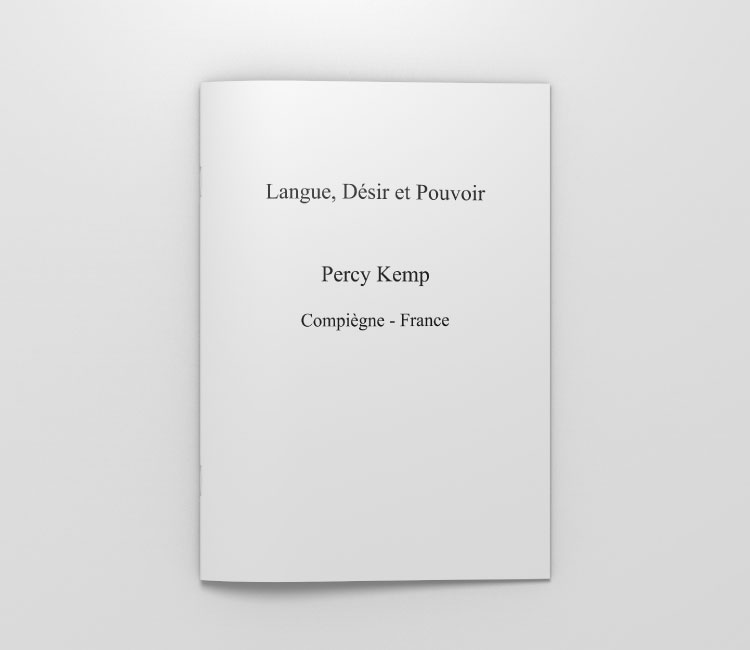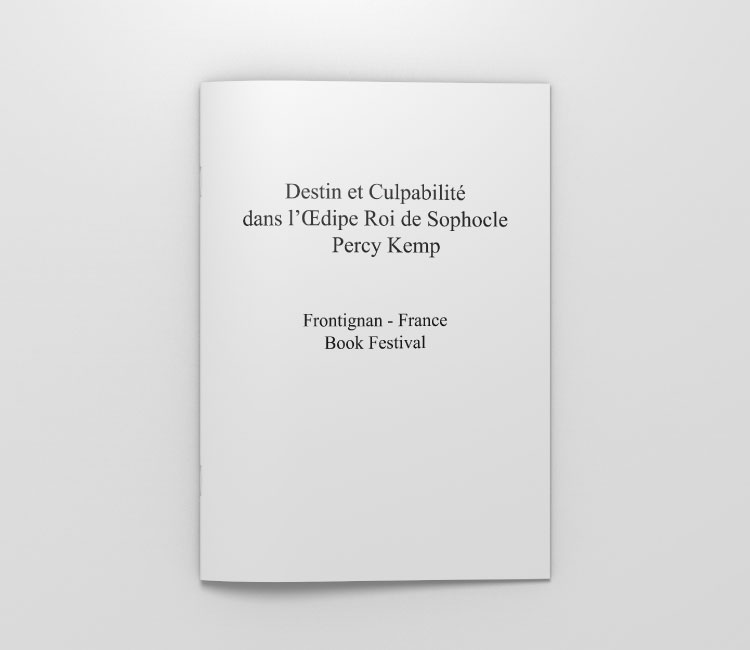J’aimerais ce soir vous entretenir des relations que la langue entretient avec le désir et avec le pouvoir.
Dans un premier temps, je tenterai de répondre à la question de savoir pourquoi, lorsqu’on en a le choix, on choisit d’écrire dans une langue plutôt que dans une autre.
Dans un deuxième temps j’aborderai, plus généralement, la question du langage et de ses relations avec le pouvoir.
Langue, désir et pouvoir. Quel type de relations entretiennent-ils entre eux ?
Et d’abord, le choix de la langue dans laquelle on écrit. Qu’est-ce qui fait qu’une personne à qui les hasards de la vie auraient donné le choix de s’exprimer de manière intelligible, cohérente, gracieuse, artistique, dans plus d’une langue, choisit d’écrire dans l’une plutôt que dans une autre ?
La réponse évidente serait de dire que cette personne-là écrirait naturellement dans sa langue maternelle. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas : Nabokov et Gibrane ont choisi d’écrire en anglais, Elias Canetti en allemand, Beckett en français.
En réalité, lorsqu’il s’agit de l’écrit, il n’y a pas à mon sens de langue maternelle qui tienne. La langue maternelle, la vraie, est celle de l’oralité et de la spontanéité, alors que la langue écrite est celle de la composition et de la réflexivité. La langue maternelle nous permet d’extérioriser nos émotions sans calcul, sans retenue, sans stratégie. C’est le langage que nous utilisons pour nous exprimer sans avoir à nous soucier d’intelligibilité, de cohérence, de rayonnement et encore moins de notre image. C’est la langue que nous utilisons sans y penser lorsque nous émettons des jurons, lorsque nous appelons notre enfant Titounet, notre conjoint Toutouche. Imaginez un peu que je me mette à parler ici, en public, comme je parlerais, disons, à ma femme, au lit. Ce serait la camisole de force : non pour raison obscénité, mais pour raison—excusez le jeu de mots—de déraison. Obscène, je ne me disqualifierais aux yeux de certains, que pour mieux me qualifier aux yeux d’autres. Déraisonnable, je me disqualifierai aux yeux de tous.
La langue écrite, elle, n’a rien à voir avec la langue maternelle, ou alors si peu. Ecrite, elle implique nécessairement une césure. Un effort de réflexion (je réfléchis, et je me réfléchis aussi). Ce faisant, elle nie la spontanéité. C’est un peu comme, au cinéma, la différence entre une star et un véritable acteur : la star ne joue jamais que son propre rôle et finit par ne plus jouer ; l’acteur, lui, compose des rôles. Si, dans l’oralité et la spontanéité, c’est mon centre émotionnel qui domine, dans la langue écrite, mon centre émotionnel est bridé par mon centre intellectuel.
Cela pour dire que lorsqu’il s’agit d’écriture et de littérature—a fortiori lorsqu’il s’agit de discours savant--, il n’y a pas de langue maternelle qui tienne : aussitôt qu’on maîtrise une langue entendue comme outil (aussitôt qu’on maîtrise sa grammaire, sa syntaxe, son vocabulaire), on peut en user, qu’elle soit ou non notre langue maternelle. Ce qui explique Beckett et le français, Canetti et l’allemand, Gibrane, Nabokov et l’anglais.
Alors, si on n’écrit pas nécessairement dans sa langue maternelle, pourquoi écrit-on dans une langue plutôt que dans une autre ? Une réponse couramment entendue est : je me sens plus à l’aise dans cette langue-ci ; elle correspond mieux à ma structure de pensée. Fadaises. Comme si la pensée pouvait se structurer sans la langue.
En réalité, lorsqu’on dit qu’on est « à l’aise » dans une langue, on veut surtout dire qu’on est à l’aise avec ceux qui utilisent cette langue-là ; que c’est avec eux que nous voulons communiquer ; que c’est auprès d’eux que nous souhaitons être valorisés ; que ce sont eux que nous cherchons à convaincre, à persuader, à séduire.
En faisant le choix de telle ou telle langue, de tel ou tel pays d’édition et de diffusion, nous nous coulons dans des rapports de désir et de pouvoir particuliers. Notre choix de langue est un choix de stratégie appliquée à un groupe social spécifique auquel nous donnons priorité : stratégie de séduction, de persuasion, de conquête, de domination. A travers ce choix, nous créons un champ de force. N’est-ce pas précisément ce que nous faisons aujourd’hui ici en parlant de francophonie ?
Pour illustrer mon propos plus avant, je prendrai l’exemple de ces écrivains français qui choisissent aujourd’hui des thèmes américains et s’empressent auprès du public, des éditeurs et des critiques américains. Rêve d’Amérique. Rêve de marché américain. Ils annoncent, ce faisant, que l’objet de leur désir et la configuration de pouvoir qu’ils visent ne sont plus français, mais américains. La France et le français déclinants menaçant de ne pas les porter à l’universalité, c’est par l’Amérique et par l’anglais qu’ils entendent y arriver. Désir d’universalité, donc.
Ce qui m’amène à m’interroger sur la langue et ses relations avec le pouvoir.
J’aimerais avancer l’hypothèse que la langue est un outil de projection de notre ego et de notre volonté de domination. Encore plus la langue transcrite (la langue écrite, enregistrée, amplifiée) puisqu’elle est, par nature, a-topique : elle peut être là où je ne suis pas. Grâce à l’écriture, grâce à Gutenberg et à l’imprimerie, grâce à Internet, la langue est devenue l’équivalent intellectuel du fameux fleet in being qui fit la grandeur de l’Angleterre impériale, l’équivalent guerrier, aussi, du trait de catapulte qui, lorsqu’il fut introduit en Grèce à partir de la Sicile, fit dire au roi spartiate Archidamos : « O Héraclès, c’en est fait de la valeur personnelle ! »
Je suis présent dans mes écrits mais, physiquement, je ne suis pas là où mes écrits sont. Je suis présent dans écrits mais, temporellement, je ne suis pas temporellement là où mes livres sont. C’est en ce sens que la langue est une force de projection spatio-temporelle. Un peu comme un acteur de théâtre, payant tous les soirs de sa personne, qui deviendrait du jour au lendemain acteur de cinéma : a-topique, se reproduisant devant un public alors qu’il est ailleurs, mort peut-être.
Or, en me projetant hors de mon théâtre, hors de mon milieu et hors de mon temps, mon écriture distend les liens que je devrais naturellement entretenir avec mon topos, avec les miens, avec mes contemporains. Distension.
Pire encore, en multipliant de manière exponentielle ma capacité de rayonnement, en décuplant mon pouvoir de séduction et de persuasion, le langage, dopé par l’écriture, l’imprimerie et Internet, finit par m’échapper. Plus je suis diffusé, plus je suis traduit, plus je suis lu, plus je suis commenté, plus je deviens virtuel--mort avant l’heure.
Le langage prend alors le pouvoir sur moi. Un peu comme dans les rapports que nous entretenons désormais avec la technique et qui font, que nous ne faisons plus ce que nous devons faire, mais ce que la technique elle-même peut faire et ce qu’elle nous fait donc faire.
Et la question que je me pose à présent est la suivante : sachant à quel point le langage peut être dangereux et connaissant sa capacité de destruction, est-on en droit d’en faire un usage effréné, sauf à vouloir créer de la Beauté ? Sauf à vouloir toucher du doigt la Vérité ?
Mais comment toucher au Beau et au Vrai par les mots ? Sans doute, dirais-je, en privilégiant la transmission à la communication. En faisant aussi de sorte que nos mots s’effacent derrière ce qu’ils sont censés exprimer. En les empêchant de se substituer à ce qu’ils sont censés exprimer et ne finissent par s’y substituer.
Merci